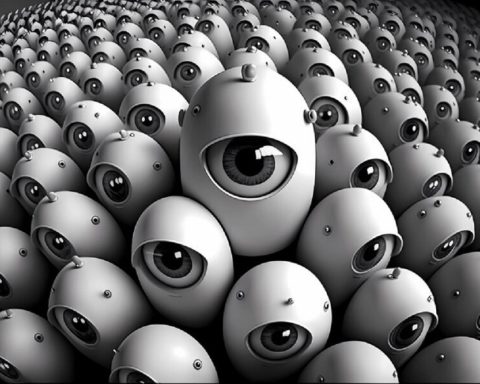Une demande d’open-innovation ?
Exhortation à la confiance
Une nouvelle position topographique du pouvoir
Nœuds de résistance
Un contrat social à réinventer
La solution délibérative
De délibérative et participative, la démocratie doit devenir collaborative

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.