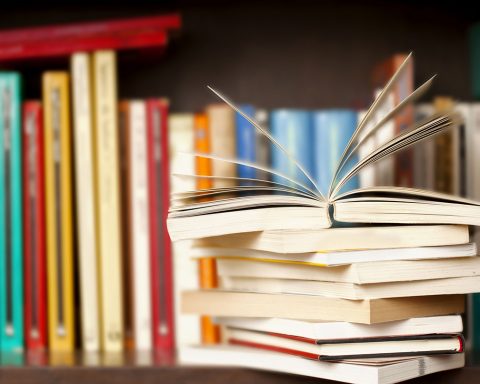La place de l’entreprise dans la société : un débat ancien
Les articles 1832 et 1833 du code civil, qui fondent la définition de l’entreprise, pourraient être modifiés en vue de rétablir la place des parties prenantes au sens large (salariés, clients, fournisseurs, collectivité, etc.) aujourd’hui clairement ignorées par les textes. Tels que rédigés actuellement, les articles mentionnés font en effet clairement des associés (ou actionnaires) les destinataires finaux de la valeur créée par l’entreprise.
Au fond, ces articles du code civil traduisent bien la confiance placée dans le concept de « main invisible » développé quelques dizaines d’années avant leur rédaction par Adam Smith (1776). Ce dernier, postulant que la meilleure manière de contribuer à l’intérêt général consiste à se préoccuper avant tout de son intérêt particulier ou personnel, justifie la focalisation de la mission des entreprises sur la seule valeur apportée aux propriétaires ou actionnaires.
En dépit de remises en cause régulières, une telle vision demeurait relativement consensuelle et peu contestée jusqu’à la crise de 1929, qui aura notamment eu pour effet d’ébranler durablement la croyance selon laquelle le marché apporte toujours la meilleure solution aux problèmes les plus divers.
Après-guerre, un capitalisme plus accommodant
Le capitalisme qui se développe après-guerre se veut beaucoup plus conciliant et intégrateur des attentes des parties prenantes, qui ne sont pas encore nommées ainsi mais qui incluent déjà les salariés, les clients, les fournisseurs, la collectivité… Michel Aglietta (l’un des fondateurs de « l’école de la régulation » en France) qualifie ce capitalisme, qui trouve ses fondements dans la négociation collective et, partant, dans la reconnaissance de la diversité des attentes des parties prenantes, de « capitalisme contractuel ».
Au cours des années 1970-1980, la crise remet en cause le bien-fondé d’un modèle qui n’a pas su protéger de l’émergence de nouveaux déséquilibres. La (« théorie du ruissellement » qui explique que la redistribution des richesses doit s’effectuer « par le haut » (autrement dit qu’en favorisant les profits, les retombées de ces derniers bénéficieront à tout le monde, grâce aux investissements qui seront réalisés et à l’emploi qui en découlera) pose les fondements du fameux « Théorème de Schmidt ».

Le slogan du chancelier Helmut Schmidt « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain » est devenu un théorème économique débattu.
L’émergence des parties prenantes
La formule de l’ancien chancelier ouest-allemand sera remise en cause par la théorie des parties prenantes développée aux États-Unis dans les années 1990 par Edward Freeman. Cette théorie postule que le bénéfice d’une entreprise ne constitue que le résultat d’un processus reposant sur la coopération des parties prenantes. Ce n’est donc pas la philanthropie, mais plutôt une logique de rationalité économique qui justifie ici l’attention portée à la satisfaction des parties prenantes, seule garante de leur engagement et du développement de leur contribution primordiale à l’entreprise.
Plus récemment, la vision que nous développons au sein de la Chaire Mindfulness, Bien-être et Paix Economique de GEM consiste à considérer que le but de l’entreprise est en réalité double : créer des richesses et contribuer au bien commun en renforçant le tissu social de manière durable et respectueuse de la dignité humaine et de la nature. L’entreprise, ainsi positionnée au cœur de la cité, se veut un acteur positif de son environnement, contribuant notamment à la paix, en cohérence avec le rôle qu’attribuait Montesquieu au « doux commerce » : réduire les incitations à la violence entre des acteurs économiques devenus dépendants et partenaires.
Changements de vision, changements de pratiques
La question des destinataires de la valeur créée par les entreprises n’est donc pas nouvelle. Elle dépasse de loin le cadre juridique puisque l’étude des pratiques des entreprises sur le siècle écoulé permet de constater une succession de modes managériales, qui se développent souvent avec un temps de retard plus ou moins important par rapport aux théories évoquées précédemment. Ces évolutions des pratiques témoignent de la capacité des différentes parties prenantes à faire entendre leur voix et valoir leurs intérêts.
De ce point de vue, l’évolution des outils de pilotage des performances est particulièrement révélatrice. Les premiers outils de contrôle de gestion qui se développent dans les années 1920 aux États-Unis sont clairement financiers (notamment le ROI ou retour sur investissement) et traduisent bien la volonté des propriétaires de contrôler les décisions des managers salariés récemment propulsés à la tête des entreprises. Dans les années 1980, la valeur est clairement créée pour les clients et s’exprime bien plus en termes de rapport qualité – prix qu’en termes de rentabilité. Les années 1990 voient le « retour de l’actionnaire » (titre d’un ouvrage de Sophie L’Hélias paru en 1997) : l’émergence d’acteurs au poids considérable remet les actionnaires en position d’imposer leurs attentes (l’indicateur principal devenant l’EVA ou valeur économique ajoutée).
Rééquilibrer les relations
Aujourd’hui, bien que les actionnaires demeurent souvent les plus audibles des parties prenantes, la pérennité semble s’imposer un peu plus chaque jour comme un objectif complémentaire face aux problématiques environnementales (réchauffement climatique, pollution, tarissement des ressources) ainsi qu’à l’accélération des cycles économiques, qui réduisent la durée de vie moyenne des entreprises. Le Balanced Scorecard ou le Prisme de Performance sont clairement des outils de pilotage qui traduisent cette ambition de concilier les attentes des parties prenantes les plus diverses.
Ce coup d’œil dans le rétroviseur permet également de constater que certaines entreprises ont su tirer leur succès et leur pérennité de leur capacité à ne jamais céder aux modes managériales décrites ci-dessus pour parvenir à préserver les intérêts de toutes leurs parties prenantes (celles qu’Antoine Frérot, PDG de Véolia, qualifie aujourd’hui de « critical friends »). Elles y ont parfois sacrifié un peu de rentabilité potentielle à une résilience accrue et à une pérennité avérée.
Les difficultés de l’élargissement de l’objet social des entreprises
L’objet social élargi de l’entreprise était l’une des propositions du manifeste pour une économie positive dirigé par Jacques Attali en 2012. Elle reposait sur la reconnaissance de la pertinence de la théorie des parties prenantes. Une telle vision incite en effet fortement à élargir la définition de l’objet social de l’entreprise à des fins de pure pertinence économique. Bien que la pertinence du regard porté aux impacts de l’entreprise sur la société et l’environnement soit largement admise, y compris par le Medef, ce dernier, par l’intermédiaire de son Président Pierre Gataz, se montre hostile à toute modification du code civil qui ouvrirait la possibilité à de nombreux recours juridiques difficilement gérables par les entreprises. La campagne actuellement menée par les organisations patronales (Medef, Afep et Ansa) en défaveur des retouches évoquées en particulier sur l’article 1833 du code civil devrait fortement peser sur la décision qui sera prise dans quelques semaines, et qui commence d’ores et déjà à se dessiner.
La voie du milieu, choix probable
Une solution moins contraignante et portée par les organisations patronales consisterait à créer une nouvelle forme d’entreprise, « l’entreprise à mission » ou « à bénéfice public », s’inspirant des « public benefit corporations » américaines. Il s’agirait d’inclure dans les statuts de l’entreprise une mission sociale, scientifique ou environnementale qui viendrait compléter la recherche du profit. Les entreprises qui le souhaitent pourraient ainsi mieux prendre en compte l’intérêt général, ce dernier apparaissant clairement et sans ambiguïté comme l’une de leurs missions. Bien sûr certaines, par philanthropie ou par calcul, ne se privent pas de le faire dès à présent, mais le fait de l’écrire les rendrait plus légitimes et moins attaquables au moment de faire face aux reproches de certains actionnaires.
Il faut à ce sujet souligner à quel point il est caricatural de considérer que résultat et rentabilité constituent les seules attentes des actionnaires. Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui intègrent des critères de responsabilité et d’impact positif sur la société pour discriminer les entreprises qui recevront leurs investissements. Un récent sondage du BCG, réalisé auprès de 250 grands investisseurs, permet de constater que 88 % d’entre eux jugent que les dirigeants se focalisent trop sur le court-terme…
Si les débats restent ouverts, et risquent même de s’intensifier dans les semaines qui viennent, il y a de fortes chances qu’entre immobilisme et ambition controversée la voie du milieu ne finisse par s’imposer. D’autant plus qu’elle a aujourd’hui le vent en poupe grâce aux soutiens d’acteurs reconnus et engagés, notamment Antoine Frérot, PDG de Véolia, ou Emmanuel Faber, PDG de Danone. Dans ce cas, les résultats obtenus en termes de changement des comportements délétères seraient bien plus faibles que ceux initialement envisagés par les syndicats et le gouvernement. Le débat sur le rôle de l’entreprise dans la société n’en serait toutefois que légèrement reporté, et se verrait sans doute considérablement renforcé.
Hugues Poissonnier, Professeur d’économie et de management, Directeur de la Recherche de l’IRIMA, Membre de la Chaire Mindfulness, Bien-Etre au travail et Paix Economique, Grenoble École de Management (GEM)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine
Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.