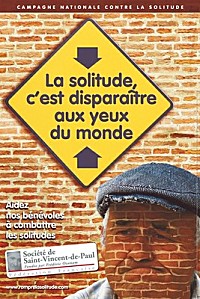Et si l’obsolescence programmée, intégrée à nombre de produits commerciaux afin de susciter le renouvellement des achats, portait en elle la disparition de l’homme en tant qu’individu doué de qualités qui lui permettent d’interagir avec les objets, et avec les autres, autrement qu’en les consommant ? Point de vue iconoclaste ? A vous de juger…
L’obsolescence programmée est un procédé technique qui consiste à concevoir un objet en y intégrant le déclenchement de sa panne, de son usure, de sa défaillance définitive. Il ne s’agit pas seulement de connaître le moment où l’objet deviendra inutilisable (afin, par exemple, de rendre ce moment prévisible) mais de le générer artificiellement. Le produit jetable (à « usage unique ») en est l’exemple-type, mais ce n’est pas le seul que l’on peut citer.
Ainsi les imprimantes, les ordinateurs, l’électroménager, les téléphones portables ou les lecteurs mp3, notamment ceux qui ont connu le plus grand succès, les diverses gammes d’Ipod (1), sont aujourd’hui, pour la plupart, conçus selon ce procédé ; mais aussi de nombreux ustensiles plus communs comme le mobilier, la vaisselle, les ampoules… Si l’usage de ces produits n’est pas « unique », il est artificiellement restreint, de sorte que la durée de vie de ces produits (le temps durant lequel ils sont utilisables conformément à leur fin, et efficaces comme tel) peut être dite systématiquement limitée.
Si le développement à grande échelle de ce procédé date du milieu du XXe siècle (2), il ne concerne pas forcément de nouvelles technologies, de nouveaux objets : un stylo, un couteau, un mouchoir, aussi bien qu’un smartphone dernier cri peut être à obsolescence programmée. Ce qui est nouveau avec ce procédé, c’est bien plutôt qu’il semble requérir de nous, consommateurs (3), un nouveau rapport aux objets qui nous entourent, et qui constituent notre monde. De sorte que ce nouveau rapport aux objets serait lui-même le vecteur d’un nouveau rapport au monde, qui engage un choix global de société et de sociabilité.
Un cycle de vie infini
Le plus remarquable dans l’obsolescence programmée, et dont on peut faire à bon droit la raison de son succès industriel, c’est avant tout la mainmise qu’elle permet sur le cycle de la vie des produits (4). En effet, en rendant inutilisable un exemplaire d’un produit, en faisant advenir sa « mort », l’obsolescence programmée ne met un terme à sa « vie » que pour faire surgir une nécessité : un autre exemplaire, identique, de ce produit doit être racheté. Cette mort n’est donc pas, du point de vue du marché de ce produit, un « déclin », une disparition de la demande. Tout au contraire, elle correspond au moment à partir duquel il doit procéder à son propre rééquipement ; car elle fait advenir ce moment. L’obsolescence programmée permet donc de s’assurer du renouvellement de la demande, de réamorcer un cycle de vie du produit, a priori à l’infini.
De plus, en faisant advenir de manière prévisible (et prévue) la défaillance de l’objet, elle permet d’organiser ce renouvellement ; et donc de maîtriser, de répartir, l’état de la demande. Elle offre ainsi l’espoir d’un marché toujours ouvert et dynamique ; surtout, d’un marché maîtrisable en ses phases et ses caprices, c’est-à-dire manipulable en son rythme. Elle ouvre sur une maîtrise a priori de l’écoulement des stocks, grâce à cette mainmise sur le rythme même du marché. Mainmise qui est le fruit d’une libération : l’écoulement des stocks est, avec l’obsolescence programmée, devenu autonome, indépendant. De quoi ? D’un marché constitué par des consommateurs – reste à voir à quel titre.
En effet, on pourrait souligner que, dans notre économie capitaliste fondée sur un marché de consommation, il y a longtemps que la demande n’est plus fonction du besoin des hommes ; que le « consommateur » est une entité abstraite qu’un producteur peut manipuler selon ses propres besoins. Partant, cela ferait bien longtemps que le capitalisme aurait gagné son indépendance. Cela est vrai, jusqu’à un certain point ; cette indépendance est apparue et a crû, à un certain degré. Or il faut voir que c’est précisément dans cet écart de degrés, qui dessinent des « taux d’indépendance », que va venir se loger la spécificité de l’obsolescence programmée.
 Obsolescences technique, psychologique et programmée
Obsolescences technique, psychologique et programmée
En effet, on peut penser que c’est par là que l’obsolescence programmée se distingue des autres procédés fondées sur l’exploitation de l’obsolescence, selon la typologie proposée par Giles Slade, qui distingue obsolescences technique, psychologique, programmée. Ces procédés organisent en effet le renouvellement de la demande au moyen d’une adaptation au consommateur certes très réduite, car fondée sur une définition réductrice de ce qu’il est (et de ce qu’est un objet), mais néanmoins réelle, de sorte qu’on pouvait encore voir en lui une entité déterminante dans la conception, la commercialisation et la rentabilisation d’un produit.
Ainsi, dans le cas de l’obsolescence technique, le renouvellement d’un produit par un autre est légitimé parce qu’il correspond à une différence technique d’un produit à un autre. Le nouveau produit est présenté comme une innovation, et le renouvellement légitimé à titre de progrès. L’esprit du capitalisme qui triomphe ici est un esprit qui s’appuie sur celui de l’ingénieur ou de l’industriel ; le consommateur, lui, est pressenti comme un utilitariste toujours à la recherche de plus d’efficacité, toujours à l’affût de la « technique de pointe » satisfaisant mieux ses besoins. Ainsi, pour légitimer le remplacement d’un Walkman par un Discman, puis par un MiniDisc et enfin par un lecteur MP3, on soulignera l’avantage présenté, pour le consommateur, par la réduction progressive de la taille du support musical, et finalement par sa disparition.
Dans le cas de l’obsolescence psychologique, le renouvellement est légitimé parce qu’il correspond à une différence dans les qualités formelles du produit (esthétique, design, caractère ludique, ergonomique…), différence en fonction de laquelle il est présenté, et apprécié, comme une nouveauté. C’est le domaine de la mode, du gadget, du design, où le renouvellement est en soi un plaisir, une nourriture psychique qui possède une valeur intrinsèque, en tant qu’elle satisfait nos désirs, nos envies – au premier chef, le pur et simple désir de nouveauté. Elle est donc légitimée comme simple changement, modernité, et non plus comme progrès.
L’esprit du capitalisme qui triomphe ici est celui de la publicité et du marketing, esprit de séduction et d’excitation psychologique sous toutes ses formes. Le consommateur c’est, ici, cette psyché désirante et changeante qu’il s’agit de capter et de séduire. Une définition que l’on peut certes accuser d’être réductrice, mais qui n’en reste pas moins déterminante : seul un être humain, fût-ce un grand enfant, est capable de se réjouir de voir Apple™ lui offrir la possibilité de choisir entre un Ipod bleu, violet ou rose ; c’est donc en fonction de cela qu’Apple™ pourra lancer, et rentabiliser, ce type de gammes.
A la différence de ces autres obsolescences, l’obsolescence programmée ne produit pas un degré de plus dans la réduction de la définition du consommateur : il semble qu’elle permette précisément de s’affranchir de toute référence à une définition déterminante du consommateur. Car, avec elle, le renouvellement des produits les uns par les autres ne se pose ni comme progrès, ni comme changement. En effet, le produit suivant n’est pas innovant, ni nouveau, mais neuf ; c’est-à-dire, techniquement et formellement, le même.
La seule différence qu’il présente avec celui qu’il doit remplacer est finalement numérique : indépendamment de la logique de successivité où ils se remplacent et où l’un est plus « utilisable » que l’autre, ils ne sont différents que parce qu’ils sont deux. Si bien qu’on peut dire que la seule différence qui compte est la place de chaque produit dans cette série, dans la logique de succession ; c’est-à-dire dans l’ordre de l’écoulement des stocks. Une différence qui n’intéresse pas le consommateur, mais le producteur (ce qui est visé, c’est la croissance de la série entière des produits, non le cycle de vie de l’un d’entre eux). Mieux, qui ne doit pas l’intéresser : pour que cet écoulement ait lieu, il faut (et il doit suffire) que le consommateur ne soit rien d’autre que l’entité qui a acheté la première fois, et se retrouve par là même contrainte aux rachats successifs, dont la successivité est déterminée uniquement par la manière dont a été conçu le produit (par la technique de l’obsolescence programmée).
Le triomphe de l’esprit abstrait et l’autonomie du capitalisme
C’est à ce titre qu’on peut parler d’autonomie du renouvellement des produits à obsolescence programmée, et d’ « affranchissement » du producteur ou du marchand : ce dont les produits sont corrélativement affranchis, c’est de la nécessité de se plier à des normes de demande extrinsèques à la seule logique marchande (fût-ce une norme aussi peu déterminante, car aisément manipulable, que le goût pour la nouveauté ou le progrès). C’est-à-dire, en système capitaliste, à la seule exigence de croissance.
On atteint là comme un idéal du capitalisme marchand : s’assurer l’écoulement du stock, mais aussi la possibilité d’accélérer et de décélérer cet écoulement, par la réduction ou l’allongement de la durée de vie des objets ; maintenir ou accélérer le taux de croissance, en faisant se succéder les objets, et donc les actes de rachat, de plus en plus vite, au moyen d’une durée de vie de plus en plus restreinte. Une croissance abstraite, autotélique, qui se vise elle-même, n’a pas d’autre norme qu’elle-même, dont la seule variable est la vitesse, et vis-à-vis de laquelle la référence à un consommateur ou à un monde d’objets déterminés est une absurdité indésirable – ces derniers n’étant finalement, de son point de vue, que facteurs d’inertie, et leurs qualités propres, que déterminations intempestives.
C’est pourquoi l’on peut penser que l’obsolescence programmée participe d’un nouvel « esprit du capitalisme », pour reprendre l’expression de Max Weber (5) et, après lui, de Luc Boltanski et Éve Chiapello (6), celui-là même qui apparaît aujourd’hui avec la dématérialisation des objets, la commercialisation de tout ce qui existe, mais aussi l’informatisation de toute opération, qui en permet l’accélération à des degrés proprement inhumains, et dont l’exemple le plus important est le flash trading, les transactions commerciales et financières pilotées et réalisées par les ordinateurs sur les marchés (7). On assisterait au triomphe d’un esprit abstrait dans ces activités dénuées de toute référence à des réalités humaines ou objectives, conçues de manière purement quantitative, et ne visant ainsi qu’à être perpétuées, accélérées, augmentées, à volonté – et selon la seule exigence de rentabilité croissante.
Dans ce cadre, les hommes sont toujours facteurs de lenteur, d’inertie, d’échec ; du fait de leurs capacités mentales limitées, certes, mais aussi des normes qualitatives de leur existence ; c’est-à-dire, de ce qui rend leur vie digne d’être vécue, et constitue irréductiblement la condition humaine. Normes qui sont à définir, et parmi lesquelles on devra ranger l’existence d’objets dignes de ce nom, capables de constituer un monde, notre monde. Objets matériels, objets durables, objets appropriables (8) ; objets uniques ou irremplaçables ; objets anciens objets communs ; objets d’art, d’histoire, d’affection… Ces attributs ne peuvent trouver place dans une société capitaliste de consommation impulsée par l’application systématique de l’obsolescence programmée, où les objets ne doivent être que les unités d’une série, les moyens du simple renouvellement de la demande et de la production du profit croissant.
Ainsi la durée, le temps qu’il faut à un objet pour exister, être connu et approprié, prendre place dans le monde et le construire, semble, du point de vue de l’obsolescence programmée, l’attribut le plus nécessaire à détruire. Ce qui dure, reste, « fait présence », aujourd’hui, ce ne sont plus des objets, mais de la matière entassée et désossée dans des décharges de plus en plus prolifiques. L’utilité et la propriété elles-mêmes semblent disparaître (9) : l’« usage unique » concentre l’utilité en un geste abstrait qui, loin de réaliser l’objet (son utilité propre étant, pour un objet technique, sa spécificité) l’anéantit aussitôt. Et l’on pourrait se demander ce qui est possédé de cet objet que l’on achète pour le jeter, que l’on détruit en l’utilisant conformément à la raison pour laquelle on le possède.
De l’objet sans qualités…
Le produit à obsolescence programmée apparaît en fait comme un « objet » qui ne mérite plus ce nom ; il n’ob-jecte rien, est nécessairement sans qualité propre, destiné à passer, et le plus rapidement possible, dans l’éphémère d’un acte prédéfini, prédéterminé, limité. Sa présence ne rend rien possible, ne le donne pas même en son simple être-là. Être de fuite, irréalité, matérialité sans disponibilité, ce n’est pas même une « chose », puisque le propre d’une chose c’est précisément d’être présente, de demeurer-là, de façon à pouvoir être éventuellement déterminée. D’où sa convenance avec l’esprit du capitalisme abstrait vu plus haut : cet objet sans détermination propre n’oppose aucune résistance qualitative à la dynamique marchande, peut être fluidifié au rythme de ses besoins.
Déchet en puissance au moment même où on l’achète, le produit à obsolescence programmée révèle, à travers sa choséité problématique, la nature selon laquelle il a été conçu : pure unité d’achat, numéro d’une série dont il permet la succession toujours plus accélérée, au sein d’un calcul dont l’homme est la variable absente, l’inconnue. Ainsi l’obsolescence programmée est-elle, du point de vue du capitalisme, une solution originale et définitive pour tirer profit des objets et des hommes, et de leur interaction, sans avoir à respecter ce qui les caractérise et rend cette interaction fructueuse – ce qui en fait un monde. C’est donc au prix du monde que le capitalisme se libère.
Cette absence de référence au monde et aux hommes, cette manière de « compter-sans-eux » – et d’y trouver son compte –, n’est pas sans effet sur eux. C’est ce que le philosophe Gunther Anders (1902-1992) a nommé « l’obsolescence de l’homme » (10), qu’il diagnostiquait à l’œuvre dans de nombreuses technologies du XXe siècle. Un tel processus est, selon lui, amorcé chaque fois qu’un objet technique implique, pour être conçu et utilisé, de ne plus mobiliser certaines capacités proprement humaines ; chaque fois que son apparition et son développement ne s’inscrivent pas, n’ont pas lieu, dans les cadres objectifs qui déterminent et structurent la condition humaine. En effet, au contact de tels objets, ces capacités non sollicitées tendraient à disparaître, et la condition humaine à s’appauvrir – de la même manière qu’un muscle s’atrophie lorsqu’il est privé d’exercice.
… à l’homme sans qualités
Or, avec l’obsolescence programmée, ce que l’on attend dudit « consommateur », c’est un premier acte d’achat initiant une série qui s’auto-renouvelle, s’autorégule d’elle-même, une action pour laquelle il n’a nul besoin d’être un être humain – ni même, un organisme vivant. Les machines, en effet, vendent et achètent aussi bien que nous – sans utilitarisme, sans état d’âme, sans caprice. Elles achètent même mieux, pour le capitalisme dont nous voyons apparaître le nouvel esprit de flash trading.
Le rapport à l’« objet » à obsolescence programmée, une fois acheté, n’implique pas non plus l’intervention de qualités proprement humaines, si l’on considère que dans l’interaction homme/objet se passe autre chose, ou peut se passer autre chose, que le déclenchement d’un système de défaillance interne programmé au moyen d’un certain nombre de gestes stéréotypés ; si l’on soutient, au contraire, que notre humanité se développe au moyen et au contact des objets, notamment dans la manière dont les objets nous permettent de construire un monde et d’entrer dans une interaction concrète avec un autrui (en quoi elle se développe comme liberté, créativité et sociabilité).
On peut se convaincre de la pertinence de cette thèse en regardant le film d’animation Wall-e, d’Andrew Stanton (PIXAR, 2008). Le robot Wall-e, passant 700 ans seul au milieu d’objets désormais disponibles (puisque abandonnés, soustraits de la logique marchande qui a rendu la terre inhabitable par les hommes, et donc libéré les objets), a développé des qualités spécifiquement humaines, qui en font le seul humanoïde de la galaxie. Notamment : un langage, une capacité à prendre soin des choses et des êtres, à se construire un espace propre (un monde), une créativité (goût artistique et jeu), de l’humour, une capacité à aimer, à vouloir vivre à plusieurs, et à agir, à prendre des décisions (entre autres, celle de refaire de la Terre un lieu habitable, un monde).
Ce sont ces capacités, non sollicitées au contact des non-objets d’aujourd’hui, qui seraient en voie de disparition. Avec l’obsolescence programmée, c’est le monde qui devient une réalité obsolète ; car c’est notre mondanité, cette capacité à construire, préserver et appartenir à un monde d’objets qui nous relie et nous réunit (11), qui s’atrophie. Un monde de produits à obsolescence programmée ne mérite pas ce nom, c’est un espace abstrait, le cadre de leur pure succession, traversé par un « temps » qui n’est que la variable abstraite permettant d’opérer une rentabilité croissante. Dans cet espace-temps on ne trouvera pas d’objets ni d’hommes, puisque ceux-ci peuvent perdre les attributs constitutifs de leur humanité, doivent les perdre même, pour le bien de la croissance. Le faire advenir, c’est se condamner à disparaître.
Solidité et résistance
Mais il s’agit, précisément, de ne pas se condamner. L’idée selon laquelle constituer un problème, c’est déjà penser en quels termes il peut trouver sa solution, doit valoir d’autant plus dans le cadre d’une interrogation sur notre devenir futur. Ainsi, si l’on a pu esquisser les grands traits de ce « monde » nouveau que nous sommes en train de « construire » avec l’obsolescence programmée, et à le faire apparaître comme conséquence d’un nouvel esprit du capitalisme, c’est justement en contrepoint de normes qualitatives d’une objectivité et d’une humanité dignes de ce nom (et qui, de ce fait, le font bien plutôt apparaître comme « non-monde », et comme « déconstruction » ou destruction).
La définition et la défense de ces normes, de ce qu’est, doit être, un objet, et de ce que nous devons faire individuellement et collectivement avec lui, est l’objectif nouveau, la tâche proprement critique qui doit être accomplie comme réponse à, réponse contre, un danger inédit. Il s’agira donc de constituer un « nouveau matérialisme », de penser la manière, pour le monde, de résister à cette dynamique de fluidification, de liquéfaction et de destruction qui spécifie le capitalisme de notre temps. Il s’agira de refonder la solidité qualitative, et partant la résistance, des choses et des hommes.
 Jeanne Guien, étudiante en philosophie – Article paru dans la revue Vivagora 2012
Jeanne Guien, étudiante en philosophie – Article paru dans la revue Vivagora 2012
1) Apple™ a ainsi fait l’objet d’un procès (s’achevant sur un accord à l’amiable…) pour avoir conçu les batteries de ses Ipod selon la technique de l’obsolescence programmée (celles-ci se révélant défaillantes au bout de dix-huit mois). Et l’existence même de plusieurs « gammes », et leur diversification permanente, sont des faits que l’on peut assigner à la pratique systématique des diverses formes d’obsolescence, comme on va le voir.
2) Pour une historiographie de l’apparition et du développement de l’obsolescence programmée, voir Giles Slade, Made to Break, Technology and obsolescence in America, Harvard University Press, 2006.
3) Consommateurs », c’est-à-dire, d’abord, acheteurs et usagers. Mais pas uniquement : dans la mesure où nous vivons dans un espace que l’on peut décrire en termes de « société de consommation », on peut penser que nous sommes en permanence portés à interagir avec ce type de produits, et avec ceux qui les utilisent ; et que nous sommes, ce faisant, toujours au moins indirectement déterminés par leurs propriétés, quand bien même nous n’en posséderions pas à proprement parler.
4) Les spécialistes du marketing considèrent classiquement qu’un produit a un cycle de vie constitué de cinq phases : mise au point, lancement sur le marché, phase de développement, de maturité, de déclin. L’enjeu, pour son producteur, sera de faire durer au maximum l’intervalle entre développement et maturité, où la vie du produit sur le marché est synonyme de rentabilité croissante.
5) M. Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, 2004.
6) L. Boltanski et E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999
7) Sur le flash trading et la déshumanisation qu’il engendre, voir notamment Paul Virilio, le grand accélérateur, Galilée, 2010, voir son interview sur France Culture.
8) Par « appropriable », j’entends (pour un objet) non pas « susceptible de devenir une propriété privée », mais susceptible de devenir unique du fait de la transformation ou de l’interprétation qu’il reçoit au contact d’un ou de plusieurs (l’appropriation peut être individuelle autant que collective) individu(s) humain(s).
9) Comme l’analyse des « attributs condamnés » est ici limitée à quelques-uns, on a choisi (outre celui de durée qui est le plus immédiatement visé par l’obsolescence programmée) ceux de propriété et d’utilité à dessein. Non que leur disparition soit des plus regrettables, mais en tant qu’elle fait voir que l’utilitarisme et l’esprit de propriété privée, qui ont joué un grand rôle dans l’apparition et le développement de l’esprit du capitalisme, semblent dépassés avec l’obsolescence programmée. On a bien encore affaire à un « nouvel esprit du capitalisme ».
10) G. Anders, L’obsolescence de l’homme, tomes I, Ed. Encyclopédie des nuisances, 2002, et tome II, Ed. Fario, 2011.
11) Sur le rapport entre condition humaine et « appartenance-au-monde », voir Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne.
{jacomment on}