Et si, face à la crise environnementale, la nature n’était plus seulement sauvage ou domestiquée, mais traversée d’une troisième voie — née des ruines que nous laissons derrière nous ? Dans Notre nouvelle nature, Anna Tsing nous conduit au cœur de cette « troisième nature », faite de vivants féraux, de recompositions fragiles et d’alliances discrètes entre humains et non-humains. C’est un livre qui réapprend à voir : un art d’observer ce qui persiste, prolifère, résiste ou renaît dans les interstices du monde abîmé. Cet article en explore les pistes, les images et les promesses, pour comprendre ce que ces zones d’ombre et de lumière disent de notre manière d’habiter la Terre aujourd’hui.
À la source du concept
En 1996, dans L’Art du jardin et son histoire (Odile Jacob), l’historien John Dixon Hunt propose une théorie des degrés de la nature. La première nature désigne les espaces « à l’état sauvage », encore vierges de toute empreinte humaine — sommets inaccessibles, déserts inhabités, étendues maritimes lointaines. La deuxième nature, elle, est façonnée par le travail de l’homme : champs cultivés, paysages modelés, grands aménagements décrits par Cicéron. Quant à la troisième nature, Hunt en situe l’émergence au milieu du XVIᵉ siècle, avec le développement des jardins baroques italiens – une nature recomposée, mêlant terres agricoles et reliefs sauvages, savamment orchestrée pour devenir paysage à part entière. Cette acception, largement reprise par les paysagistes contemporains, s’est déployée comme horizon esthétique et urbain. Michel Péna l’a défendue dans Pour une troisième nature (2010), tandis que Bernard Lassus convoquait déjà cette idée dans l’ouvrage collectif Hypothèses pour une troisième nature (1992).
Anna Lowenhaupt Tsing, anthropologue américaine, en propose une lecture tout autre — moins ornementale, plus politique. Dans Le Champignon de la fin du monde (La Découverte, 2017), elle définit cette troisième nature comme celle qui « réussit à exister malgré le capitalisme ». C’est la nature qui persiste dans les friches et les ruines, prolifère dans les interstices laissés par l’agriculture intensive, se glisse au bord des capitales et s’adapte aux perturbations des écosystèmes. On y rencontre des espèces dites férales, sauvages par nécessité, qui participent à la reconstruction des forêts sur les terres abandonnées, réinstallent plantes et animaux au cœur des zones industrielles désertées, et recolonisent même Tchernobyl — « avec ses bleuets irradiés ». Cette dynamique, Tsing l’explore avec le géologue Jan Zalasiewicz et des chercheurs de l’université d’Aarhus à travers Feral Atlas, plateforme interactive consacrée aux espèces sauvages et à leurs trajectoires. Pour ces chercheurs, une part décisive de notre avenir repose sur cette action férale, ce vivant qui revient là où on ne l’attendait plus.
Observer l’Anthropocène depuis le sol
À l’heure de l’Anthropocène — cette ère où l’emprise humaine bouleverse la planète — l’approche dominante consiste souvent à regarder le monde en grande échelle : des modélisations climatiques, des statistiques globales, des scénarios planétaires. Dans Notre nouvelle nature (1), l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing et ses co-auteures refusent ce point de vue « d’en haut ». Pour elles, il ne s’agit pas de comprendre l’Anthropocène depuis des graphiques et des courbes abstraites, mais « depuis le sol, depuis le terrain » — là où les transformations prennent forme concrète, localement. « Il nous faut réapprendre à redécouvrir notre Terre, la nouvelle nature où nous vivons désormais, territoire après territoire (ce qu’Anna Tsing appelle des patchs), en suivant aussi bien les dynamiques non humaines que celle des êtres humains. »
Cette démarche — empirique, située, souvent inattendue — s’incarne dans la notion de « patch ». Un patch, c’est un territoire ou un lieu particulier — une friche urbaine, un marais colonisé par des plantes envahissantes, un bassin d’eau « modifié » par une infrastructure, un espace postindustriel abandonné — où l’on observe les effets directs d’actes humains passés. Mais ces lieux ne sont pas figés : ce sont des foyers de mutation, de prolifération, de transformations souvent incontrôlables.
La « troisième nature »
C’est à partir de ces patches que se structure la « troisième nature », selon Tsing. Cette notion se distingue d’une « première nature » — la nature dite « sauvage » ou originelle, antérieure à l’industrialisation — et d’une « deuxième nature » — les milieux artificialisés, aménagés ou domestiqués, tels que les villes ou les infrastructures humaines. La troisième nature n’est ni purement naturelle, ni strictement artificielle : elle est le produit des interférences humaines, mais elle évolue ensuite selon ses propres dynamiques, souvent imprévisibles, parfois fécondes, souvent destructrices.
Dans cette troisième nature, les êtres non-humains — plantes envahissantes, espèces proliférantes, champignons opportunistes, virus, insectes, bactéries — deviennent des acteurs à part entière. Ils ne sont plus des ornements ou des victimes passives, mais des agents capables de remodeler les environnements, de détourner des projets humains, de survivre, voire de prospérer malgré des conditions défavorables, ou en tirant parti des ruines, des friches, des déchets des infrastructures. Pour Tsing, c’est là l’essence même de ce qu’elle appelle la « féralité » : des entités transformées par l’impact humain, puis lâchées dans un monde où elles suivent des trajectoires hors de tout contrôle humain.
Le livre foisonne d’exemples — envahissement d’espèces aquatiques après la construction de canaux, prolifération d’espèces opportunistes sur des terrains abandonnés, émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques autour d’industries, mutation de champignons ou d’insectes transportés via les chaînes mondiales, destructions collatérales d’écosystèmes entiers. Ces récits montrent que la troisième nature n’est ni uniforme ni unifiée : elle est morcelée, fragmentée, faite d’un patchwork de réalités disjointes, reliées parfois par des corridors — biologiques, commerciaux, migratoires, logistiques — et pourtant globales dans leurs effets.
Ce parti pris de l’échelle microscopique — du sol, du local — change radicalement notre rapport à l’écologie, au vivant, au politique. Au lieu de s’enfermer dans les grandes prédictions climatiques, Tsing invite à observer les microhistoires, à écouter les trajectoires imprévues des vivants non humains, à reconnaître la complexité de ces interactions et leurs conséquences souvent invisibles. Cela oblige à repenser non seulement ce qu’est la nature, mais ce que signifie habiter la Terre à l’âge de l’Anthropocène — non comme maîtres absolus, mais comme cohabitants parmi d’autres existences transformées.
Autre dimension importante : cette approche renouvelle la pensée écologique en y introduisant une dimension politique et éthique. En exposant les effets collatéraux des infrastructures — souvent imposées par des logiques coloniales ou capitalistes — Tsing met en lumière les injustices environnementales héritées des déséquilibres historiques, les conséquences sur les populations les plus fragiles, humaines ou non-humaines. Elle invite à une « morale de l’attention » : attention aux vivants, aux ruines, aux cycles de vie et de mort, aux opportunités de renaissance inattendues, mais aussi aux dégâts invisibilisés.
Notre nouvelle nature ouvre la voie à une écologie du « plus-qu’humain », loin des dualismes classiques (nature vs culture, humain vs non-humain). Elle suggère que, dans l’Anthropocène, la nature n’est ni sauvée ni dominée, mais transformée — toujours en cours de réinvention, souvent en marge, parfois férale, parfois capable de résilience. La troisième nature, avec ses patchs, ses formes imprévisibles, ses vies résistantes ou opportunistes, nous confronte à la fragilité et à l’incertitude, mais aussi à la possibilité d’un monde fait de complicités inter-espèces, de récits entremêlés, d’une cohabitation radicalement autre.
C’est une pensée exigeante, déroutante, mais profondément vivante — la promesse d’un regard renouvelé sur ce que signifie être vivant sur Terre aujourd’hui.
Une politique du sensible
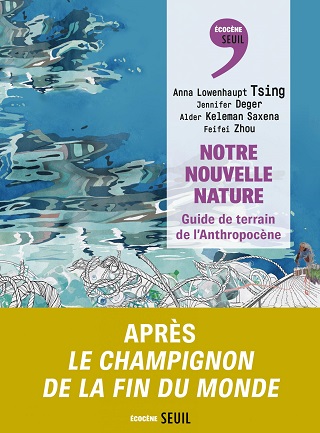 Le livre nous apporte une façon nouvelle — et nécessaire — de regarder le monde vivant. À l’heure où l’effondrement écologique domine le récit collectif, Notre nouvelle nature explore les marges, les recoins où le vivant se transforme, persiste. Son intérêt majeur est de nous apprendre à voir autrement. Là où l’on pourrait ne percevoir que des ruines, Anna Tsing débusque des collaborations inattendues, des formes de vie qui se réorganisent, des espèces qui s’inventent une place dans un environnement abîmé. La « troisième nature » n’est pas un refuge nostalgique vers une nature perdue ni un plaidoyer pour la maîtrise technologique : c’est une invitation à accepter la complexité du monde tel qu’il est devenu, hybride, incertain, peuplé d’acteurs multiples.
Le livre nous apporte une façon nouvelle — et nécessaire — de regarder le monde vivant. À l’heure où l’effondrement écologique domine le récit collectif, Notre nouvelle nature explore les marges, les recoins où le vivant se transforme, persiste. Son intérêt majeur est de nous apprendre à voir autrement. Là où l’on pourrait ne percevoir que des ruines, Anna Tsing débusque des collaborations inattendues, des formes de vie qui se réorganisent, des espèces qui s’inventent une place dans un environnement abîmé. La « troisième nature » n’est pas un refuge nostalgique vers une nature perdue ni un plaidoyer pour la maîtrise technologique : c’est une invitation à accepter la complexité du monde tel qu’il est devenu, hybride, incertain, peuplé d’acteurs multiples.
L’ouvrage a également une portée politique et sensible. Il offre un cadre pour penser l’avenir, non pas en termes de restauration d’un paradis disparu, mais en termes de coexistence et d’attention. Lire Tsing aujourd’hui, c’est accepter de ralentir le regard, d’observer les dynamiques minuscules, d’apprendre à écouter ce qui pousse dans l’ombre. C’est peut-être, aussi, une manière de retrouver un peu d’espoir — non un espoir naïf, mais un espoir lucide, fait de micro-résistances, de germinations ténues, d’interdépendances méconnues.
Le sens de cette réflexion ne résiderait-il pas dans l’invention d’une écologie du sensible — un art d’habiter un monde abîmé, en y reconnaissant non seulement les cicatrices, mais aussi les possibles ?
(1) « Notre nouvelle nature », de Anna Lowenhaupt Tsing – Avec Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou – Editions du Seuil, 2 mai 2025
Photo d’en-tête : Image du spectacle « Troisième nature », performance / 40 minutes – Belgique, 2022 – Festival Plastique Danse Flore : Concept, chorégraphie et interprétation Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre
Première publication : 15 avril 2025













