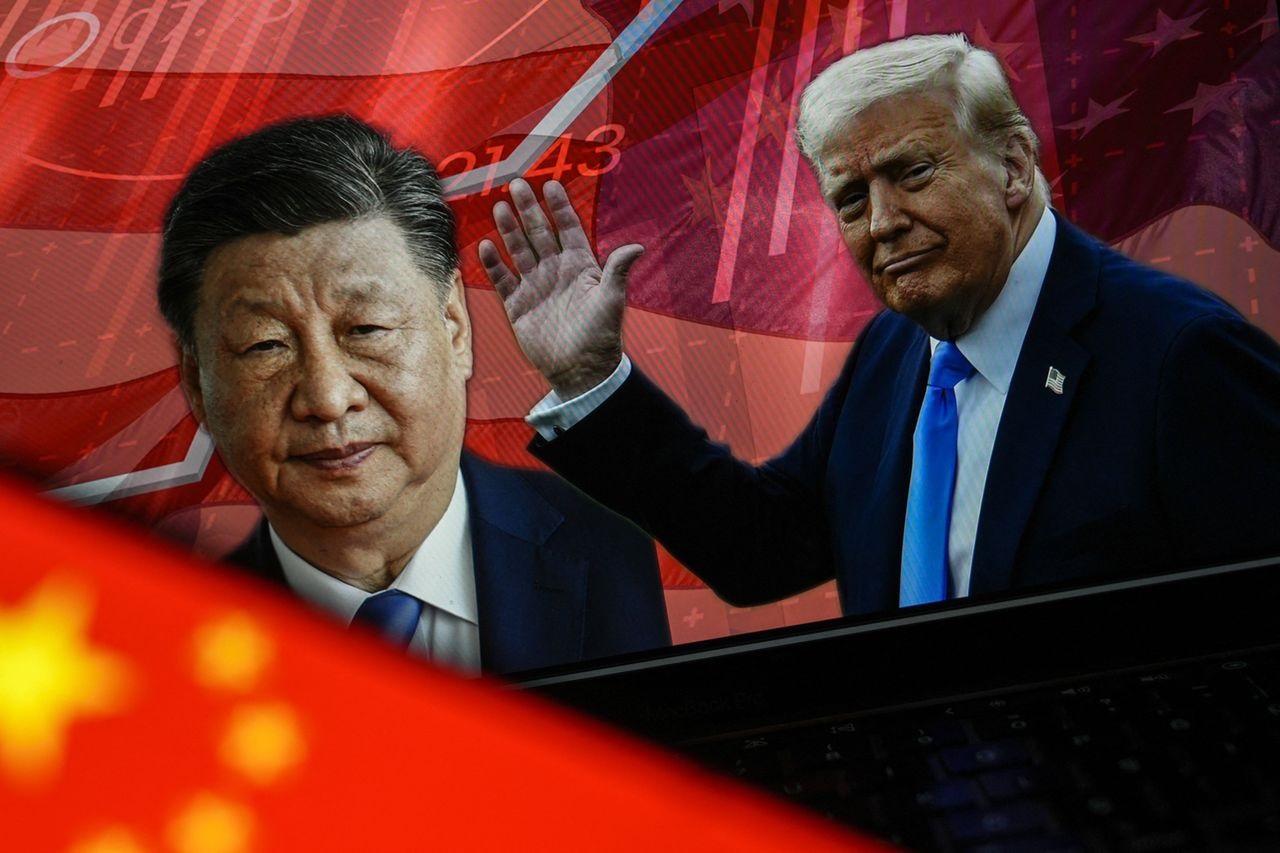La libération, ce 13 octobre 2025, des derniers otages israéliens a soulevé un immense soulagement, comme une respiration rare dans un conflit violent. Les familles exsangues, les diplomaties éprouvées et les sociétés divisées retrouvent pour un instant un visage humain. Mais derrière les embrassades et les applaudissements, se pose une question vertigineuse : et maintenant ? Peut-on transformer ce frémissement d’apaisement en un début de paix ? Cynthia Fleury, dans Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment (1), offre une lecture éclairante de ce défi moral et psychique : pour que la paix advienne, il faut d’abord soigner l’âme collective, apprendre à sortir du ressentiment et réinventer le lien.
Le fragile miracle d’un apaisement
La libération des derniers otages israéliens vivants offre un rare moment de respiration dans un conflit qui semblait avoir étouffé toute humanité. Le journaliste Laurent Joffrin l’a bien formulé dans son éditorial : « La libération des otages détenus dans des conditions atroces par le Hamas entretient la flamme fragile des espoirs de paix. Pour une journée au moins, il faut se réjouir de ce début d’apaisement. La suite repose sur la mise à l’écart des fanatiques des deux bords. »
Cette phrase capte la tension de l’instant : la joie d’un soulagement collectif mêlée à la conscience que rien n’est gagné. Le calme actuel n’est pas la paix ; il est un fragile intervalle, un moment suspendu qui ne tient qu’à la bonne volonté des uns et à la retenue des autres. Ce « miracle » ne naît pas d’un accord définitif, mais d’une suspension provisoire des hostilités. Il s’agit d’une trêve – non d’une guérison. Comme l’écrit Cynthia Fleury, « seulement il existe ce moment où savoir ne suffit pas à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le deuil, le renoncement… ». Autrement dit, même ce que l’on croit maîtriser – les griefs, les torts, les mots – continue de vibrer sous la surface. Le moment de paix est comme une trêve intérieure : il calme la fièvre sans guérir la blessure.
Le retour des derniers otages israéliens, après des mois de captivité, de peur et de diplomatie de l’extrême, redonne une part d’humanité à un conflit qui semblait avoir tout dévoré. Mais il révèle aussi la précarité du chemin vers la paix : il suffira d’un tir, d’un attentat, d’une humiliation publique pour que la haine reprenne feu. Cet apaisement collectif révèle donc une vulnérabilité profonde. Dans un contexte aussi chargé, chaque geste de confiance peut être perçu comme une faiblesse, chaque silence comme une trahison. Ce paradoxe nourrit l’instabilité du moment : on se réjouit d’une victoire morale tout en redoutant sa fragilité. La presse, dans son ensemble, l’a souligné : si l’émotion domine aujourd’hui, la méfiance pourrait reprendre demain. Joffrin le rappelle : la pacification ne pourra s’imposer que si les fanatiques des deux bords sont mis à l’écart, car ce sont eux qui, inlassablement, s’emploient à rompre le fil ténu du dialogue.
Pour Fleury, l’apaisement ne peut être qu’un processus, jamais un état stable. Le ressentiment continue de travailler les psychismes même dans les périodes les plus calmes ; il demeure latent, tapi sous les discours de réconciliation. Car la mémoire, elle, ne dort jamais. Les récits traumatiques, les images des pertes, les souvenirs de l’humiliation se recomposent aussitôt dans les esprits. La philosophe met en garde contre la falsification inconsciente de la mémoire, écrivant : « Sans la revigoration consciente, le ressentiment n’existerait donc pas ; on en resterait à l’en-deçà inconscient, plus traumatique, mais non nécessairement devenu ressentiment. » Ce qu’elle nous dit, c’est que l’apaisement ne saurait être durable sans un travail lucide sur la mémoire ; faute de quoi, il demeure superficiel, une parenthèse trompeuse dans l’histoire longue d’un conflit jamais vraiment refermé.
Pour que ce fragile miracle prenne racine, il faut l’investir, le nourrir, le penser. Il ne s’agit pas seulement de se réjouir, mais de transformer cette émotion collective en point de départ. Il faut, comme le suggère Fleury, relier l’apaisement à la dimension de la guérison, lui donner une continuité psychique et politique. Car « faire la paix » n’est pas simplement cesser le feu : c’est apprendre à vivre à nouveau, à reconnaître la souffrance de l’autre sans s’y perdre, à se reconstruire dans le respect mutuel. Ce moment d’accalmie ne prendra tout son sens que s’il s’inscrit dans cette dynamique de dépassement — celle qui transforme la suspension de la haine en apprentissage de la paix.
Ce moment suspendu nous rappelle qu’un processus de paix n’est pas seulement affaire de frontières ou de traités : c’est un travail d’assainissement moral et psychique. Et c’est là que la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury offre un éclairage essentiel : dans Ci-gît l’amer, elle analyse comment le ressentiment empoisonne les individus et les nations — et comment, sans guérison du ressentiment, aucune paix durable n’est possible.
Dans cette étrange scène géopolitique, un acteur inattendu s’est imposé : Donald Trump. Le président américain, souvent jugé imprévisible ou dénué de profondeur politique, a su pourtant jouer un rôle décisif dans la médiation qui a conduit à la libération des otages. Paradoxe saisissant : c’est peut-être parce qu’il est “sans mémoire”, comme l’écrit un commentateur, sans bagage historique ni ressentiment, qu’il a pu s’extraire des postures héritées, agir sans dette symbolique, sans peur d’un passé à réparer. Cet homme « sans histoire », au sens presque freudien, a réussi là où d’autres, lestés de mémoire et d’idéologie, s’étaient immobilisés. En cela, il incarne malgré lui la thèse de Cynthia Fleury : la sortie du ressentiment, même par hasard, ouvre toujours une brèche vers l’action et vers la possibilité d’un apaisement réel.
Mais si l’absence de mémoire peut parfois libérer l’action, elle ne suffit pas à guérir les peuples. Car une paix durable ne se construit pas sur l’amnésie, mais sur la transformation consciente du passé. Et c’est précisément là que commence le véritable enjeu : comprendre comment le ressentiment, enraciné dans les mémoires blessées, continue d’alimenter le conflit.
La libération : joie, prudence et mémoire
Les images de libération ont bouleversé l’opinion publique : des visages hagards, des familles étreintes, des foules applaudissant au passage des bus escortés. Ces moments de joie pure contrastent avec l’horreur des récits de captivité. « Avant de retomber dans les affres de l’éternel conflit, il faut laisser parler l’émotion : celle de voir revenir à la vie vingt spectres enfermés deux ans dans les ténèbres d’une captivité inhumaine, affamés, humiliés, maltraités jour après jour, creusant parfois leur tombe sous la férule de bourreaux sadiques. La joie des familles et le soulagement de tout un peuple mettent un peu de baume au cœur meurtri de ceux qui ont suivi dans l’angoisse cette guerre sans loi ni merci. » note encore Laurent Joffrin. Mais l’émotion ne suffit pas à conjurer les fractures.
Sur le plan diplomatique, la libération s’inscrit dans un accord complexe en trois phases, négocié par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis, visant un cessez-le-feu durable. Des centaines de prisonniers palestiniens ont été échangés contre une vingtaine d’otages encore vivants. La scène du retour, aussi émouvante soit-elle, porte en elle une charge politique explosive : certains en Israël dénoncent une concession excessive, d’autres, côté palestinien, y voient un premier pas vers la reconnaissance.
Mais la question de fond demeure : comment reconstruire une confiance brisée ? Comment transformer une trêve humanitaire en une dynamique politique ? L’histoire du conflit montre que les moments de grâce sont souvent suivis de rechutes sanglantes.
C’est pourquoi il faut aujourd’hui déplacer le regard : passer de la stratégie à la psychologie collective, de la diplomatie à la guérison des blessures intérieures. Car, pour citer Cynthia Fleury, « le ressentiment est une maladie de la mémoire. [et] la mémoire blessée se transforme en machine de revanche symbolique. » : un poison qui empêche d’espérer, qui fige les peuples dans la douleur et la vengeance.
Ce fragile apaisement, aussi précieux soit-il, ne suffit pas à conjurer les forces obscures qui continuent de travailler les consciences. Sous la surface du calme retrouvé, la mémoire reste vive, la colère encore tiède, les blessures à peine refermées. C’est ici que se joue la véritable bataille : non plus sur les champs de ruines, mais dans les esprits. Car ce qui ronge les peuples et empêche la paix, ce n’est pas seulement la violence physique — c’est le ressentiment, ce poison lent que Cynthia Fleury décrit comme « une colonisation de l’être ». Comprendre ce mécanisme, c’est saisir le cœur du conflit : là où la douleur se transforme en identité, et l’injustice en mémoire de guerre.
Le ressentiment comme moteur du conflit
Dans Ci-gît l’amer, Cynthia Fleury invite à considérer le ressentiment comme une dynamique sociale et politique, un « poison qui infuse l’individu et le corps social ». Il s’insinue dans les mémoires, dans les récits collectifs, dans la manière dont une nation se raconte à elle-même son propre malheur.
Rien n’illustre mieux cette mécanique que le conflit israélo-palestinien : deux mémoires blessées, deux récits de dépossession, deux tragédies qui s’enchevêtrent. Chacun se vit comme victime d’une injustice majeure, et cette double victimité rend le dialogue presque impossible. Fleury parle du ressentiment comme du « ressassement aliénant d’un discours victimaire », une rumination qui enferme et empêche d’agir. Il fige les peuples dans le rôle du souffrant, leur ôtant la capacité de créer un avenir.
Le ressentiment offre l’illusion de la force, mais il enferme. Il entretient la douleur pour ne pas avoir à en faire le deuil. »
— Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer
Cette phrase saisit le cœur du problème : le ressentiment est une forme d’attachement à la blessure. Il refuse le travail du deuil, transformant la souffrance en identité. Au lieu de permettre la guérison, il la reporte indéfiniment. Fleury souligne que « la mémoire blessée se transforme en machine de revanche symbolique » : les commémorations, les monuments, les discours officiels deviennent autant de champs de bataille où l’on rejoue, génération après génération, la scène de l’injustice originelle.
Mais le ressentiment ne se contente pas d’entretenir la douleur ; il abolit le discernement. « Notre époque est en proie au ressentiment, à la pensée simpliste », écrit-elle, voyant dans cette crispation émotionnelle l’un des grands dangers de la modernité politique. Quand la colère devient le langage commun, la nuance est perçue comme une trahison, et le dialogue devient impossible.
Dans le contexte israélo-palestinien, cette logique se traduit par une réciprocité du soupçon et du refus : chaque concession est vécue comme une capitulation, chaque geste de paix comme une menace identitaire. Or, prévient Fleury, « le ressentiment est une colonisation de l’être ». Il dépossède l’individu de sa liberté intérieure, tout comme il asservit les peuples à leurs blessures. Seule la sublimation – c’est-à-dire la transformation créative de la douleur – peut amorcer une « décolonisation de l’être », condition indispensable à l’émergence d’un monde plus ouvert.
Seulement, il existe ce moment où savoir ne suffit pas à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le deuil, le renoncement… »
— Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer
Ainsi, la paix entre Israéliens et Palestiniens ne pourra advenir sans ce dépassement de l’amertume. Elle suppose de rompre la logique du miroir – où chacun se voit victime dans la souffrance de l’autre – et d’amorcer un travail de désintoxication symbolique. Le ressentiment, chez Fleury, est une aliénation ; sa guérison, une reconquête du pouvoir d’espérer.
Dans le tumulte du Proche-Orient, cette leçon sonne comme un avertissement universel : on ne fait pas la paix avec sa haine, mais avec sa mémoire apaisée.
Guérir l’amer : trois chemins pour reconstruire la paix
Fleury identifie trois voies possibles pour sortir de l’empoisonnement du ressentiment. Ces pistes, pensées à l’échelle du sujet, peuvent inspirer aussi la politique internationale.
L’oubli comme libération
L’oubli n’est pas déni. C’est la faculté d’alléger la mémoire pour redevenir vivant. Une société en paix n’efface pas son passé, mais cesse de s’y crucifier. Cela suppose de distinguer la mémoire nécessaire (celle qui préserve la dignité des victimes) de la mémoire pathologique (celle qui ravive la haine).
Israël et la Palestine ne peuvent pas — et ne doivent pas — oublier leurs morts. Mais ils doivent apprendre à laisser place à un avenir qui ne soit pas prisonnier du passé.
La sublimation : transformer la douleur en création
L’art, la poésie, la musique, l’éducation deviennent ici des forces de transmutation. Fleury écrit : « Le style est la forme la plus noble de la guérison ». Dans le contexte du Proche-Orient, cela signifie investir massivement dans la culture, les échanges, la connaissance mutuelle. La paix n’est pas seulement un traité ; c’est un langage à reconstruire, une esthétique du vivre-ensemble.
L’Ouvert : accueillir l’incertitude
Concept central chez Fleury, « l’Ouvert » désigne l’attitude qui accepte la vulnérabilité, le doute, le dialogue. C’est la posture contraire à celle du ressentiment : au lieu de se refermer sur l’offense, on s’ouvre au possible.
Appliqué à la paix, cela signifie : négocier sans illusion, mais sans haine, accepter les compromis sans les vivre comme des trahisons, reconnaître la part d’inachevé propre à toute réconciliation.
Instituer la guérison comme politique
Si l’on suit Fleury, la paix n’est pas l’absence de guerre, mais un processus thérapeutique collectif. Il faudrait donc, dans tout futur accord, prévoir des mécanismes qui ne soient pas uniquement politiques, mais psychiques et symboliques, comme, par exemple, des commissions de vérité ; des programmes de mémoire croisée ; des échanges culturels massifs ; des jumelages d’écoles et d’universités ; des espaces communs de parole, de deuil, de justice restaurative.
Ces dispositifs ne sont pas accessoires : ils sont la condition même de la reconstruction. Tant que la haine reste nourrie par le ressentiment, aucun traité ne tiendra. C’est pourquoi la philosophie de Fleury doit être lue comme un manuel de politique intérieure des peuples.
Vers une paix de conscience
La paix ne viendra pas d’un coup de plume, mais d’un lent travail sur soi collectif. La libération des otages, comme l’écrit Joffrin, « entretient la flamme fragile des espoirs de paix ». Elle prouve que la négociation, la diplomatie, la patience peuvent encore produire un miracle, aussi fragile soit-il.
Mais cette flamme ne tiendra qu’à une condition : écarter les fanatiques des deux bords et faire entrer la compassion dans le langage politique. La paix durable exige de la lucidité, mais aussi de la tendresse : tendre la main là où tout incite à la serrer en poing. Cynthia Fleury le résume mieux que quiconque : « Guérir du ressentiment, c’est se redonner le pouvoir d’aimer. »
Et peut-être est-ce là, au-delà des accords, le véritable commencement d’une paix humaine.
(1) Ci-gît l’amer. Guèrir du ressentiment, de Cynthia Fleury – Editions Gallimard, octobre 2020
Photo d’en-tête : AFP