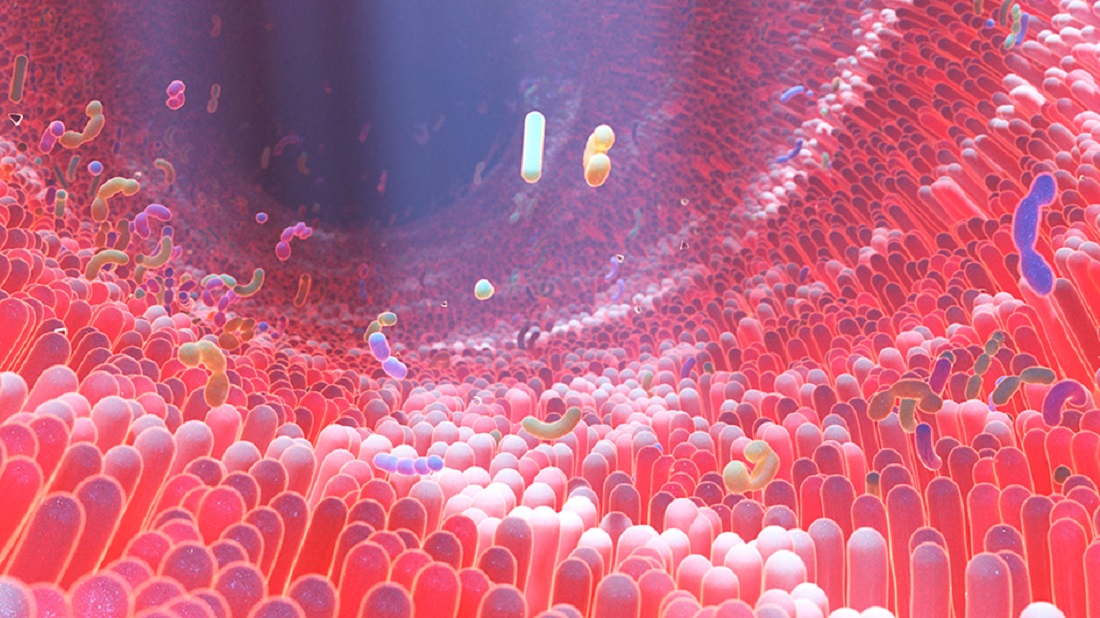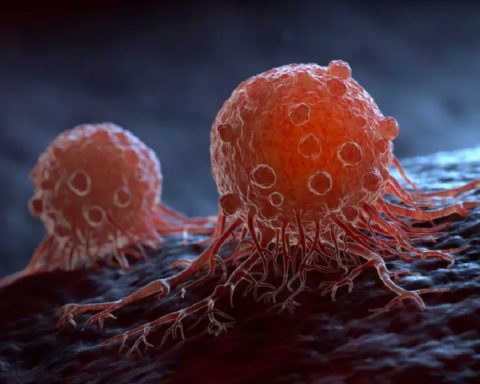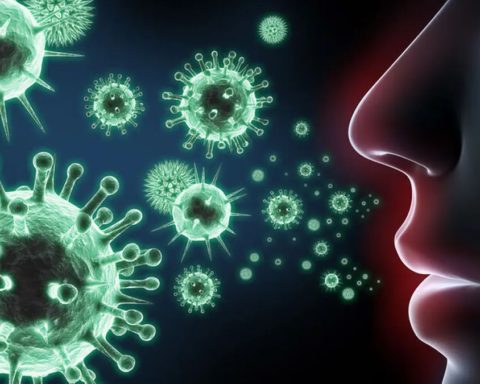On pensait que le cerveau vivait en colocation exclusive avec le glucose, refusant catégoriquement l’entrée aux graisses alimentaires. Surprise : il entretient en réalité une relation beaucoup plus intime avec les lipides qu’il ne voulait bien l’admettre. Les dernières recherches montrent même que ces graisses discutent directement avec nos neurones dopaminergiques — oui, ceux qui décident si l’on se ressert ou non. Une découverte qui redistribue les cartes du plaisir de manger… et peut-être aussi de nos petits excès.
Cet article, initialement publié dans Polytechnique Insights et réalisé avec la participation de Giuseppe Gangarossa, professeur de neurobiologie à l’Université Paris Cité, explore une série de travaux scientifiques qui remettent en cause un dogme historique : celui selon lequel les triglycérides, ces gros lipides issus de l’alimentation, seraient incapables de franchir la barrière hémato-encéphalique. Or des études récentes démontrent non seulement qu’ils atteignent bel et bien le cerveau, mais qu’ils interagissent directement avec son circuit de la récompense, modifiant potentiellement nos comportements alimentaires. Ces travaux de 2020 et 2022 apportent des résultats très nouveaux, qui modifient profondément la façon dont on comprend l’interaction entre alimentation et cerveau. Ils montrent que les lipides ne sont pas seulement des nutriments énergétiques, mais de véritables messagers cérébraux, capables d’agir sur la dopamine, le nerf vague, la satiété et le comportement alimentaire.
Lipides et neurones dopaminergiques : une barrière qui n’en était pas une
Pendant des décennies, la littérature scientifique présentait la barrière hémato-encéphalique comme un rempart quasi hermétique aux grosses molécules provenant de l’alimentation. Cette barrière biologique, constituée de cellules endothéliales extrêmement étanches, a pour fonction de protéger le cerveau des toxines et de réguler de façon stricte ce qui peut ou non atteindre le tissu neuronal. Dans ce cadre, les triglycérides — molécules lipidiques volumineuses issues de la digestion des graisses — étaient considérés comme trop imposants pour traverser cette frontière. L’idée semblait d’autant plus logique que le cerveau, organe très énergivore, utilise massivement le glucose comme carburant. L’équation était donc simple : le sucre entre, les lipides restent à la porte.
La publication de 2020 par l’équipe de Chloé Berland, Giuseppe Gangarossa et Serge Luquet a pourtant bouleversé cette vision. En observant directement le voyage des triglycérides après un repas riche en graisses, les chercheurs ont montré qu’une fraction de ces lipides franchit effectivement la barrière hémato-encéphalique et se retrouve dans des régions-clés impliquées dans les comportements alimentaires. Cette découverte a constitué un véritable tournant, révélant que le cerveau est en réalité bien plus sensible aux signaux issus de la digestion que ce que l’on pensait jusqu’ici.
Une fois dans le cerveau, les triglycérides ne restent pas passifs : ils interagissent avec les neurones dopaminergiques, ces neurones qui utilisent la dopamine comme messager et qui orchestrent la motivation, le plaisir, la prise de décision et l’anticipation de récompenses — y compris alimentaires. Le fait que des lipides alimentaires puissent modifier directement l’activité de ces neurones place l’alimentation dans une double dynamique : elle nourrit le corps, mais elle influence aussi, de manière immédiate, les circuits cérébraux qui régulent l’envie de manger.
« En réalité, les triglycérides passent, et ils agissent même sur les neurones dopaminergiques », résume Giuseppe Gangarossa. Cela signifie que chaque repas riche en graisses pourrait envoyer au cerveau un signal supplémentaire, distinct de celui du glucose, potentiellement capable d’ajuster notre motivation à continuer de manger. Cette interaction ouvre un champ de recherche entièrement nouveau, dans lequel les lipides deviennent des acteurs à part entière de la modulation du plaisir alimentaire, et non de simples nutriments.
En révélant cette communication directe entre lipides et neurones dopaminergiques, l’étude remet en question une vision simplifiée du lien entre alimentation et cerveau. Elle montre que les graisses ne sont pas seulement métabolisées en périphérie : elles participent activement au dialogue neurobiologique qui guide nos comportements, parfois jusqu’à favoriser des dérégulations dans la prise alimentaire. Un renversement conceptuel majeur, aux implications profondes pour comprendre l’obésité, la compulsivité alimentaire et la vulnérabilité de notre système de récompense.
Quand la lipoprotéine lipase transforme les graisses en messagers cérébraux
L’une des découvertes majeures de l’étude de 2020 concerne le rôle central d’une enzyme bien connue du métabolisme : la lipoprotéine lipase, ou LPL. Dans l’organisme, cette enzyme joue habituellement un rôle très concret : elle découpe les triglycérides transportés dans le sang en acides gras libres, lesquels pourront ensuite être utilisés comme carburant ou stockés dans les tissus adipeux. On la retrouve notamment dans les muscles, le foie ou encore le tissu adipeux. Son rôle semblait purement métabolique.
Ce qui a surpris les chercheurs, c’est de constater que cette enzyme est également présente dans le cerveau, et plus précisément à la surface des neurones dopaminergiques — ceux-là mêmes qui régulent le plaisir, la motivation et les comportements alimentaires. Cette présence inattendue suggère que la LPL pourrait participer activement à la transformation des signaux lipidiques issus de l’alimentation en informations utilisables par les circuits neuronaux.
Concrètement, lorsque des triglycérides franchissent la barrière hémato-encéphalique, ils se retrouvent face à la LPL neuronale. Cette dernière agit alors comme une sorte de ciseau moléculaire : elle découpe ces grosses molécules en fragments plus petits, tels que certains acides gras ou dérivés lipidiques. Ces fragments, beaucoup plus diffusibles et dynamiques, deviennent capables d’interagir avec des récepteurs ou des voies de signalisation dans le cerveau.
« La LPL coupe les triglycérides en morceaux plus petits, capables d’agir comme messagers dans le cerveau », explique Giuseppe Gangarossa. Cela signifie que, tout comme la dopamine ou la sérotonine, certains produits issus de la digestion des graisses peuvent participer à la transmission d’informations entre neurones. Ils modifient potentiellement l’excitabilité neuronale, influencent la libération de neurotransmetteurs ou réorientent certains circuits du plaisir alimentaire.
Cette découverte élargit considérablement la palette des messagers chimiques du cerveau. Jusqu’ici, on considérait qu’elle se composait essentiellement de neurotransmetteurs classiques : dopamine, sérotonine, glutamate, GABA… Désormais, on comprend que certains lipides transformés par la LPL peuvent eux aussi jouer un rôle de signalisation, en modulant directement les circuits dopaminergiques.
Les implications sont vastes. D’un point de vue physiologique, cela signifie que chaque prise alimentaire riche en graisses génère une série de signaux lipidiques susceptibles de modifier très rapidement l’activité du système de récompense. D’un point de vue pathologique, ces signaux pourraient contribuer à des dérégulations, notamment dans l’obésité ou le comportement alimentaire compulsif, où la sensibilité aux lipides semble altérée.
Ainsi, la LPL ne se contente pas de gérer l’énergie : dans le cerveau, elle transforme les graisses en véritables molécules messagères, capables d’influencer nos décisions, notre appétit et notre recherche de plaisir. Un rôle insoupçonné, qui fait des lipides un élément désormais incontournable pour comprendre le dialogue intime entre alimentation et cerveau.
Go / No-Go : comment les lipides perturbent les signaux de satiété
La dopamine régule l’alimentation en s’appuyant sur deux grandes voies neuronales : les neurones équipés de récepteurs D1, associés à l’activation et à l’impulsion d’agir (« go »), et les neurones D2, qui jouent au contraire un rôle d’inhibition et de frein (« no-go »). En temps normal, l’équilibre entre ces deux types de signaux permet au cerveau de décider si l’on continue de manger ou si l’on s’arrête.
L’étude montre que les triglycérides perturbent spécifiquement le fonctionnement des neurones D2. En présence de lipides, ces neurones deviennent moins réactifs : leur capacité à envoyer le signal d’arrêt diminue. « Les lipides inhibent le signal “stop” », résume Giuseppe Gangarossa. Chez les personnes en surpoids, un phénomène supplémentaire semble apparaître : une forme de résistance lipidique, qui rend les neurones D2 encore moins sensibles malgré la forte présence de triglycérides.
Ce dysfonctionnement crée un déséquilibre au profit des signaux D1, ceux qui encouragent à manger encore. Résultat : le cerveau reçoit plus facilement le message « continue », tandis que le message « stop » peine à se faire entendre — un mécanisme qui pourrait contribuer à la surconsommation et au dérèglement du comportement alimentaire.
Un cerveau connecté au corps : le rôle essentiel de l’intéroception
Comprendre l’influence des lipides sur nos comportements alimentaires nécessite de sortir d’une vision strictement centrée sur le cerveau. Comme le rappelle Giuseppe Gangarossa, « le cerveau communique en permanence avec la périphérie, notamment l’intestin ». Cette communication bidirectionnelle, essentielle à l’équilibre du comportement alimentaire, repose sur un ensemble de signaux physiologiques regroupés sous le terme d’intéroception.
L’intéroception désigne la perception des signaux internes : faim, satiété, digestion, mais aussi rythme cardiaque, état émotionnel ou niveau d’énergie. Ces informations, issues principalement de l’intestin et des organes digestifs, sont envoyées vers le cerveau via des voies nerveuses et hormonales. Elles permettent au système nerveux central d’ajuster en temps réel nos comportements alimentaires, en modulant l’appétit, le plaisir de manger ou la sensation de « trop plein ».
Dans ce dialogue constant, les lipides jouent un rôle clé. Ils ne se contentent pas d’être métabolisés : certains servent de messagers biologiques entre le corps et le cerveau. Leur présence dans la circulation sanguine après un repas, leur transformation en signaux neuronaux ou leur implication dans le ressenti de la satiété montrent qu’ils participent activement à la coordination cerveau-intestin.
Ainsi, loin d’être un organe isolé, le cerveau fonctionne comme un centre de contrôle connecté en permanence à l’ensemble du corps. C’est cette boucle continue — où les signaux internes influencent nos décisions alimentaires, et où nos prises alimentaires modifient en retour ces signaux — qui façonne notre rapport à la nourriture. Comprendre cette interaction, c’est mieux saisir comment certains dérèglements peuvent apparaître, et pourquoi l’alimentation ne peut être analysée sans tenir compte de ce dialogue subtil entre le système nerveux et le reste de l’organisme.
Axe intestin-cerveau : quand les lipides endogènes alimentent le binge eating
En 2022, une nouvelle étude de l’équipe de l’Université Paris Cité s’est intéressée au lien entre endocannabinoïdes et comportements alimentaires extrêmes. En exposant des souris à une friandise quotidienne, riche en gras et en sucre, les chercheurs ont observé l’apparition d’un comportement de binge eating.
Ce phénomène n’est pas seulement lié à la libération de dopamine : il implique aussi une surproduction d’endocannabinoïdes. « Leur quantité augmente et cela inhibe le nerf vague », précise encore le chercheur. Or ce nerf est essentiel à la sensation de satiété. Privées de ce frein naturel, les souris continuent de manger de manière compulsive.
Cette découverte ouvre des pistes thérapeutiques : cibler les récepteurs des endocannabinoïdes pourrait permettre de restaurer la satiété et de calmer les prises alimentaires compulsives.
Sucre, gras et addiction : une comparaison à manier avec précaution
Peut-on parler d’addiction alimentaire ? Cette idée revient régulièrement dans le débat public, notamment lorsque l’on observe certains comportements de consommation compulsive ou des symptômes évoquant un manque — irritabilité, nervosité, envie irrépressible de manger sucré ou gras. Pourtant, la comparaison avec les drogues classiques doit être maniée avec prudence. Comme le souligne Giuseppe Gangarossa, les nutriments comme le sucre ou les lipides n’agissent pas exclusivement sur le cerveau : ils interviennent simultanément dans de nombreux organes et dans des systèmes physiologiques complexes.
Contrairement aux substances psychoactives, qui ciblent directement et massivement les circuits neuronaux de la récompense, les aliments mobilisent une multitude de voies : digestives, hormonales, métaboliques, sensorielles et émotionnelles. Certaines de ces voies peuvent effectivement converger vers des mécanismes proches de ceux de l’addiction — par exemple des modifications de la dopamine ou de la sensibilité aux récompenses — mais elles ne reproduisent pas le schéma unique et centralisé d’une dépendance aux drogues.
De plus, la nourriture est indispensable à la survie, ce qui rend ses circuits de régulation intrinsèquement plus complexes et plus robustes. Il ne s’agit donc pas d’une addiction au sens strict, mais plutôt d’un continuum de comportements, allant de l’alimentation saine à des formes de dérégulation pouvant inclure le grignotage compulsif ou le binge eating. Cette distinction est essentielle pour comprendre les mécanismes en jeu et éviter de réduire l’alimentation à un modèle de dépendance simplifié.
Ainsi, si certains parallèles existent, ils doivent être interprétés avec nuance. L’alimentation mobilise un ensemble de systèmes biologiques bien plus large que les drogues et demande, selon Gangarossa, « une approche globale, holistique », intégrant le cerveau, le corps, les émotions… et l’environnement alimentaire lui-même.
Les aliments ultra-transformés accentuent-ils ces phénomènes ?
Les études sur les triglycérides et la dopamine ne portaient pas sur les produits ultra-transformés, mais leur mécanisme d’action suggère clairement qu’un tel environnement alimentaire peut accentuer les phénomènes décrits : perturbation des signaux de satiété, sollicitation excessive de la dopamine, dérégulation de la communication intestin-cerveau, comportements alimentaires compulsifs. Les aliments ultra-transformés ne créent pas ces mécanismes — ils les exacerbent, car :
1. Ils peuvent amplifier certains mécanismes du système de récompense : Les produits ultra-transformés sont souvent conçus pour être hyper-palatables : très riches en sucres, en graisses ou en sel, avec des textures et des arômes optimisés pour maximiser le plaisir alimentaire. Ce cocktail a deux effets connus : stimulation accrue du système dopaminergique, donc du circuit de récompense ; incitation à manger au-delà du besoin énergétique, car le signal de plaisir surpasse les signaux internes de satiété.
Cela ne signifie pas que ces aliments créent une « addiction », mais ils accentuent les mécanismes étudiés : modulation de la dopamine, déséquilibre du « go/no-go », recherche répétée de stimulation.
2. Leur composition en lipides et sucres peut accentuer les dérèglements des signaux de satiété. Les produits ultra-transformés contiennent souvent des triglycérides rapidement assimilables, des sucres simples absorbés très vite, des additifs modifiant textures et perception sensorielle. Ces caractéristiques peuvent amplifier la hausse postprandiale des lipides circulants, la stimulation des voies dopaminergiques, la perturbation des neurones D2 (signal « stop »), la dérégulation de l’intéroception (moins bonne perception faim/satiété).
Les études ne l’ont pas montré directement, mais le lien mécanistique est cohérent.
3. Les ultra-transformés perturbent aussi la communication intestin-cerveau. D’autres travaux montrent que ce type d’alimentation altère le microbiote intestinal,, perturbe le nerf vague et la transmission de la satiété, et peut modifier la production d’endocannabinoïdes.
Et comme l’une des études évoquées met justement en avant le rôle des endocannabinoïdes dans le binge eating, le rapprochement est pertinent : une alimentation très transformée peut renforcer ces dérèglements.
4. Ce n’est pas la présence du gras ou du sucre en soi : c’est la combinaison
C’est l’association : gras + sucre, textures faciles à consommer, faible pouvoir rassasiant, fort pouvoir hédonique, qui crée un environnement alimentaire auquel nos circuits neuronaux ne sont pas adaptés. Les graisses isolées ou naturelles ne produisent pas les mêmes effets.
Une nouvelle pièce au puzzle du comportement alimentaire
Au-delà des éclairages qu’elles apportent sur le rôle des lipides dans le cerveau, ces études introduisent surtout un changement de perspective majeur. Pendant longtemps, la compréhension du comportement alimentaire reposait essentiellement sur l’action des sucres, des hormones digestives et des neurotransmetteurs classiques. La découverte que des triglycérides peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, dialoguer avec les neurones dopaminergiques et moduler les circuits du « go / no-go » constitue une avancée significative.
Ces résultats ne révèlent pas simplement un mécanisme supplémentaire : ils redéfinissent notre vision des graisses, longtemps considérées comme de simples nutriments énergétiques. Elles apparaissent désormais comme des messagers actifs, capables d’influencer directement la motivation, l’appétit ou encore la manière dont le cerveau interprète les signaux internes liés à la faim et à la satiété. Une pièce essentielle s’ajoute ainsi au puzzle complexe du comportement alimentaire, ouvrant la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques et à une meilleure compréhension de certains dérèglements — qu’il s’agisse de difficultés à ressentir la satiété, de comportements alimentaires compulsifs ou de déséquilibres dans le système de récompense.
Ces découvertes bousculent notre compréhension des relations entre graisses, cerveau et comportements alimentaires. Sucres et lipides semblent jouer un rôle tout aussi essentiel dans le dérèglement du système de récompense. Si la notion d’addiction alimentaire demeure délicate, il est désormais clair que les lipides participent activement à la régulation — et parfois à la dérégulation — de notre rapport à la nourriture. Un champ de recherche en pleine expansion, aux implications majeures pour la santé publique.