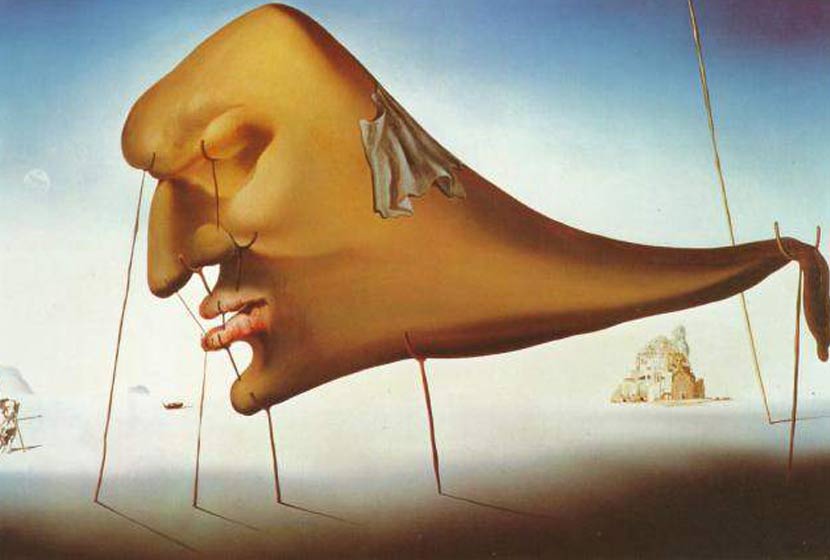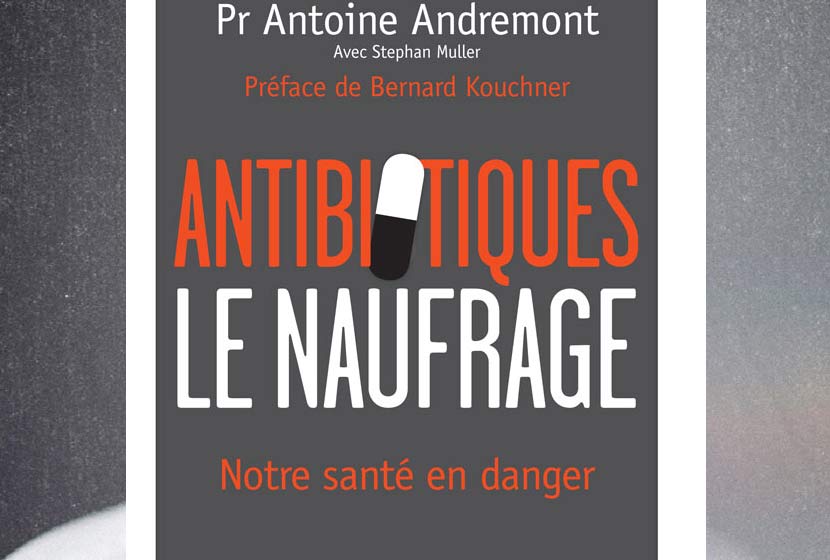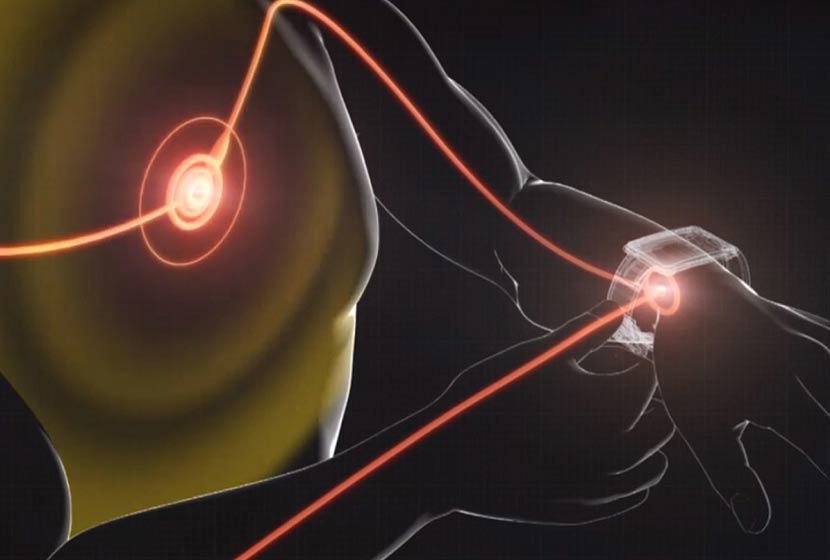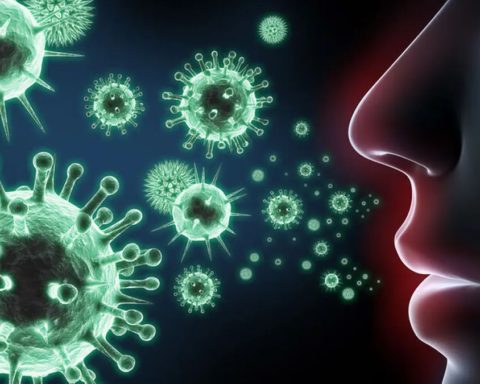Désir d’enfant, d’un corps différent ou d’une meilleure qualité de vie ? Forte de ses acquis sur la mécanique du corps et des biotechnologies d’aujourd’hui, la médecine est plus que jamais en mesure de soigner bien plus que la souffrance. Techniquement, elle en est capable mais cette médecine-là qui s’arroge des droits inédits sur l’existence est-elle acceptable ?
L’histoire d’Ashley X a fait le tour de la toile en 2007. Sept ans plus tard, elle dérange encore. La jeune fille a aujourd’hui 16 ans et vit chez ses parents aux Etats-Unis. Elle aime la musique, surtout Andrea Bocceli, et faire des vocalises. Rien de bien étonnant jusque-là. Sauf qu’Ashley passe sa vie sur des coussins et des oreillers, transportés par son entourage de l’un à l’autre. A cause d’une encéphalopathie qui a empêché le développement de ses capacités motrices et mentales, l’adolescente n’en est pas une. Elle a le cerveau d’un bébé de trois mois. Elle ne marche pas, ne joue pas, ne parle pas et dépend totalement des autres pour se nourrir, se laver et se mouvoir.
Ses parents tiennent un blog sur lequel ils parlent de leur fille chérie et du choix qu’ils ont fait pour elle quand les premiers signes de la puberté se sont manifestés. « Confrontés à la réalité de la situation médicale d’Ashley, écrivent-ils, en tant que parents aimants, nous avons travaillé avec ses médecins à faire tout ce que nous pouvions pour lui apporter la meilleure qualité de vie possible. Le résultat est le traitement d’Ashley. »
Un traitement inédit à l’époque, qui a consisté à interrompre prématurément et irréversiblement la croissance de la fillette en lui administrant de hautes doses d’oestrogènes, de façon à ce qu’elle ne dépasse pas les 1m33 et ne pèse jamais plus de 30 kg. Ashley vivra donc toute sa vie dans un corps aux dimensions enfantines. Ses parents pourront continuer à s’occuper d’elle à la maison.
Avec les médecins, ils ont par ailleurs également jugé bon de lui retirer l’utérus pour lui éviter les désagréments liés aux règles, l’appendice de manière à ce qu’elle ne souffre jamais d’appendicite et les tissus glandulaires de la poitrine afin que ses seins ne se développent pas. « A quoi bon avoir des seins quand on a le cerveau d’un nourrisson ? », rapporte la correspondante du journal Le Monde dans un article daté de janvier 2007. Les parents d’Ashley ont plaidé qu’elle en serait encombrée. Si sa poitrine ne se développe pas, ont-ils dit, elle ne sera pas incommodée par les sangles, dans la chaise roulante. Et si elle n’a pas de seins, elle n’aura pas de cancer du sein. Dans la famille, il y a des antécédents. » Enfant, fillette, jeune femme, adolescente… Comment qualifier Ashley aujourd’hui? Il faut avouer qu’entre son âge temporel (16 ans), son âge physiologique (6 ans et quelque) et son âge moteur et mental (3mois), on s’y perd un peu.
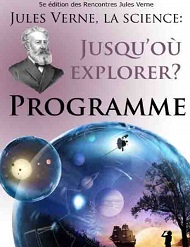 Venu participer aux Rencontres Jules Verne fin novembre à Nantes, consacrées cette année aux limites de l’exploration scientifique, Guillaume Durand (1), philosophe membre du comité d’éthique clinique du CHU de Nantes, prend quelques minutes pour conter l’histoire d’Ashley.
Venu participer aux Rencontres Jules Verne fin novembre à Nantes, consacrées cette année aux limites de l’exploration scientifique, Guillaume Durand (1), philosophe membre du comité d’éthique clinique du CHU de Nantes, prend quelques minutes pour conter l’histoire d’Ashley.
Même dans les grandes lignes, même sans entrer dans les détails de la maladie et de ses effets tous azimuts, même en s’en tenant aux faits et en s’abstenant de porter un jugement, il sait bien qu’il va provoquer une onde de choc dans l’assistance. C’est un vendredi après-midi et la salle est composée principalement de lycéens en pleine digestion. Rien de tel qu’une situation extrême suscitant l’indignation, le dégoût, voire l’incompréhension, pour entrer dans le vif du sujet. Et lancer le débat sur la médecine des désirs, dite aussi de convenance ou de confort car il a bien fallu trouver un terme pour la distinguer de la médecine dite classique. »
« La médecine des désirs a deux caractéristiques essentielles, pose le philosophe. Elle est une réponse à des désirs non liés à des pathologies. Désir de jeunesse, de performance sexuelle, de beauté, de confort, de qualité de vie, etc. La relation entre le médecin et son patient s’en trouve bouleversée car il ne s’agit plus pour le médecine de poser un diagnostic mais de consentir ou pas à la demande du patient qui vient en sachant exactement ce qu’il désire. »
La maladie, une souffrance comme les autres
A première vue, on pourrait se croire loin de la médecine qui soigne pour tenir à distance la maladie et de son pronostic le plus sombre, la mort. Après tout, prendre du Viagra, un traitement hormonal susbstitutif ou se faire faire un lifting, offre il est vrai la possibilité de gagner en performance au lit, de contrer les inconforts provoqués par la ménopause ou d’arborer une apparence moins marquée par le temps. Mais à bien y regarder, le désir peut aussi être celui d’échapper à une hypothétique maladie. C’est le cas par exemple avec le diagnostic pré-implantatoire qui, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, permet de sélectionner les embryons exempts d’une anomalie génétique connue pour être impliquée dans une pathologie héréditaire. Et tout à coup, c’est une frontière nette entre le désir qui relèverait d’un caprice et la maladie, sujet grave et sérieux, qui s’estompe.
 Qu’importe, cherchons ailleurs. Pourquoi ne pas condamner la médecine des désirs et l’exclure d’emblée du champ médical au motif qu’elle n’entre pas dans le cadre des pratiques qui soignent ? Du reste, c’est l’un des arguments les plus souvent mis en avant par ses détracteurs. Encore faut-il avoir pris soin (le soin n’est pas l’apanage des professionnels de santé) de s’interroger sur ce qu’il convient de soigner. Les maladies et leurs symptômes ? Les souffrances ? Car derrière certains désirs se loge une authentique souffrance. Vouloir un enfant et ne pas pouvoir le concevoir à cause d’une infertilité biologique ou sociale (quand on est un couple de même sexe par exemple) est une souffrance. Certains souffrent d’être timides, d’autres trop gros ou pas assez musclés. Dans les derniers instants de la vie, la douleur peut être immense et dévorante.
Qu’importe, cherchons ailleurs. Pourquoi ne pas condamner la médecine des désirs et l’exclure d’emblée du champ médical au motif qu’elle n’entre pas dans le cadre des pratiques qui soignent ? Du reste, c’est l’un des arguments les plus souvent mis en avant par ses détracteurs. Encore faut-il avoir pris soin (le soin n’est pas l’apanage des professionnels de santé) de s’interroger sur ce qu’il convient de soigner. Les maladies et leurs symptômes ? Les souffrances ? Car derrière certains désirs se loge une authentique souffrance. Vouloir un enfant et ne pas pouvoir le concevoir à cause d’une infertilité biologique ou sociale (quand on est un couple de même sexe par exemple) est une souffrance. Certains souffrent d’être timides, d’autres trop gros ou pas assez musclés. Dans les derniers instants de la vie, la douleur peut être immense et dévorante.
Si la finalité de la médecine consiste à soulager les souffrances, alors il paraît légitime de s’en remettre à l’assistance médicale à la procréation, aux anxiolytiques, à la chirurgie esthétique ou aux soins palliatifs dès lors que ces techniques sont disponibles et efficaces. Et Guillaume Durand de rappeler à point nommé les quatre buts essentiels de la médecine énumérés dans le rapport Hastings, qui fait référence en la matière : prévenir la maladie et promouvoir la santé, soulager la douleur et la souffrance, prodiguer des soins et des traitements aux malades, éviter une mort prématurée et rechercher une mort paisible. Or la médecine des désirs a tout l’air de contribuer à promouvoir la santé au sens large, c’est-à-dire la bonne santé globale intimement liée au bien-être et à la qualité de vie. « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De ce point de vue, elle est donc légitime.
Deux autres arguments sont souvent brandis à l’encontre de ces pratiques décidemment fort dérangeantes. D’aucun estime qu’elles sont contre-natures, au sens où il s’agit de toucher à l’ordre naturel des choses, ce qui les situe d’emblée du côté des indésirables. Mais que dire alors des handicaps de naissance, tout ce qu’il y a de plus naturels eux aussi mais qu’on admet fort bien chercher à soulager ? Se verrait-on refuser des lunettes correctrices à un mal-voyant ou un traitement à un enfant né avec une malformation cardiaque ? Assurément non.
La médecine des désirs se voit par ailleurs facilement reprochée le fait de n’être accessible qu’à certains parmi les plus aisés et les mieux informés. Soit, toutes les médecines coûtent chères et nos systèmes de santé sont ainsi faits qu’ils accordent la priorité de la solidarité nationale aux soins et aux traitements des maladies selon leur gravité, et encore pas toutes. Les désirs passent en général après, à l’exception notable de certains actes relevant de l’assistance médicale à la procréation (en France, la Sécurité sociale rembourse quatre tentatives de fécondation in vitro) ou de la chirurgie réparatrice (après brûlure grave ou cancer du sein notamment). Pour autant, serait-on bien avisé de jeter le bébé avec l’eau du bain ? Autrement dit, de fermer la porte à cette médecine pour tous ou permettre aux plus modestes d’y accéder plus facilement ? Le traitement médical d’Ashley, lourd mais pas hors-norme, a coûté près de 40 000 dollars. Plus que le bien-fondé de la médecine des désirs, c’est un choix de société qu’il s’agit là de discuter.
Photo : Sculpture Musée Bourdelle, Paris [Photo YF]
L’écueil de la fabrique des normes
 Légitime ou pas, la médecine des désirs est aujourd’hui une réalité. En France, où selon l’Inserm environ 10% des couples sont infertiles, plus de 22000 enfants sont nés grâce à l’assistance médicale à la procréation en 2010, soit une naissance sur 40 ayant nécessité une insémination artificielle, une fécondation in vitro ou dans certains cas plus rares, un don d’embryon.
Légitime ou pas, la médecine des désirs est aujourd’hui une réalité. En France, où selon l’Inserm environ 10% des couples sont infertiles, plus de 22000 enfants sont nés grâce à l’assistance médicale à la procréation en 2010, soit une naissance sur 40 ayant nécessité une insémination artificielle, une fécondation in vitro ou dans certains cas plus rares, un don d’embryon.
Le cas d’Ashley, exceptionnel bien que non-unique (d’autres enfants dans le monde ont reçu un traitement équivalent), est l’arbre qui cache la forêt.
Il a mis sur le devant de la scène la série des questionnements éthiques liés aux multiples situations où la médecine peut modifier les corps. Pour le meilleur lorsque la qualité de vie a toutes les chances de s’en trouver améliorée ou pour le pire lorsque le recours à la médecine a pour but la normalisation ou le contrôle social des individus.
S’agissant de telles dérives, les exemples ne manquent pas, plus ou moins évidents ou insidieux : stérilisation des personnes atteintes de troubles mentaux, diagnostic pré-implantatoire en vue de décider des caractères physiques du bébé à naître, médicaments administrés aux enfants trop remuants. Le risque existe aussi de confier à la médecine et aux médecins la pleine possession d’un rôle, celui de permettre aux individus d’accéder à leurs désirs et/ou à une meilleure qualité de vie, qui relève au moins autant de la collectivité, du politique et de choix de société. Le Pr Arthur Caplan, du centre de bioéthique de l’Université de Pennsylvanie, interrogé dans Le Monde en 2007, ne dit pas autre chose en affirmant que le traitement d’Ashley est « une solution pharmacologique à un échec social ».
(1) G. Durand, « De la médecine des désirs »,in L’autonomie à l’épreuve du soin, G. Durand et M. Jean (dir.), Editions Nouvelles Cécile Defaut, à paraître en 2015.
Anne Le Pennec, Journaliste scientifique
Illustration principale : Tableau Salvador Dali