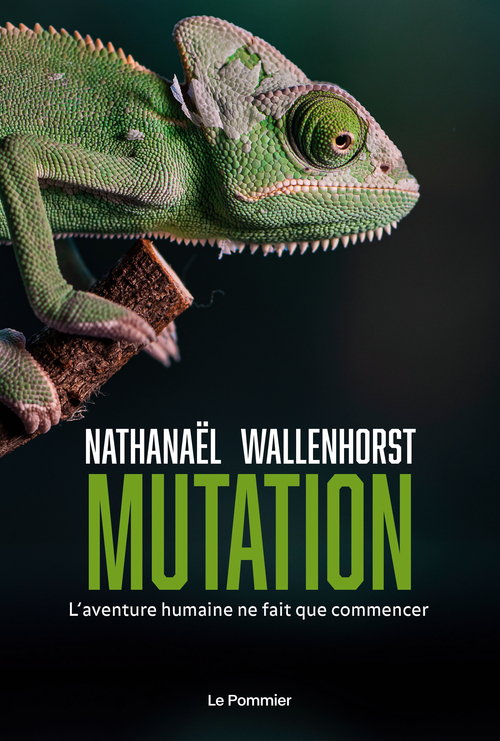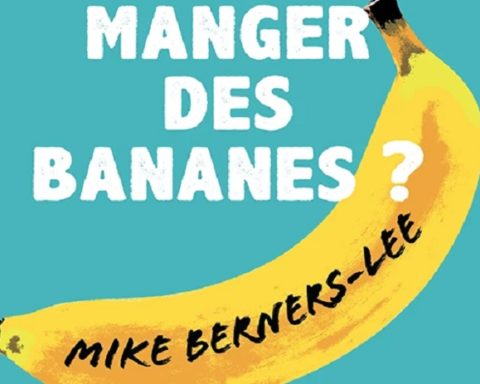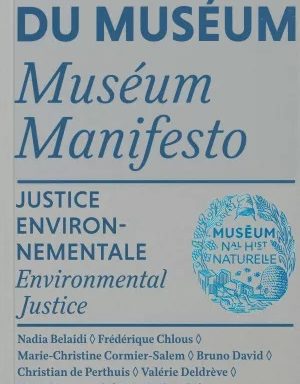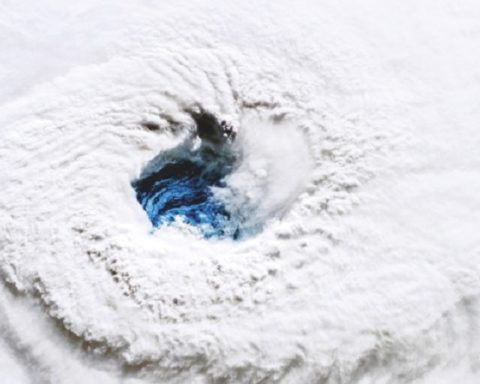En plein vol – Vivre et mourir au seuil de l’extinction, de Thom van Dooren – Préface de Vinciane Despret – Editions Wildproject, 8 octobre 2021 – 400 pages
En plein vol – Vivre et mourir au seuil de l’extinction, de Thom van Dooren – Préface de Vinciane Despret – Editions Wildproject, 8 octobre 2021 – 400 pages
Les albatros sont en voie d’extinction à cause du plastique, les vautours indiens à cause des médicaments, les manchots pygmées à cause de l’urbanisation, les corneilles hawaïennes à cause de la déforestation, et les dernières grues blanches vivent désormais en captivité.
Mais qui sont ces oiseaux qui disparaissent ?
À travers cinq espèces, le philosophe de terrain Thom van Dooren propose une plongée au cœur des vies des oiseaux qui subissent les effets de nos modes de vie destructeurs. Cette étude pédagogique et sensible explore tout ce qui est perdu lorsqu’une forme de vie disparaît du monde – et comment les humains y sont impliqués en retour.
Un des fondateurs du champ émergent des « études de l’extinction », Thom van Dooren met les réflexions éthiques en discussion avec les sciences naturelles, déployant ainsi une approche intime de la perte, et de ce que signifie le fait de survivre aux portes de l’oubli.
Les espèces n’y sont plus des entités abstraites aux noms latins, mais deviennent des personnages à part entière, imbriqués dans des modes de vie complexes et précaires, qui engagent notre sens des responsabilités envers les autres dans un monde en mutation rapide.
Plusieurs raisons nous ont amené à publier En plein vol, qui trouve d’emblée une place centrale dans notre catalogue. Publié en 2014, cet ouvrage a été acclamé par la communauté des humanités écologiques, et il a inspiré nombre de penseuses et de penseurs du monde entier. Il était donc temps de le rendre disponible en français dans la collection « Domaine sauvage », qui rassemble depuis 2009 des ouvrages fondateurs de la pensée écologiste.
Dans le même esprit que Les Diplomates de Baptiste Morizot, ce livre de « philosophie de terrain » croise écologie, éthologie et narration, dans un genre cher à Wildproject. En nous immergeant dans les mondes multiples des oiseaux, En plein vol propose une méditation riche et prometteuse sur la nécessaire « reconfiguration écologique de nos récits » – un thème désormais central pour nous. Depuis Printemps silencieux de Rachel Carson, et à en juger par l’importance des ornithologues (y compris amateurs) dans la longue histoire du mouvement écologiste, les oiseaux occupent une place de choix dans notre rapport aux mondes vivants. Revendiquant l’héritage direct de l’ethnologue Deborah Bird Rose et de la philosophe Val Plumwood (deux autrices majeures de l’écoféminisme), Thom van Dooren participe à ouvrir un nouveau champ de recherche au sein de l’écologie qui nous semble juste et nécessaire : les « extinction studies » – études sur l’extinction. D’un point de vue écologique, peu d’histoires paraissent donc autant « d’actualité » que celles qui composent En plein vol. »
Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner, éditeurs.
Pour Anna Tsing, anthropologue, ce livre est « Envoûtant, beau et important : En plein vol est extraordinaire. Il s’agit d’un récit ethnographique à son meilleur et il porte les sciences humaines de l’environnement vers de nouveaux sommets. Vous ne regarderez plus jamais un oiseau de la même façon. »
Quant à Vinciane Despret, philosophe, il s’agit d’ « un livre magnifique, sensible et merveilleusement intelligent qui inspire vie et curiosité. Van Dooren nous apprend que le fait de s’intéresser passionnément aux autres peut être une arme de résistance contre les forces de destruction. »
Extrait de la préface de Vinciane Despret
L’extinction, écrit Thom Van Dooren, est un sujet qui ne suscite pas beaucoup d’intérêt populaire. Et pourtant, continue-t-il, nous sommes sur une trajectoire qui nous fera perdre entre un tiers et deux tiers de toutes les espèces actuellement vivantes. Une espèce connue d’oiseaux sur huit devrait s’éteindre, 82% des espèces d’albatros sont menacées de disparition, plus de la moitié des espèces d’oiseaux qui occupaient les îles du Pacifique ont disparu du fait de la présence humaine. Un tiers des grenouilles salamandres et autres amphibiens se sont éteints. Une rapide consultation en ligne nous apprendra par ailleurs que 60 % des coraux ont disparu et qu’une recherche menée en 2017 a évalué que 40% des 177 espèces de mammifères étudiées ont perdu 80% de leur population (1). On pourrait continuer à l’infini, mentionner par exemple qu’on a observé entre 1989 et 2016 une diminution de 76% du nombre d’insectes volants. Si j’ajoute ces derniers chiffres à propos des insectes, c’est parce que justement, dans ce dernier cas, nous aurions pu, chacun d’entre nous, en percevoir les signes, saisir cette alerte sur nos pare-brises désormais immaculés (2). Ce n’est donc pas un simple problème d’éloignement géographique. Ce n’est pas non plus une question de visibilité ou d’ignorance, ces statistiques nous sont régulièrement répétées dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Il se produit à chaque instant, aujourd’hui, partout dans ce monde, une multiplicité de drames, qui vont irrémédiablement affecter tous les vivants ; mais ces drames, visiblement, ne nous touchent pas réellement au niveau de nos affects ; ces drames ne sont pas du tout, ou très mal, ou insuffisamment — si ce n’est pour quelques-uns d’entre nous, dont des scientifiques qui n’arrivent plus à trouver le sommeil — dramatisés. En d’autres termes, en l’occurrence ceux de Bruno Latour, l’extinction de masse est un « matter of fact » qui ne réussit pas à devenir un « matter of concern » (3). Nous savons ces faits, et ces faits n’arrivent pas à nous concerner. Ils ne nous affectent en apparence pas, ils ne nous engagent pas. Ces nombres et statistiques, de toute évidence et en tous cas pour la plupart d’entre nous, comme on l’exprime familièrement, ne nous disent rien (4).
Et c’est bien ce que je souhaitais faire sentir en commençant cette préface avec ces chiffres, en prenant d’ailleurs délibérément le risque, de voir la lectrice ou le lecteur refermer le livre avec un soupir ennuyé. Je voulais faire sentir cet ennui, susciter ce sentiment d’indifférence, parce qu’il me permettra, je l’espère, de faire sentir en quoi ce livre importe, en quoi un autre « faire sentir » va être mis à l’œuvre tout au long de récits qui ouvrent à tout autre chose, à d’autres histoires et à d’autres affects : ce livre va nous faire sentir ce qui est en train d’être perdu. Qu’est ce qui est perdu lorsqu’une espèce, une lignée évolutive, une manière de vivre, une forme de vie ou une forme de la vie disparaît du monde ? Ou, plus précisément, lorsqu’une forme de vie se disloque, s’abîme, s’appauvrit, s’éteint ? — car l’extinction, nous rappelle Thom Van Dooren, n’est pas quelque chose « qui commence, se produit rapidement, puis se termine », c’est un lent « effilochage de modes de vie intimement enchevêtrées ». Qu’est ce qui arrive dans ces effilochages ? Qu’est ce qui s’y vit, qu’est ce qui s’y perd ? Et surtout, qui perd quoi et comment ? (5)
Je me souviens du sentiment de malaise éprouvé il y a quelques années à la lecture du texte, au demeurant très beau, de l’écologue Aldo Leopold à propos de la disparition du pigeon migrateur (également appelé Ectopistes). Pour rappel, le dernier pigeon migrateur avait été abattu par le dernier chasseur américain de pigeon migrateur, en septembre 1899, à Babcock, dans le Wisconsin. Restaient encore ce qu’on appelle deux « spécimens » au zoo de Cincinnati, en Ohio. Martha, la dernière, finit par mourir sans laisser de descendants, le 1er septembre 1914. Dans un parc du Wisconsin un monument dédié à la mémoire des Ectopistes sera inauguré en 1947. Aldo Leopold écrit : « Nous pleurons parce qu’aucun homme vivant ne verra plus l’ouragan d’une phalange d’oiseaux victorieuse ouvrir la route du printemps dans le ciel de mars et chasser l’hiver des bois et des prairies du Wisconsin ». J’ai été touchée par le fait que Leopold puisse à la fois évoquer le chagrin des humains et la beauté de ce qui avait été perdu, qu’il honore cette manière unique d’être au monde qu’avaient inventée les pigeons migrateurs dont les vols si nombreux pouvaient éclipser le soleil. Mais je ne suis pas arrivée à effacer le malaise qui m’a saisie en lisant ce qu’il ajoute quelques lignes plus loin : « de manière tout à fait nouvelle, une espèce porte le deuil d’une autre » (6). Sans doute Leopold n’a-t-il pu se départir de ce vieux reste d’exceptionnalisme qui le conduit à penser que nous, animaux humains, serions les seuls à savoir ce que veut dire mourir et à en éprouver de la peine — cet exceptionnalisme dont Thom Van Dooren nous rappelle qu’il « nous tient à l’écart du reste du monde et, à ce titre, participe de notre incapacité à être affecté par les pertes incroyables propres à cette période d’extinction et donc à pleurer la mort en cours des espèces ». Et c’était bien là une des difficultés de la proposition de Leopold : elle réaffirme notre position d’écart par rapport aux autres vivants, assez paradoxalement d’ailleurs, puisqu’elle nous propose de pleurer d’autres êtres sous le motif d’une certaine fraternité (7). Mais, c’est l’autre difficulté qui m’apparaît à présent en lisant Thom : cette proposition de pleurer une espèce disparue dans le régime du deuil barre la route à une autre possibilité, celle de prendre également en considération ceux qui sont en train de disparaître, cette mort en cours qui n’appelle, du fait qu’elle est en cours, aucun deuil ni aucune nostalgie. Alors que cette possibilité, celle d’étendre le chagrin à ceux qui perdent leur monde, ceux dont la vie s’effiloche, pourrait convoquer bien d’autres affects qu’il nous appartiendrait alors d’apprendre à cultiver (8). Pleurer ceux qui ne sont plus sans se soucier de ceux dont le monde s’effondre, ceux qui se tiennent au seuil de la non-existence, relève alors bien plus d’un sentiment commode (sans réelle obligation) de culpabilité que de responsabilité (9). Ce n’est pas la même chose, et le rapport de ces sentiments aux conséquences est dramatiquement différent. Enfin, l’affirmation de Leopold, en nous érigeant comme les seuls à avoir du chagrin, évacue complètement de la scène la possibilité même de penser que les pigeons migrateurs, eux aussi, ont vécu la perte de leurs compagnons ; elle oblitère le désarroi qu’ils ont pu éprouver de les voir disparaître, d’être de moins en moins nombreux, de ne plus connaître la joie ou l’exaltation de cet ouragan d’une phalange d’oiseaux victorieuse ouvrant la route du printemps. Et qui dira la tristesse ou la solitude de Martha ? Il serait toutefois injuste de ma part de ne pas mentionner cet autre passage du même texte, très rarement cité alors que celui qui précède l’a souvent été, où Leopold évoque qu’il « existe encore des arbres qui dans leur jeunesse furent secoués par une brise vibrante. Seuls les chênes plus âgés s’en souviendront et pour finir il n’y aura plus que les collines ». Que cette phrase soit très rarement relayée ne me surprend pas outre mesure. Que les humains aient du chagrin pour des pigeons, soit. Mais que pour d’autres êtres cette disparition puisse compter sur un autre mode que celui de ce qu’on appellera les services écosystémiques ou les dépendances utilitaristes, cela a dû paraître vraiment très problématique (voire, très « anthropomorphique »). Sauf bien entendu si on se réfugie dans l’hypothèse qu’il s’est agi, de la part de Leopold, d’un moment de bravoure poétique — le propre de l’homme est sauf.
C’est là où le livre de Thom est si important et si novateur. Envisager que les pertes comptent pour d’autres que les humains, et chercher comment elles comptent, ne relève pas chez lui d’une licence poétique — et ne pourra en aucun cas être interprété comme tel. Au contraire, propose Thom, si nous voulons rompre avec cet exceptionnalisme humain dont nous commençons seulement à comprendre le rôle tragique dans la destruction du monde, il faut sérieusement, très sérieusement, poser la question, faire l’inventaire, spéculer, imaginer, enquêter (eh oui, tous ces registres doivent être convoqués) au sujet de tous ceux pour qui une perte en cours a et aura des conséquences, dans chaque situation.
Très sérieusement, c’est-à-dire non pas en général, mais dans chacun des drames concrets, là, à cet endroit, maintenant, pour tels êtres, que Thom va accompagner, documenter et décrire. Et le « plus sérieusement » revient alors à raconter des histoires. Il reprend à l’historien William Cronon la distinction entre « chronologie » et « récit ». La chronologie se constitue d’une simple liste d’événements dans l’ordre de leur apparition, le récit, en revanche, tisse les événements, les relie à un contexte, rend manifeste l’existence d’un sens, ou plutôt d’une pluralité de significations, de « faire signifier », par et pour tous ceux qui sont engagés dans ce qui devient une histoire. C’est sans doute cela le mérite essentiel des récits : « ils tiennent ouverts un éventail de points de vue, d’interprétations, de temporalités et de possibilités », c’est-à-dire une pluralité de manières dont les événements font sens, signifient pour ceux que l’histoire enrôle. Signifier peut évidemment désigner quantité de « prises » sur ces événements : le plastique « signifie » pour les albatros de l’atoll de Midway différemment de qu’il signifie pour nous, et différemment encore de ce que « signifient » les sites de nidification (et leur exclusion) pour les manchots pygmées sur le littoral de la baie de Manly, près de Sidney. Tout comme l’utilisation du médicament antiinflammatoire diclofenac signifie différemment pour les vaches indiennes dont il soulage les maux produits par de longues années de labeur et pour les vautours qui se chargent de leurs corps après leurs morts — et qui en meurent. Mais ce même terme, « signifier », au-delà de la pluralité de ses sens, rend perceptible une dimension importante : les choses ont des significations pour les vivants ou, plutôt, les vivants vont activement conférer des significations aux événements, et ces significations les affectent, les modifient et, parfois, les conduisent lentement vers l’impossibilité de vivre (dans toutes les formes que peut prendre cette impossibilité, y compris celle de simplement bien vivre). Les récits de Thom récoltent ces significations et, dans leur polyphonie, elles deviennent la texture d’un monde qu’elles enrichissent — et d’un monde qui s’appauvrit de leur disparition ou de leur effilochement. Par ces récits, ce qui signifie pour chacun de ces êtres se met à signifier pour nous, ce qui veut dire, se met à importer d’une manière inédite. C’est une des multiples réussites de ce livre. Chaque page, chaque histoire prête une attention à des aventures de vie, mesure les efforts que chacun de ces animaux – manchots pygmées, vautours, grues, albatros, corneilles d’Hawaï – accomplissent pour la préserver et pour la continuer au-delà d’eux-mêmes. « Aiguiser notre capacité à écouter les histoires alternatives et souvent ‘‘non dites’’, c’est apprendre à apprécier des pratiques plus qu’humaines de création de sens et de lieux dans un monde en voie de disparition » : apprendre à reconnaître à d’autres êtres que les seuls humains la capacité de raconter des histoires, et ce faisant, la nôtre avec eux. (10)
Qu’est-ce qu’éprouvent les corneilles d’Hawaï, ayant tout perdu de ce qui signifiait vivre et être libre dans les forêts, et ayant connu la disparition progressive de leurs compagnes et compagnons ? Et comment répondre à ce que les scientifiques ont décrit comme « le gémissement (aigu) inconsolable de l’une d’entre elles à la mort de son compagnon » ? Si Aldo Leopold nous proposait de pleurer pour la perte des pigeons migrateurs, ne nous faut-il pas plutôt songer à pleurer avec les corneilles ? Et comment prendre en considération tous les autres êtres concernés par cet « avec », et s’attacher, par exemple, à la manière dont les plantes et les arbres qui ont co-évolué avec les corneilles, qui comptaient sur elles pour disperser leurs graines pourraient faire l’expérience de cette disparition – et ce qu’elle signifie pour eux ? L’extinction, Thom y insiste, ne commence pas avec « la perte » du dernier organisme d’une espèce : « bien plus que la biodiversité au sens strict, les corneilles en deuil nous rappellent que des modes de vie entiers, des façons entières de vivre et de mourir en compagnie d’autres personnes sont en train de disparaître ». Avec elles s’éteignent des langues non-humaines, des socialités bariolées, des cultures, des chants, des manières d’habiter ou d’être attaché à un lieu, de sentir, d’être heureux d’être vivant, d’aimer, d’avoir du chagrin…
Et quand bien même voudrions-nous nous alarmer de la disparition d’espèces, pour des raisons à certains égards pragmatiquement légitimes (et, parmi ces raisons, le fait de nous opposer à l’argument qu’il y a toujours eu des extinctions, et que cela ressort des « choses qui doivent arriver »), Thom nous rappelle que ces pertes sont une rupture injuste et dramatique, qui touche chacun de ses membres, aussi indirectement lié soit-il aux créatures qui sont forcées d’interrompre le long travail de continuité d’une forme de vie entreprise dans un passé immémorial (et d’autant plus immémorial que disparaissent les mémoires incarnées de ces formes de vie). A cet égard, Thom souligne que les espèces ne sont pas le fruit du hasard, mais « qu’elles doivent être créées à chaque nouvelle génération, maintenues grâce au travail, aux compétences et à la détermination d’organismes individuels pris dans des relations réelles de procréation, d’alimentation et de soin ». Ainsi, reconnaître, faire sentir, sous le terme d’ « espèce », le sens qui insiste à désigner un « exploit intergénérationnel », une réussite incroyable accomplie depuis des millions d’années par des manchots, des albatros, des grues, des vautours, des corneilles et tant d’autres qui ont mis « leur vie au service d’une continuité générationnelle qui les dépasse ». Une espèce ne se constitue dès lors pas de membres d’une classe ou d’une typologie, mais de participants à un mode de vie continu et évolutif, fait de tous « les efforts des êtres vivants pour transmettre cette vie aux générations suivantes », pour accomplir « le travail banal de nouer les générations entre elles ». Ce sont ces efforts que Thom nous demande de prendre en considération, de sentir et d’honorer. Les efforts remarquables des albatros (et de tant d’autres) dans cette très longue période qui conduira à la création d’un couple solide, sur le temps long de l’incubation, durant les mois de va-et-vient entre la terre et la mer pour nourrir les oisillons affamés, pendant les milliers de kilomètres parcourus et avec ces énormes prises de risque. Tous ces efforts qui se trouvent réduits à néant lorsque les plastiques ingérés par les petits les conduisent à la sous nutrition, ou lorsque les coquilles, fragilisées par les polluants, ne protègent pas l’oisillon jusqu’à l’éclosion. Ce n’est pas tant de l’extinction d’une espèce dont nous nous inquiétons alors, mais, bien avant elle, et qui souvent y conduit inexorablement, de la rupture de ces continuités et de la chaîne de ces « dons intergénérationnels » qui ont inventé, façonné et transmis ces formes de vie à chaque fois merveilleuses et singulières que chaque être s’efforçait de perpétuer.
Et là, on sent, comme lectrice ou comme lecteur, que notre capacité à être sollicité.e est mise en éveil, avivée (11), que la question importe tout autrement, non plus comme un problème abstrait, ou comme un deuil patrimonial, de ceux qui font ériger des monuments repentants. Peut-être réaliserons-nous, et cela serait heureux, que cette capacité à sentir l’insistance des choses que ce livre et ces histoires ont alors ravivée, était une propension qui avait été mal nourrie, endormie, entravée. Et que les histoires que racontent les albatros, les manchots, les grues, les corneilles et les vautours, là, pour le coup, loin de nous entraîner ailleurs dans des mondes imaginaires, nourrissent l’imagination nécessaire pour sentir les formidables efforts des vivants à être et à perdurer. Ces histoires peuvent, comme l’écrit et le souhaite Thom, « changer la façon dont nous agissons dans le monde ». Ces histoires nous font à présent alors sentir que ce que ces animaux perdent, ces formes de vie et ces formes de la vie qui tissent l’étoffe du monde, c’est nous qui les perdons aussi, avec eux. Puissions-nous ne pas être les derniers à en éprouver du chagrin.
Vinciane Despret Liège, le 15 juin 2021
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_ de_l%27Holocène, consultée le 15 juin 2021.
- Jacques Tassin, Pour une écologie du sensible, 2020, Odile Jacob, p. 12.
- Voir à ce sujet la recension de Thibault De Meyer, Lectures (En ligne), Les comptes rendus. Mis en ligne le 4 avril 2015, consulté le 10 septembre 2016, url: http://lectures. revues.org/17599.
- Non qu’ils ne nous parlent pas. Ne dit-on pas des chiffres (ou des statistiques) qu’ils parlent d’eux-mêmes ? Et n’est-ce pas en réalité le problème qu’ils posent dans ce cadre ?
- Ainsi, parler en termes de « crise de la biodiversité », outre le fait que je subodore que cela produit chez beaucoup le même réflexe d’ennui que celui que je ressens lorsque l’extinction se résume à des chiffres, me donne le sentiment de me voir proposer un rapport aux autres vivants sur le modèle d’une comptabilité de petit propriétaire à qui on annonce que les avoirs de son patrimoine sont en train de fondre. Il ne s’agit pas de nier l’impérieuse nécessité de ces enquêtes, l’urgence de documenter ces pertes, mais de chercher d’autres façons de les raconter qui nous touchent et nous obligent.
- Almanach d’un Comté des sables (1949), Flammarion, 2000.
- Il écrit en effet : « Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l’origine des espèces (…). Cette découverte aurait dû nous donner, depuis le temps, un sentiment de fraternité avec les autres créatures ».
- C’est en ce sens qu’est également crucial le travail de Glenn Albrecht, s’efforçant de donner corps aux affects que requiert la catastrophe dans laquelle nous entrons, ainsi la solastalgie, qui désigne cette forme particulière de nostalgie (ou mal du pays) éprouvée par le fait d’avoir le sentiment de ne plus habiter le même monde, de l’avoir perdu, parce qu’il a été abîmé ou détruit (Glenn Albrecht, Les émotions de la terre, Éditions des Liens qui libèrent, 2020).
- Voir pour ce contraste, le dialogue avec Donna Haraway et Isabelle Stengers dans V. Despret, « La tentation de l’innocence », in Florence Caeymaex, Vinciane Despret et Julien Pieron (dir.), Habiter le trouble avec Donna Haraway, Editions Dehors, 2019, p. 326.0
- Voir à cet égard, le bel héritage de William James dont se charge Didier Debaise dans « Le récit des choses terrestres », Corps-Objet-Image, no 5, 2020.
- C’est à cette forme d’expérimentation que nous invite David Abram dans Comment la terre s’est tue. Les traducteurs de la version française de ce livre, Didier Demorcy et Isabelle Stengers, rendent cela particulièrement perceptible dans la préface qu’ils lui ont offerte. La Découverte, Paris, 2013
Thom van Dooren est professeur associé à l’université de Sydney. Il a notamment coédité (avec Deborah Bird Rose) un recueil d’études sur l’extinction : Histoires de temps, de mort et de générations (Columbia, 2017).