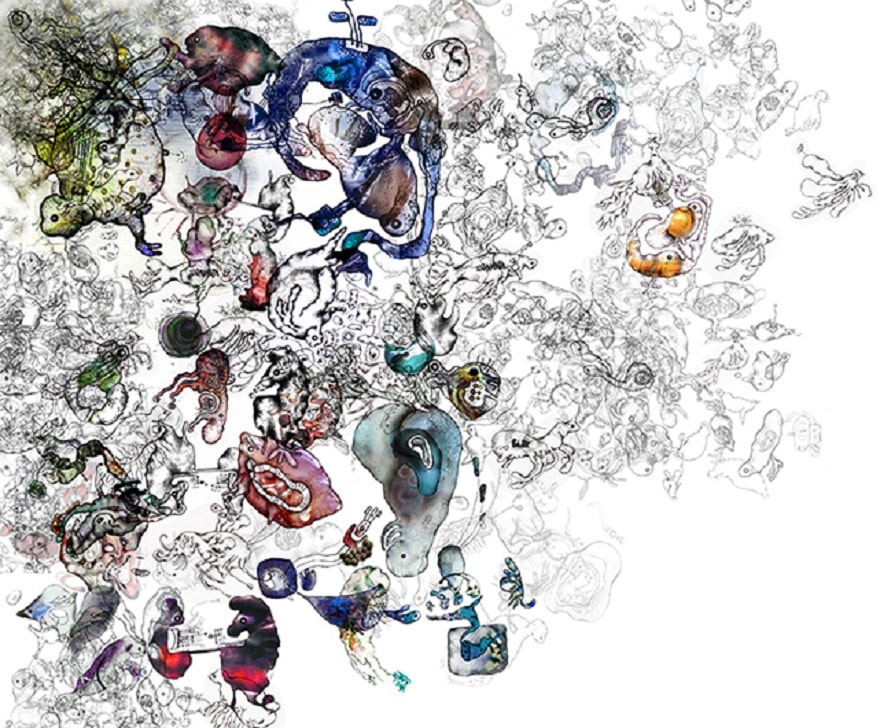La biodiversité connaît aujourd’hui l’une de ses plus importantes altérations : les taux actuels d’extinction des espèces animales sont de 100 à 1 000 fois supérieurs à ceux enregistrés à partir des données fossiles. Ils concernent tous les types d’espèces – oiseaux, reptiles, mammifères. Le rôle primordial des activités humaines dans ce phénomène est de plus en plus étayé, à tel point que certains scientifiques considèrent que nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle ère géologique, l’« anthropocène ».
Si cette altération majeure est généralement étudiée sous l’angle de ses impacts écologiques, elle intéresse également le domaine de la santé, en particulier les maladies infectieuses causées par des agents pathogènes (en particulier les virus et les bactéries). Près de 75 % de ces maladies infectieuses émergentes chez l’homme sont en effet partagés avec des espèces animales sauvages, comme les oiseaux pour le virus de la fièvre du Nil occidental ou les rongeurs pour la maladie de Lyme, une zoonose causée par la bactérie Borrelia burgdorferi.
Nombre de ces agents infectieux, dits « zoonotiques », utilisent de multiples espèces pour leur transmission. Or les bouleversements observés au niveau de la diversité biologique peuvent perturber ce cycle naturel de transmission et avoir de multiples conséquences sur la probabilité de leur émergence et/ou de leur niveau de transmission.
Biodiversité et « effet de dilution »
La biodiversité fournit de nombreux services aux écosystèmes, en contraignant notamment la transmission de certaines maladies infectieuses. C’est le cas de celles propagées par une espèce « vecteur », qui sont des insectes hématophages comme les moustiques ou les tiques qui se nourrissent du sang des individus.
Dans le cas où ces « repas de sang » se produisent sur un individu infecté – et appartenant à une espèce animale dite « compétente » dans la transmission du pathogène –, le vecteur se trouvera à son tour infecté. Lorsqu’il se nourrira à nouveau, il pourra alors transmettre le pathogène. Ces individus vecteurs pourront de la sorte contaminer des populations humaines, en faisant office de « pont » depuis d’autres espèces animales.
Toutes les espèces ne sont toutefois pas identiquement « compétentes » à transmettre l’agent pathogène : nombre d’entre elles peuvent ainsi être contaminées, mais sans pouvoir transmettre l’agent pathogène. Or ces espèces, appelées « cul de sac », sont d’autant plus présentes que l’écosystème dans lequel elles évoluent est riche d’une grande biodiversité. La présence de nombreuses espèces aura donc pour effet de « diluer » la transmission de l’agent pathogène. C’est ce que l’on appelle « l’effet de dilution ».
Dans un contexte de biodiversité altérée comme aujourd’hui, on a toutes les raisons de penser que ces espèces « cul de sac » disparaîtront les premières, étant généralement moins abondantes et donc plus vulnérables aux extinctions. Une perte de biodiversité pourra donc entraîner une augmentation de la transmission des pathogènes, les espèces vecteurs piquant dès lors majoritairement des animaux plus compétents à transmettre les maladies.
Cet effet de dilution s’observe concrètement, on pense ici au virus de la fièvre du Nil occidental ou à celui de la maladie de Lyme aux États-Unis. Dans ces deux cas, une diminution du nombre de personnes humaines infectées a été observée dans les zones où la biodiversité s’avère la plus dense. Le recours à l’effet de dilution sert également à agir sur certaines maladies affectant les plantes : en Chine, le développement de cultures mêlant différentes types de riz a permis de lutter contre la propagation de la rouille du riz qui ravageaient les variétés les plus économiquement intéressantes.
Un consensus scientifique encore fragile
Il faut ici souligner que cet effet de dilution fait toujours débat au sein de la communauté scientifique. La principale critique réside dans le fait que les espèces qui s’effacent en premier ne sont pas toujours les espèces « cul de sac ».
Prédire quelles espèces disparaissent en premier est particulièrement complexe ; l’effet de dilution ne peut donc être érigé en règle générale. Une récente étude, comparant un grand nombre de données écologiques et épidémiologiques récoltées au cours des dernières décennies, souligne néanmoins qu’un tel effet se rencontre dans plus de 70 % des cas étudiés.
Un autre aspect, encore peu étudié, doit également être pris en compte : à savoir que, plus il y a d’espèces animales, plus il y a d’agents pathogènes. Par conséquent, la plupart des pathogènes devraient moins se transmettre, mais il y en aura également plus. Il a toutefois été montré sur des plantes en Allemagne que le nombre total d’infections (toutes espèces de pathogènes considérées) diminue avec le nombre d’espèces, suggérant que l’effet de dilution créé par la richesse des hôtes compense le nombre de nouveaux pathogènes présents.
Il est particulièrement intéressant de se pencher aujourd’hui sur les effets sanitaires positifs de certaines mesures de protection de la biodiversité. Car si les bienfaits de la biodiversité demeurent souvent saisissables pour les décideurs publics, l’émergence de nouvelles épidémies – on pense aux virus du Chikungunya, Zika ou Ebola – ne manque pas d’interroger.
L’état actuel des connaissances scientifiques nous indique que la disparition de certaines espèces animales peut entraîner une hausse de la transmission de ces maladies et leur diffusion à grande échelle. Alors que les liens apparaissent de plus en plus imbriqués entre biodiversité et santé humaine, la gestion raisonnée de nos ressources s’avère plus que jamais essentielle.
LIRE DANS UP’ : Biodiversité: une loi pour inverser la tendance ?
Benjamin Roche, Chargé de recherche à l’IRD , Institut de recherche pour le développement (IRD)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.