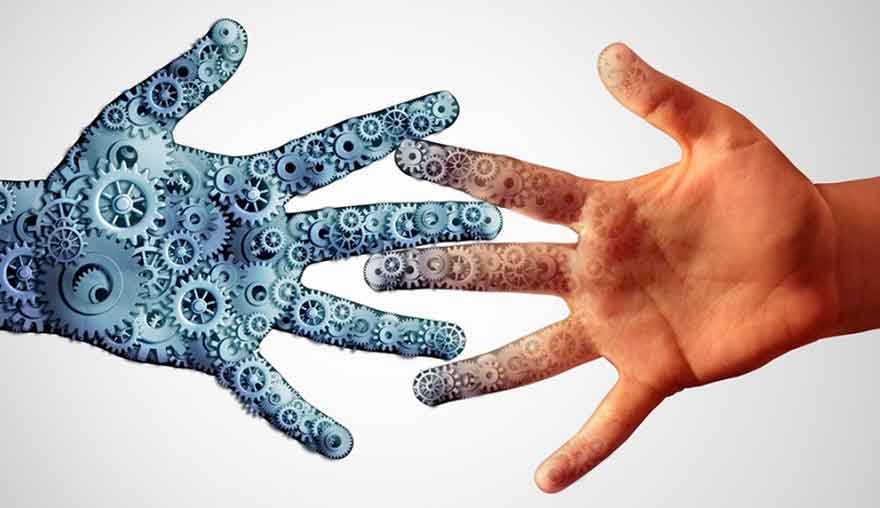La perception des risques : un enjeu pour les sciences et les technologies
par Étienne Klein

Dans un nouveau rapport, l’Académie des technologies s’est penchée sur la perception des risques induits par toute innovation. Prenant acte des controverses que certaines applications des sciences ou certaines innovations technologiques suscitent, ce texte pose la question politique du projet de la cité, de ses fins : que voulons-nous faire collectivement des savoirs et des pouvoirs que la science et la technologie nous donnent ?
La devise de l’Académie des technologies est : « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé. »
Cet énoncé tout en équilibre invite à réfléchir sur l’évolution des relations entre sciences, technologies et société au regard de la perception des risques induits par toute innovation. Il s’agit d’un enjeu de communication, bien sûr, mais pas seulement : en travaillant et en explicitant le sens qu’elle donne à sa devise, l’Académie se donne de surcroît les moyens de la faire vivre, de l’illustrer concrètement, l’exemplifier à chaque fois qu’elle émet un avis ou une recommandation.
Il faut toutefois être conscient que cette réflexion est également un défi, car le mot progrès est de moins en moins fréquemment utilisé, et a même quasiment disparu des discours publics. Il s’y trouve remplacé par le mot « innovation », qui n’est pourtant pas son synonyme. Et quand persiste l’emploi du mot progrès, c’est en général pour lui reprocher de n’être ni raisonné, ni choisi, ni partagé…
Au travers de toutes les controverses que certaines applications des sciences ou certaines innovations technologiques suscitent, les avancées de la science et surtout de la technique ne sont plus systématiquement perçues comme des facteurs de progrès.
Plantes OGM, antennes des téléphones mobiles, nanotechnologies… L’expertise scientifique est désormais suspectée d’être partisane, soumise à des conflits d’intérêts… Les catastrophes chimiques, nucléaires, écologiques et sanitaires qui, au cours du siècle précédent, ont porté un coup sévère au prestige des sciences et des technologies, ne sont bien sûr pas pour rien dans la défiance dont celles-ci sont aujourd’hui l’objet.
Dans ce nouveau contexte, les scientifiques – les ingénieurs comme les chercheurs – sont sommés d’éviter à tout prix non seulement la catastrophe, mais également l’ombre de toute catastrophe possible. Et c’est ainsi que le discours sur la catastrophe en vient à acquérir un pouvoir réel, en même temps qu’une véritable légitimité médiatique, même si la catastrophe en question demeure purement fictionnelle.
Or, lorsque certaines solutions thérapeutiques, énergétiques ou agronomiques sont empêchées par l’expression de ces craintes, qui est en mesure d’évaluer précisément les divers dommages qu’occasionnera cette interruption de « l’arborescence technologique » ? Le désir de précaution est certes légitime, à condition qu’il ne s’amplifie pas au point de « tuer dans l’œuf » des sources d’espoir, concluent les auteurs du rapport, qui appellent à prendre en compte aussi, dans toute décision politique, le coût de l’inaction.
Certains disent que les sciences et les technologies vont nous sauver tandis que d’autres clament qu’elles nous mènent tout droit à la catastrophe. Les avis contemporains sur ces questions ne semblent guère donner dans la nuance.
Le prestige de la Science avec un grand S a longtemps tenu au fait qu’on lui conférait le pouvoir symbolique de proposer un point de vue surplombant le monde : assise sur une sorte de refuge neutre et haut placé, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel, près de la vérité et hors de l’humain. Mais cette image est aujourd’hui difficile à défendre. La science n’est plus un nuage lévitant calmement au-dessus de nos têtes. Elle pleut littéralement sur nous : elle a mille et une retombées pratiques, diversement connotées, qui vont de l’informatique à la bombe atomique en passant par les vaccins, les OGM et les lasers. Ici, ce qu’elle fait rassure, là, ce qu’elle annonce angoisse. Mais une tendance générale se dessine : tout se passe désormais comme si les
avancées accomplies dans l’étendue des savoirs scientifiques ou la puissance des techniques devaient se payer, chaque fois, de nouveaux risques, ou de risques accrus – d’ordre sanitaire, environnemental, ou encore symbolique – qui alimentent l’inquiétude et la défiance.
Les sciences se développent au sein de la société et non au-dessus d’elle, elles s’y montrent essentiellement par le biais des multiples transformations qu’elles induisent, notamment dans la vie quotidienne.
Or personne ne pense que cette société est parfaite. Alors, qu’ils soient perplexes, critiques ou hostiles, certains citoyens interrogent les liens des sciences et des technologies avec le pouvoir, le marché, l’économie, la santé, la démocratie…
Chaque fois qu’une nouvelle possibilité technologique se présente, ce sont deux logiques, presque deux métaphysiques, qui s’affrontent : l’une se réduit au calcul comparatif des coûts et des bénéfices (c’est celle des opérateurs, incités à innover pour être compétitifs); l’autre, attentive aux dommages que pourrait provoquer une telle réduction, cherche à reconstruire une approche du monde où la rationalité, comprise comme ce qui est raisonnable, imposerait des limites aux conclusions des calculs pour prendre en compte d’autres considérations, plus éthiques, plus qualitatives ou plus indirectes.
Mais si les sciences, désormais entourées d’un vaste halo technologique et économique, sont insérées pleinement dans la société, elles n’y occupent pas tout l’espace. Leur place ressemble à celle d’un aquarium dans un appartement. Les « poissons » qui vivent dans l’aquarium (c’est-à-dire les scientifiques, qui voudront bien nous pardonner cette analogie) ne saisissent bien ni la forme extérieure de leur bocal ni l’effet global que celui-ci produit sur le décor. Quant aux occupants de l’appartement (les citoyens), ils ne perçoivent pas toujours ce qui peut motiver et piloter l’incessant mouvement des poissons : des préjugés existent de part et d’autre, qui diffractent les appréciations. Les sciences ne communiquent pas bien avec le tout qui les contient, et réciproquement. Certains antagonismes sont facilement repérables. Les scientifiques, en général, aiment la Science, admirent ses conquêtes et honorent ses génies, et surtout ils savent à quel point elle peut s’éloigner de l’opinion commune. Le public, lui, la voit avec d’autres yeux et sous d’autres angles, et la juge avec d’autres critères : il considère plutôt ses impacts sur la société, l’environnement et le travail ; il constate également son intrication à l’économie qu’elle contribue à bouleverser ; il évalue la tonalité générale qu’elle donne à ses humeurs, à ses pensées, à ses jugements et aussi, bien sûr, à ses conditions de vie.
Or, ces deux façons de regarder et de juger la science ne semblent plus bien s’accorder l’une avec l’autre.
Que faire pour améliorer les choses ? Certains disent qu’il suffirait de rendre la science plus transparente.
Ils proposent en somme d’astiquer les vitres de l’aquarium (S’organisent donc des journées portes ouvertes). D’autres affirment que c’est l’eau qui est sale et qu’il conviendrait de la changer de toute urgence (il est procédé à des réorganisations, à la mise en place des comités d’éthique). D’autres encore jurent qu’il faudrait plutôt donner la parole aux poissons (les chercheurs sont envoyés dans les classes des écoles et lycées, sur la place publique, à la radio et même à la télévision). D’autres enfin disent que les poissons ont de sérieux problèmes d’ouïe et qu’ils devraient faire l’effort de mieux entendre les citoyens (des « comités citoyens » sont installés pour éclairer les décideurs).
Finalement, au travers de toutes les controverses que certaines applications des sciences ou certaines innovations technologiques suscitent, ce n’est rien de moins que la question politique du projet de la cité, de ses fins, qui se trouve aujourd’hui posée : que voulons-nous faire socialement des savoirs et des pouvoirs que la science nous donne ? Les utiliser tous, par principe et au nom d’une certaine conception du progrès, ou les choisir, faire du cas par cas ? L’enjeu est crucial dans un monde traversé de tensions et de conflits dont certains touchent précisément aux conséquences du développement technologique. N’étant plus systématiquement perçues comme des facteurs de progrès, les avancées de la science et surtout de la technique sont de plus en plus questionnées. En particulier, elles n’apparaissent plus enchâssées dans une philosophie de l’histoire qu’il suffirait d’invoquer pour leur donner à la fois un sens et une justification. D’où une méfiance accrue vis-à-vis des détenteurs du savoir et des acteurs de la science (notamment institutionnels), soupçonnés d’accroître les périls et d’élargir le spectre des risques. D’une façon qui semble inéluctable, l’idée d’une absence de maîtrise de l’innovation en vient à remplacer l’idée d’un progrès qui serait toujours positif. Et c’est ainsi que l’incertitude a pu imprégner la relation entre la société et le monde
scientifique et technique.
Cette situation n’est en réalité pas spécialement nouvelle : à bien regarder en arrière, il apparaît que chaque fois que les sciences ou les techniques nous ont permis d’agir librement sur des aspects de la réalité qui s’imposaient jusqu’alors à nous comme un destin, l’angoisse de commettre un sacrilège et la peur de sortir des contours de notre nature se sont exprimées de manière spectaculaire : ainsi quand Galilée ouvrait à l’intelligibilité d’un univers où les mêmes lois valaient sur la terre comme au ciel ; ou quand Darwin inscrivit l’homme dans la chaîne de l’évolution des espèces ; a fortiori quand, aujourd’hui, le génie génétique, la procréation médicalement assistée, les nanotechnologies ou la biologie de synthèse nous permettent d’obtenir de la vie biologique des effets dont elle paraissait incapable.
La connaissance scientifique a ceci de paradoxal qu’elle ouvre des options tout en produisant de l’incertitude, une incertitude d’un type très spécial : nous ne pouvons pas savoir grâce à nos seules connaissances scientifiques ce que nous devons faire d’elles. Par exemple, nos connaissances en
biologie nous permettent de savoir comment produire des OGM, mais elles ne nous disent pas si nous devons le faire ou non. Depuis que l’idée de progrès s’est relativisée, cela devient affaire de valeurs qui s’affrontent et non plus de principes, que ceux-ci soient éthiques ou normatifs. Or, les valeurs sont en général moins universelles que les principes (la valeur d’une valeur n’est pas un absolu puisqu’elle dépend de ses évaluateurs), de sorte que plus les principes reculent, plus les valeurs tendent à s’exhiber et à se combattre.
C’est pourquoi les décisions en matière de technosciences sont devenues si difficiles à prendre.
Elles le sont d’autant plus que nous avons compris de surcroît que nous ne pouvons pas connaître à l’avance toutes les conséquences de nos actes : « L’homme sait assez souvent ce qu’il fait », avertissait Paul Valéry, « mais il ne sait jamais ce que fait ce qu’il fait. » D’où une sorte de réflexe collectif qui nous conduit désormais à valoriser l’incertitude comme défiance à l’égard de ce que l’on sait, et aussi de ce que l’on fait.
Toute innovation importante, ou de rupture, est désormais très souvent interrogée pour elle-même, et non plus en fonction d’un horizon plus général, configuré à l’avance, qu’elle permettrait d’atteindre ou d’entrevoir.
Cette évolution soumet désormais les technologies à deux forces antagonistes. La première de ces forces est l’agir technologique lui-même, qui diffuse dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cette intrusion est même si intense que les technologies semblent transcender la dimension de l’action individuelle de chacun d’entre nous, et même celle de l’action collective. La fonction anthropologique de la technique devient ainsi celle d’une nouvelle divinité, d’un « sacré » non-religieux, mais qui posséderaittoutes les caractéristiques d’un dieu tout-puissant.
La seconde de ces forces, opposée à la première, est une résistance plus ou moins diffuse, parfois organisée, à cette affluence-influence croissante des objets technologiques. Se manifeste notamment la crainte que nous allions trop vite vers l’inconnu ou cédions à la démesure.
Dans ce nouveau contexte, les scientifiques (les ingénieurs comme les chercheurs) sont sommés d’éviter à tout prix non seulement la catastrophe, mais également l’ombre de toute catastrophe possible.
Et c’est ainsi que le discours sur la catastrophe en vient à acquérir un pouvoir réel, en même temps qu’une véritable légitimité médiatique, même si la catastrophe en question demeure purement fictionnelle.
Tout objet paraît bon en tout cas pour fixer cette angoisse : les plantes OGM, les antennes des téléphones mobiles, les nanotechnologies… L’expertise scientifique est désormais partout suspecte, voire désavouée comme partisane, soumise à des conflits d’intérêts insurmontables. Les épisodes tragiques n’ont pas manqué pour susciter cette méfiance : « affaire du sang contaminé », « vache folle »…
En 2010, les vicissitudes du débat national sur la gouvernance des nanotechnologies, dont la plupart des sessions ont été perturbées par des groupes d’opposants, ont fait apparaître la profondeur du mal.
Les chercheurs qui travaillaient sur ce sujet étaient soupçonnés de ne pas être impartiaux au motif qu’ils étaient nécessairement financés par des industriels.
La seule expertise vraiment « indépendante » serait par conséquent celle des militants associatifs, qui n’ont généralement pas eu de contacts avec cette recherche. Ainsi en est-on venu à inventer la notion oxymorique d’« expertise ignorante »…
Gérald Bronner et Étienne Klein
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents
Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments