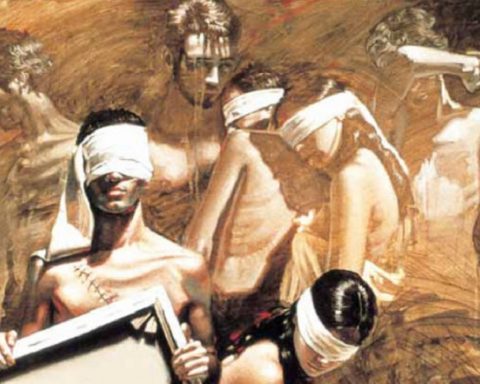En retraçant les différentes étapes de son parcours intellectuel et de ses livres, le philosophe Jean-Pierre Dupuy explique comment la question climatique l’a conduit à renouer avec l’œuvre d’Ivan Illich, aux côtés duquel il développa ses premiers travaux. Les défis environnementaux qui se profilent ainsi que son parcours philosophique original conduisent ainsi Jean-Pierre Dupuy à proposer de penser la technique dans les termes d’un « catastrophisme éclairé » paradoxal mais peut-être indispensable. UP’ retranscrit ainsi cet entretien paru en son temps dans la revue Esprit, d’une actualité incroyable…
Esprit : LA CRISE énergétique alimente de nombreux débats et inquiétudes, allant jusqu’à des scénarios catastrophes. Quels sont les différents argumentaires en présence ? Comment évaluez-vous cette question des réserves énergétiques ?
 Jean-Pierre Dupuy : Oui, notre monde va droit à la catastrophe, j’en ai l’intime conviction. Le chemin sur lequel s’avance l’humanité est suicidaire. Je parle de « la » catastrophe au singulier, non pour désigner un événement unique, mais un système de discontinuités, de franchissements de seuils critiques, de ruptures, de changements structurels radicaux qui s’alimenteront les uns les autres, pour frapper de plein fouet, avec une violence inouïe, les générations montantes. Mon cœur se serre lorsque je pense à l’avenir de mes enfants et de leurs propres enfants, qui ne sont pas encore nés. Ceux qui espèrent que le XXIe siècle échappera aux horreurs qu’a produites le XXe ont sans doute oublié que l’acte inaugural, daté du 11 septembre 2001, en fut un événement d’une brutalité inconcevable. Ils croient sans doute que la science et la technique nous sortiront d’affaire comme elles l’ont toujours fait dans le passé.
Jean-Pierre Dupuy : Oui, notre monde va droit à la catastrophe, j’en ai l’intime conviction. Le chemin sur lequel s’avance l’humanité est suicidaire. Je parle de « la » catastrophe au singulier, non pour désigner un événement unique, mais un système de discontinuités, de franchissements de seuils critiques, de ruptures, de changements structurels radicaux qui s’alimenteront les uns les autres, pour frapper de plein fouet, avec une violence inouïe, les générations montantes. Mon cœur se serre lorsque je pense à l’avenir de mes enfants et de leurs propres enfants, qui ne sont pas encore nés. Ceux qui espèrent que le XXIe siècle échappera aux horreurs qu’a produites le XXe ont sans doute oublié que l’acte inaugural, daté du 11 septembre 2001, en fut un événement d’une brutalité inconcevable. Ils croient sans doute que la science et la technique nous sortiront d’affaire comme elles l’ont toujours fait dans le passé.
Quand j’étais petit, on me racontait dans la classe d’instruction civique que tous les malheurs de l’humanité venaient de ce que le progrès de la science ne s’était pas accompagné d’un progrès parallèle de la sagesse humaine. La science était pure, mais les hommes restaient mauvais. Quelle naïveté !
 Je dois à Ivan Illich d’avoir compris que l’humanité a toujours dû se garder de trois types de menaces, et non pas simplement de deux – les deux auxquelles on pense d’abord : la force de la nature et la violence des hommes ; les tremblements de terre qui effondrent les cités glorieuses et la barbarie de la guerre qui massacre, mutile, viole leurs habitants. C’est en apprenant à mieux connaître la nature que les hommes ont réussi partiellement à la dompter ; c’est en devenant plus lucides sur les mécanismes de la haine et de la vengeance qu’ils ont compris que l’on peut s’entendre avec ses ennemis et qu’ils ont bâti les civilisations. Mais il existe un troisième front sur lequel il est beaucoup plus difficile de se battre, car l’ennemi, c’est nous-mêmes. Il a nos propres traits, mais nous ne le reconnaissons pas et tantôt nous le rabattons du côté de la nature, tantôt nous en faisons une Némésis haineuse et vengeresse. Le mal qui nous fond sur la tête depuis ce troisième front est la contrepartie de notre faculté d’agir, c’est-à-dire de déclencher des processus irréversibles et qui n’ont pas de fin, lesquels peuvent se retourner contre nous et prendre la forme de puissances hostiles qui nous détruisent.
Je dois à Ivan Illich d’avoir compris que l’humanité a toujours dû se garder de trois types de menaces, et non pas simplement de deux – les deux auxquelles on pense d’abord : la force de la nature et la violence des hommes ; les tremblements de terre qui effondrent les cités glorieuses et la barbarie de la guerre qui massacre, mutile, viole leurs habitants. C’est en apprenant à mieux connaître la nature que les hommes ont réussi partiellement à la dompter ; c’est en devenant plus lucides sur les mécanismes de la haine et de la vengeance qu’ils ont compris que l’on peut s’entendre avec ses ennemis et qu’ils ont bâti les civilisations. Mais il existe un troisième front sur lequel il est beaucoup plus difficile de se battre, car l’ennemi, c’est nous-mêmes. Il a nos propres traits, mais nous ne le reconnaissons pas et tantôt nous le rabattons du côté de la nature, tantôt nous en faisons une Némésis haineuse et vengeresse. Le mal qui nous fond sur la tête depuis ce troisième front est la contrepartie de notre faculté d’agir, c’est-à-dire de déclencher des processus irréversibles et qui n’ont pas de fin, lesquels peuvent se retourner contre nous et prendre la forme de puissances hostiles qui nous détruisent.
Grand lecteur de Hannah Arendt, qu’il connaissait personnellement, Illich savait bien que cette faculté s’exerce d’abord dans le réseau des relations humaines. L’action et la parole engendrent des histoires dont nul ne peut se dire l’auteur et qui connaissent parfois, voire souvent, un dénouement tragique. De cette expérience primordiale de l’autonomisation de l’action par rapport aux intentions des acteurs sont probablement nés le sacré, la tragédie, la religion et la politique – autant de dispositifs symboliques et réels susceptibles de maintenir dans des limites cette capacité d’agir.
Le fait totalement inédit qui caractérise nos sociétés fondées sur la science et la technique est que nous sommes désormais capables de déclencher de tels processus dans et sur la nature elle-même. Avec une prescience extraordinaire, Hannah Arendt analysait dès 1958 cette mutation de l’action dans son ouvrage majeur Human Condition (1).
 Les sécheresses, cyclones et autres tsunamis de demain, ou tout simplement le temps qu’il fera, ce temps qui depuis toujours sert de métonymie à la nature, seront les produits de nos actions. Nous ne les aurons pas faits, au sens de fabriqués, car l’activité de fabrication (poiesis pour les Grecs), contrairement à l’action (praxis), a non seulement un commencement mais aussi une fin, dans les deux sens du terme : but et terminaison. Ils seront les produits inattendus des processus irréversibles que nous aurons déclenchés, souvent sans le vouloir ni le savoir.
Les sécheresses, cyclones et autres tsunamis de demain, ou tout simplement le temps qu’il fera, ce temps qui depuis toujours sert de métonymie à la nature, seront les produits de nos actions. Nous ne les aurons pas faits, au sens de fabriqués, car l’activité de fabrication (poiesis pour les Grecs), contrairement à l’action (praxis), a non seulement un commencement mais aussi une fin, dans les deux sens du terme : but et terminaison. Ils seront les produits inattendus des processus irréversibles que nous aurons déclenchés, souvent sans le vouloir ni le savoir.
La philosophie politique française est pour l’essentiel restée étrangère à cette mutation de l’action. Depuis Sartre au moins, le bon intellectuel hexagonal non seulement ne connaît rien à la physique ni à la chimie, est parfaitement ignorant des principes de fonctionnement d’une centrale nucléaire ou d’un ordinateur, ne comprend rien à la théorie économique, mais il ne lui déplaît pas de s’en vanter ! Cette inculture crasse le condamne désormais à l’impuissance. Toutes les questions qui font aujourd’hui les gros titres du débat intellectuel et politique doivent être posées et traitées à nouveaux frais, dans le cadre d’une philosophie morale et politique qui donne à la nature et à la technique une place centrale.
Dans l’actualité, la question de l’immigration occupe à juste titre les esprits. On réfléchit aux critères qui vont nous permettre d’atteindre un optimum de population immigrée sur notre territoire. Comme les baigneurs de Thaïlande qui n’ont vu qu’au dernier moment la vague gigantesque déferler sur eux, nous ne semblons pas apercevoir les centaines de millions de malheureux qui, dans un avenir proche, chassés de chez eux par la sécheresse, la montée des eaux, les ouragans ou les tempêtes, chercheront un asile chez nous, pour fuir non plus seulement des régimes d’oppression, mais des territoires que nous aurons saccagés, sans même les connaître, par notre inconséquence. Ces vagues humaines rendront dérisoires nos pauvres calculs. L’action politique doit aujourd’hui se penser dans la perspective, non plus de la révolution à accomplir, mais de la catastrophe à repousser, s’il en est encore temps.
 J’en viens à votre question sur la crise énergétique. Je me permets de la récuser. Non, il n’y a pas de crise énergétique, l’expression est à bannir… avec la dernière énergie. La première raison est résumée de manière abrupte par la formule qui fait le titre du livre de mon collègue du Conseil général des Mines, Henri Prévot : nous souffrons de « trop de pétrole ! ». C’est lui qui m’a ouvert les yeux sur une faute grave que je commettais, à l’instar de tous ceux ou presque qui se piquent de s’intéresser à ce qu’on appelle bêtement l’« environnement » – comme si ces questions étaient autour de nous, donc extérieures à nous.
J’en viens à votre question sur la crise énergétique. Je me permets de la récuser. Non, il n’y a pas de crise énergétique, l’expression est à bannir… avec la dernière énergie. La première raison est résumée de manière abrupte par la formule qui fait le titre du livre de mon collègue du Conseil général des Mines, Henri Prévot : nous souffrons de « trop de pétrole ! ». C’est lui qui m’a ouvert les yeux sur une faute grave que je commettais, à l’instar de tous ceux ou presque qui se piquent de s’intéresser à ce qu’on appelle bêtement l’« environnement » – comme si ces questions étaient autour de nous, donc extérieures à nous.
Certes, les ressources fossiles (pétrole, gaz et charbon) s’épuisent à vue d’œil et nous n’en aurons plus bien avant la fin du siècle si les pays émergents comme la Chine, l’Inde, le Brésil s’engagent sur le même chemin que nous, comme ils le font déjà allègrement. Certes, les énergies de substitution ne sont pas au rendez-vous. Certes, on voit déjà se profiler une guerre qui sera sans merci entre les grandes puissances consommatrices, lesquelles se battront avec l’énergie du désespoir pour s’approprier qui la dernière goutte de pétrole, qui la dernière tonne de charbon. La tension sur les prix, qui pourrait dégénérer en panique, amplifiée par une crise financière majeure, se fait déjà sentir. Les économistes libéraux en tirent satisfaction, confiants qu’ils sont dans les mécanismes du marché, qui saura selon eux opérer les substitutions nécessaires : les réserves, comme par miracle, se trouveront multipliées, car il sera rentable d’exploiter des gisements difficiles d’accès, des énergies qui n’étaient pas économiques, comme le solaire ou les biocarburants, le deviendront, etc.
Eh bien, tout cela se révèle être un écran de fumée qui dissimule l’extrême gravité de la menace climatique. Je vais citer un chiffre que tout citoyen du monde, toute personne en situation de décider même à un niveau très modeste, devrait connaître et méditer. Les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ne savent pas nous dire ce que l’augmentation moyenne de la température du globe d’ici à la fin du siècle sera exactement à l’intérieur d’une fourchette qui va de 2 à 6 degrés Celsius. Il est à noter que la moitié de cette incertitude résulte de l’inconnue que représentent les politiques de réduction d’émissions des gaz à effet de serre qui seront suivies. Il y a là un cercle intéressant pour le philosophe, puisque ces politiques dépendront elles-mêmes évidemment des représentations que l’on se fera du sérieux de la menace – et ces représentations dépendent en partie de l’incertitude qui grève les prévisions. Quoi qu’il en soit, les mêmes experts nous assurent qu’au-delà de deux degrés, soit la borne basse de la fourchette, les conséquences du réchauffement climatique seront redoutables.
Je ne veux pas m’étendre sur ce sujet, car toute personne désireuse de s’informer – et il devient criminel ou fou de ne pas le faire – a le choix entre toute une série d’excellentes publications. Je veux simplement souligner ceci. Au-delà de la borne en question, le système climatique entrera dans un chaos qui fera franchir à des variables clés ce qu’on appelle des « points de basculement » (tipping points). Ces franchissements de seuils provoqueront à leur tour des phénomènes catastrophiques, lesquels amplifieront une dynamique auto-renforcée qui ressemblera à une chute dans l’abîme. Par exemple : la circulation profonde de l’Atlantique pourra s’arrêter, engendrant un refroidissement paradoxal de l’Europe ; le permafrost (la terre gelée en permanence) qui recouvre l’Antarctique, en fondant, dégagera des quantités gigantesques de méthane, l’un des plus redoutables des gaz à effet de serre ; etc. Nous ne savons pas où sont ces seuils, et lorsque nous les découvrirons, c’est que nous les aurons franchis et il sera trop tard.
J’en viens au chiffre que j’ai promis de donner : un tiers. Si nous voulons éviter le désastre irréversible que serait une augmentation de la température de trois degrés à la fin du siècle, l’humanité doit s’astreindre impérativement à ne pas extraire du sous-sol dans les deux siècles qui viennent plus du tiers du carbone qui s’y trouve accumulé, sous forme de pétrole, de gaz et de charbon. Conclusion : ce n’est pas de rareté qu’il faut parler, mais de surabondance : nous avons trois fois trop de ressources fossiles. Or, je l’ai dit, la régulation du marché relayée par la dérégulation des paniques collectives va précipiter tout le monde, tête baissée et tant pis pour les plus faibles qu’on écrase ou piétine au passage, dans une course folle à qui s’emparera des ressources ultimes. Qui, quoi, peut arrêter cette débandade ?
La priorité absolue de la menace climatique
Esprit : Comment expliquez-vous ce décalage entre l’omniprésence du débat sur les réserves énergétiques et un certain ajournement du problème environnemental ?
 Jean-Pierre Dupuy : Entre le moment où nous avons commencé ces entretiens, l’été dernier, et le moment de leur publication, donc en l’espace de six mois, les esprits ont beaucoup évolué. Des publications comme le rapport britannique Stern, des films comme La vérité qui dérange d’Al Gore, ont ébranlé les consciences, le premier en montrant qu’il en coûterait infiniment moins cher de lutter contre le réchauffement climatique que de laisser s’effondrer l’économie capitaliste sous l’effet de la dégradation de l’environnement ; le second en jouant sur les émotions et la peur. Le cœur et le porte-monnaie. Cependant j’entendais récemment le président de la République française dire que deux dangers menacent la survie de l’espèce humaine : la raréfaction des ressources fossiles et le réchauffement climatique. Si vous m’avez suivi, ce « et » constitue une faute logique. S’il y a réchauffement climatique, alors les ressources ne sont pas rares, mais surabondantes.
Jean-Pierre Dupuy : Entre le moment où nous avons commencé ces entretiens, l’été dernier, et le moment de leur publication, donc en l’espace de six mois, les esprits ont beaucoup évolué. Des publications comme le rapport britannique Stern, des films comme La vérité qui dérange d’Al Gore, ont ébranlé les consciences, le premier en montrant qu’il en coûterait infiniment moins cher de lutter contre le réchauffement climatique que de laisser s’effondrer l’économie capitaliste sous l’effet de la dégradation de l’environnement ; le second en jouant sur les émotions et la peur. Le cœur et le porte-monnaie. Cependant j’entendais récemment le président de la République française dire que deux dangers menacent la survie de l’espèce humaine : la raréfaction des ressources fossiles et le réchauffement climatique. Si vous m’avez suivi, ce « et » constitue une faute logique. S’il y a réchauffement climatique, alors les ressources ne sont pas rares, mais surabondantes.
Cela veut dire que l’opinion publique n’a pas encore pris la mesure des périls ni conscience de leur hiérarchie. Pourquoi ? Notre monde est dominé par l’économie et donc par les mouvements des prix qui anticipent les raretés futures. Mais aucun signal ne nous parvient de l’avenir catastrophique que nous prépare la mise en chaos du climat. La menace est trop abstraite. Même lorsque nous savons que la catastrophe est devant nous, nous ne croyons pas ce que nous savons.
Sur la base de nombreux exemples, un chercheur anglais a dégagé ce qu’il appelle un « principe inverse d’évaluation des risques » : la propension d’une communauté à reconnaître l’existence d’un risque serait déterminée par l’idée qu’elle se fait de l’existence de solutions. Comme les pouvoirs qui nous gouvernent, économiques et politiques, croient qu’un changement radical de nos modes de vie et un renoncement au « progrès » seraient le prix à payer pour éviter le désastre, et que cela leur paraît irréalisable, l’occultation du mal s’ensuit inévitablement.
La catastrophe n’est pas crédible. Elle n’est tenue pour possible qu’une fois réalisée, donc trop tard. C’est ce verrou que j’ai tenté de faire sauter avec mon « catastrophisme éclairé (2) ».
Esprit : Quelle solution viable pourrait donc permettre de prévenir les effets du réchauffement climatique, ou en tout cas d’y remédier ?
 Jean-Pierre Dupuy : J’attends beaucoup de la publication des travaux d’Henri Prévot (3). D’une rigueur exemplaire, ils montrent que la France peut s’engager sur un programme de division par trois des émissions de gaz à effet de serre dans les trente ou quarante ans qui viennent, qu’elle a intérêt à le faire même si elle agit seule, et cela sans dépenses excessives ni bouleversement des modes de vie. Ce « plan pour la France » implique cependant une réorientation drastique de notre appareil de production qui n’a de chance d’aboutir que si une volonté politique sans faille décide sans tarder de le mettre en œuvre (4) – ce qui ramène à la question de la formation de l’opinion publique.
Jean-Pierre Dupuy : J’attends beaucoup de la publication des travaux d’Henri Prévot (3). D’une rigueur exemplaire, ils montrent que la France peut s’engager sur un programme de division par trois des émissions de gaz à effet de serre dans les trente ou quarante ans qui viennent, qu’elle a intérêt à le faire même si elle agit seule, et cela sans dépenses excessives ni bouleversement des modes de vie. Ce « plan pour la France » implique cependant une réorientation drastique de notre appareil de production qui n’a de chance d’aboutir que si une volonté politique sans faille décide sans tarder de le mettre en œuvre (4) – ce qui ramène à la question de la formation de l’opinion publique.
Il est à noter que la démarche de Prévot se veut complètement détachée de toute considération morale ou éthique. Elle n’est guidée que par la rationalité instrumentale et l’efficacité : nous voulons survivre ? Voici les moyens nécessaires.
Prévot dénonce la confusion des genres que, selon lui, pratiquent les mouvements écologistes. Ceux-ci condamneraient la manière dont nous vivons au nom d’une morale qui leur est propre, et tenteraient d’imposer ce jugement à tous leurs concitoyens en prenant prétexte de ce que ce mode de vie nous mène droit au désastre. Réfutant cette dernière affirmation, Prévot pointe une certaine mauvaise foi écologiste.
Il est vrai que la crise environnementale peut mener droit à ce qu’André Gorz appelait l’écofascisme, un ordre moral imposé au nom de la survie. Mais ce que la dénonciation de Prévot illustre, c’est que nous ne voulons pas de la survie à n’importe quel prix, en particulier au prix du renoncement à des valeurs fondamentales telles que l’autonomie morale. C’est donc bien qu’on ne peut séparer les dimensions techniques de la survie de la question éthique.
Selon le scénario le plus probable, pris dans les rets de la compétition mondiale et de la lutte pour la survie, les peuples et leurs gouvernements n’hésiteront pas à sacrifier les valeurs les moins sacrifiables. Le XXe siècle nous démontre à l’envie que lorsqu’une société a peur et se sent menacée dans son être et sa reproduction, le vernis qui sépare l’ordre du chaos, la civilisation de la barbarie, peut facilement craquer de toutes parts. À quoi servirait à l’humanité de se sauver elle-même si elle en venait à perdre son âme ? Or la panique qui s’emparerait des peuples de la Terre s’ils découvraient trop tard que leur existence est en jeu risquerait de faire sauter tous les verrous qui empêchent la civilisation de basculer dans la barbarie. Les forces de l’esprit et les valeurs de justice seraient balayées. Il existe donc une double menace, qu’il faut analyser simultanément : la menace sur la survie et la menace sur les valeurs (5). On doit empêcher que la seconde se nourrisse de la lutte contre la première. C’est au moment même où elle comprend que sa survie est en danger que l’humanité prend conscience d’elle-même et de son unité. Il lui revient de se donner les moyens de continuer la tâche civilisatrice que son histoire a fait émerger. La reconquête du sens et de l’esprit est la chance à saisir en ce moment de crise.
Le plan Prévot rend nécessaire un recours important au nucléaire civil. C’est un bel exemple de conflit possible entre l’exigence de survie et l’exigence sur les valeurs. Car la manière dont la catastrophe de Tchernobyl a été gérée par la technocratie nucléaire mondiale fait largement douter que l’on puisse assurer la sûreté de cette forme d’énergie par des moyens qui soient compatibles avec les principes de base d’une société ouverte, démocratique et juste (6). S’il s’avérait que l’opacité, la dissimulation et le mensonge sont les conditions nécessaires de cette sûreté, l’équation énergétique et environnementale serait sans solution, à moins que l’humanité use de sa liberté de choisir un autre mode d’accomplissement que le développement matériel.
Esprit : La réponse à ces problèmes posés par la technologie sera-t-elle technologique ?
 Jean-Pierre Dupuy : Je crois que la principale menace qui pèse sur l’avenir de l’humanité est la tentation de l’orgueil. La présomption fatale, c’est de croire que la technique, qui a mis à mal les systèmes symboliques qui contenaient dans des limites les débordements toujours possibles de l’action, pourra assumer le rôle que ceux-ci jouaient lorsque la capacité d’agir ne portait que sur les relations humaines et non sur la nature. Croire cela, c’est rester prisonnier d’une conception de la technique qui voit en celle-ci une activité rationnelle, soumise à la logique instrumentale, au calcul des moyens et des fins. Mais la technique relève aujourd’hui beaucoup plus de l’action que de la fabrication. Elle-même participe de cette capacité de déclencher des processus sans retour. S’abandonner à l’optimisme scientiste qui compte uniquement sur la technique pour nous sortir des impasses où nous a mis la technique, c’est courir le risque d’engendrer des monstres qui nous dévoreront.
Jean-Pierre Dupuy : Je crois que la principale menace qui pèse sur l’avenir de l’humanité est la tentation de l’orgueil. La présomption fatale, c’est de croire que la technique, qui a mis à mal les systèmes symboliques qui contenaient dans des limites les débordements toujours possibles de l’action, pourra assumer le rôle que ceux-ci jouaient lorsque la capacité d’agir ne portait que sur les relations humaines et non sur la nature. Croire cela, c’est rester prisonnier d’une conception de la technique qui voit en celle-ci une activité rationnelle, soumise à la logique instrumentale, au calcul des moyens et des fins. Mais la technique relève aujourd’hui beaucoup plus de l’action que de la fabrication. Elle-même participe de cette capacité de déclencher des processus sans retour. S’abandonner à l’optimisme scientiste qui compte uniquement sur la technique pour nous sortir des impasses où nous a mis la technique, c’est courir le risque d’engendrer des monstres qui nous dévoreront.
Mon travail en philosophie et éthique des sciences m’a conduit à illustrer ce point fondamental sur ces technologies avancées dont on nous annonce la « convergence » : les nanotechnologies, qui manipulent la matière à l’échelle moléculaire et atomique, les biotechnologies, les technologies de l’information et les sciences cognitives. Je me suis intéressé au soubassement métaphysique et aux implications éthiques de ce nouveau paradigme à la mode, qui attire sur lui les milliards de dollars et fait déjà l’objet d’une concurrence féroce à l’échelle mondiale, d’ordre scientifique et technologique, mais aussi industriel et militaire.
La composante la plus visible du rêve nanotechnologique est de prendre le relais du bricolage qu’a constitué jusqu’ici l’évolution pour y substituer le paradigme de la conception (design). Damien Broderick, l’un des plus influents visionnaires du domaine, a dit tout le mépris que lui inspirait la nature telle que l’homme l’a trouvée : « Ne peut-on penser que des nanosystèmes, conçus par l’esprit humain, court-circuiteront toute cette errance darwinienne pour se précipiter tout droit vers le succès du design ? » Il est fascinant de voir la science américaine, qui a dû se battre de haute lutte pour chasser de l’enseignement public toute trace de créationnisme, y compris dans ses avatars les plus récents, comme l’intelligent design, retrouver par le biais du programme nanotechnologique la problématique du design, avec simplement désormais l’homme dans le rôle du démiurge.
Le philosophe pourrait se frotter les mains, se croyant en terrain connu. S’incarnerait ici le dessein que Descartes assigne à l’homme grâce au truchement de la science et de la technique : se rendre comme maître et possesseur de la nature, y compris de la nature humaine. La nature devient artificielle, l’homme se rebelle contre le donné, et, avant tout, contre tout ce qui constitue sa finitude.
Ce serait rater ce qu’il y a de profondément inédit dans les technologies actuelles. Avec les nanobiotechnologies, l’homme prend la relève des processus biologiques, il participe à la fabrication de la vie. Or celui qui veut fabriquer – en fait, créer – de la vie ne peut pas ne pas viser à reproduire sa capacité essentielle, qui est de créer à son tour du radicalement nouveau. Un autre visionnaire influent, Kevin Kelly, a eu ce mot : « Il nous a fallu longtemps pour comprendre que la puissance d’une technique était proportionnelle à son “incontrôlabilité” [out-of-controlness] intrinsèque, à sa capacité à nous surprendre en engendrant de l’inédit. En vérité, si nous n’éprouvons pas de l’inquiétude devant une technique, c’est qu’elle n’est pas assez révolutionnaire. »
Le « nano-rêve » étant en dernière instance de déclencher dans la nature des processus complexes irréversibles, l’ingénieur de demain ne sera pas un apprenti sorcier par négligence ou incompétence, mais par dessein (design). Le vrai design, aujourd’hui, n’est pas la maîtrise, mais son contraire.
Avec Illich et après lui…
Esprit : Que doit votre travail en philosophie de la technique à votre rencontre avec Ivan Illich ? Comment avez-vous collaboré avec lui avant de vous éloigner pour finalement revenir vers sa pensée avec vos travaux sur la crise climatique et les nanotechnologies ?
 Jean-Pierre Dupuy : Ma rencontre avec Ivan Illich au début des années 1970 a été décisive pour mon itinéraire intellectuel et pour ma vie tout court. Polytechnicien, membre du corps des Mines, mon destin était tout tracé : j’allais devenir un de ces grands patrons à la française, pétri de positivisme et de scientisme, ou bien un membre de la haute administration technique, animé par le souci de l’intérêt général et sûr de sa supériorité intellectuelle. Mais j’ai toujours eu une méfiance instinctive du pouvoir, fût-il occulte. Déjà rebelle, travaillé par le doute et les problèmes existentiels, j’avais décidé de devenir chercheur en sciences humaines, conservant de ma formation un fort penchant au rationalisme. Ma première recherche porta sur l’institution médicale et la consommation de soins de santé, qui déjà à l’époque échappait à tout contrôle. Le point d’application en fut le rôle que joue la prescription de médicaments dans la relation médecin-malade. J’étais jeune, mais déjà la question du rapport au corps, à la maladie, à la souffrance et à la mort me taraudait, pour des raisons qui touchent à mon expérience familiale. Le livre (7) qui consigna le résultat des recherches de mon équipe fit scandale et m’assura une certaine notoriété dont je me serais bien passé. À cette époque, Ivan Illich avait déjà publié ses travaux sur l’école, les transports et se tournait vers la médecine. Il apprit mon existence par Jean-Marie Domenach, qui nous présenta l’un à l’autre. Une forte amitié, tant intellectuelle que personnelle, en résulta, qui devait m’amener à faire plusieurs fois au cours de la décennie 1970 le voyage de Cuernavaca, cette ville-jardin (à l’époque) située à quelque 60 kilomètres au sud de Mexico où Illich avait établi son centre de rencontres. En 1975, nous travaillâmes ensemble à la rédaction de la version française de son grand livre sur la médecine, Némésis médicale. L’expropriation de la santé (8). Le chapitre trois, qui expose la théorie générale de la contreproductivité, est essentiellement de mon cru. L’Amérique latine, qui allait jouer un rôle si structurant dans ma vie, me fascinait, et le simple fait d’avoir à m’y rendre régulièrement pour rencontrer ce personnage incroyablement charismatique que fut Ivan Illich ne comptait pas pour peu, je l’avoue, dans ma dévotion.
Jean-Pierre Dupuy : Ma rencontre avec Ivan Illich au début des années 1970 a été décisive pour mon itinéraire intellectuel et pour ma vie tout court. Polytechnicien, membre du corps des Mines, mon destin était tout tracé : j’allais devenir un de ces grands patrons à la française, pétri de positivisme et de scientisme, ou bien un membre de la haute administration technique, animé par le souci de l’intérêt général et sûr de sa supériorité intellectuelle. Mais j’ai toujours eu une méfiance instinctive du pouvoir, fût-il occulte. Déjà rebelle, travaillé par le doute et les problèmes existentiels, j’avais décidé de devenir chercheur en sciences humaines, conservant de ma formation un fort penchant au rationalisme. Ma première recherche porta sur l’institution médicale et la consommation de soins de santé, qui déjà à l’époque échappait à tout contrôle. Le point d’application en fut le rôle que joue la prescription de médicaments dans la relation médecin-malade. J’étais jeune, mais déjà la question du rapport au corps, à la maladie, à la souffrance et à la mort me taraudait, pour des raisons qui touchent à mon expérience familiale. Le livre (7) qui consigna le résultat des recherches de mon équipe fit scandale et m’assura une certaine notoriété dont je me serais bien passé. À cette époque, Ivan Illich avait déjà publié ses travaux sur l’école, les transports et se tournait vers la médecine. Il apprit mon existence par Jean-Marie Domenach, qui nous présenta l’un à l’autre. Une forte amitié, tant intellectuelle que personnelle, en résulta, qui devait m’amener à faire plusieurs fois au cours de la décennie 1970 le voyage de Cuernavaca, cette ville-jardin (à l’époque) située à quelque 60 kilomètres au sud de Mexico où Illich avait établi son centre de rencontres. En 1975, nous travaillâmes ensemble à la rédaction de la version française de son grand livre sur la médecine, Némésis médicale. L’expropriation de la santé (8). Le chapitre trois, qui expose la théorie générale de la contreproductivité, est essentiellement de mon cru. L’Amérique latine, qui allait jouer un rôle si structurant dans ma vie, me fascinait, et le simple fait d’avoir à m’y rendre régulièrement pour rencontrer ce personnage incroyablement charismatique que fut Ivan Illich ne comptait pas pour peu, je l’avoue, dans ma dévotion.
Esprit m’a déjà donné plusieurs fois l’occasion de dire tout ce que je dois à Ivan Illich (9). Je voudrais me limiter ici à un thème dont l’énoncé prolonge notre conversation : l’invisibilité du mal. Ces cinq dernières années, réfléchissant philosophiquement à la question des catastrophes majeures, naturelles, industrielles ou morales, j’ai eu à solliciter la pensée de trois penseurs qui furent, comme Illich, juifs et de langue maternelle allemande : Hannah Arendt, son premier époux, Günther Anders, et celui qui les présenta l’un à l’autre, Hans Jonas. Contrairement à Illich, ce furent des philosophes professionnels, tous trois élèves de Heidegger. J’ai trouvé chez eux, surtout chez Anders, des résonances très fortes, bouleversantes même, avec Illich. C’est sans doute cela qui explique chez moi un certain retour récent à la pensée de ce dernier.
J’avançais tout à l’heure une première raison pour laquelle il est trompeur de parler de crise énergétique : nous avons trop de ressources fossiles. La seconde, c’est Illich lui-même qui la donne dans son Énergie et équité (10) : « Les propagandistes de la crise de l’énergie soulignent le problème de la pénurie de nourriture pour les esclaves producteurs d’énergie » dont les hommes croient devoir dépendre pour vivre bien. « Moi, rétorque Illich, je me demande si des hommes libres ont vraiment besoin de tels esclaves. »
Les lecteurs d’Esprit sont familiers de la critique illichienne de la contre-productivité des grandes institutions de la société industrielle. Ce qu’il faut noter, c’est qu’elle évite le piège du « moralisme » qui hérisse tant Henri Prévot. Comme lui, Illich – au moins en apparence – se retranche derrière la rationalité instrumentale et l’efficacité. Vous voulez perdre moins de temps à vous déplacer ? Renoncez, au-delà d’un certain seuil, à l’usage des transports motorisés. La santé est pour vous une valeur qui n’a pas de prix ? Détournez-vous – au-delà d’un certain seuil – de l’institution médicale. Passé ces seuils critiques – on trouve chez Illich cette notion centrale de tipping point, dans le domaine social et politique –, il est inévitable que la médecine détruise la santé, les transports immobilisent, l’éducation rende bête et les télécommunications sourd et muet. Provocations ? Non pas, si l’on définit les « valeurs d’usage » comme le fait Illich, non seulement en termes physiques, mais dans toutes leurs dimensions culturelles et symboliques. C’est en ce point que le thème de l’invisibilité du mal intervient.
Pourquoi restons-nous aveugles au fait avéré que nous consacrons, chacun d’entre nous, plus du quart de notre vie éveillée au transport, si l’on tient compte du temps que nous passons à travailler pour nous payer les moyens de déplacement ? Précisément parce que le transport industriel masque cette absurdité en substituant au temps de déplacement effectif du temps de travail. Or, même si le travail et le travel (déplacement en anglais) sont linguistiquement des doublons (11), le premier, sous sa face emploi, se trouve, dans nos calculs économiques implicites, plus du côté des avantages que de celui des coûts, plus du côté des fins que de celui des moyens. Pourquoi ne voyons-nous pas que la promesse d’immortalité que véhiculent les nanobiotechnologies est non seulement mensongère mais destructrice de ce qui fait la santé « structurelle » de l’homme ? Parce que nous n’avons pas compris que la santé, ce n’est pas seulement le « silence » des organes, c’est avant tout la capacité autonome, nourrie d’une culture et d’une tradition, de faire face à la souffrance et à la mortalité, et plus généralement à la finitude de l’homme, en leur donnant sens, en les insérant dans une histoire. Cela devient impossible lorsque, comme le clame l’un des « nano-champions », elles sont traitées comme des « problèmes » en attente d’une solution technique.
Mon travail sur Tchernobyl m’a confronté brutalement à la question de l’invisibilité du mal. L’invisibilité physique, d’abord, puisque c’est l’absence qui frappe le regard de celui qui parcourt l’immense zone contaminée qui s’étend de l’Ukraine à la Biélorussie : absence des villages rasés, des personnes déplacées ; absence de vie dans les villes qui restent debout mais sans habitants pour les vingt mille prochaines années. Et le mal, en l’occurrence les radiations, est sans saveur ni odeur.
L’invisibilité statistique, plus sournoisement, qui explique qu’entre les évaluations du nombre de morts les chiffres varient de 1 à 50 : lorsque les doses radioactives sont très étalées dans le temps et distribuées sur une vaste population, il est impossible de dire d’une quelconque personne désignée qui meurt d’un cancer ou d’une leucémie qu’elle est morte du fait de Tchernobyl. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la probabilité qu’elle avait a priori de mourir d’un cancer ou d’une leucémie a été très légèrement accrue du fait de Tchernobyl. Les dizaines de milliers de morts qu’aura selon moi causées la catastrophe ne peuvent donc être nommées. La thèse officielle consiste à en conclure qu’elles n’existent pas. C’est un crime éthique.
 Nous avons plus à craindre aujourd’hui les industriels du bien que les méchants. Cette thèse illichienne sur la déconnexion du mal par rapport aux intentions de ceux qui le commettent doit être rapprochée des analyses d’Anders et d’Arendt méditant sur Auschwitz et Hiroshima (12). Le scandale qui n’a pas fini de bouleverser les catégories qui nous servent encore à juger le monde, c’est qu’un mal immense puisse être causé par une absence de malignité ; qu’une responsabilité monstrueuse puisse aller de pair avec une absence d’intentions mauvaises. En visite à Hiroshima en 1958, Anders écrivait : « Le caractère invraisemblable de la situation est tout bonnement à couper le souffle. À l’instant même où le monde devient apocalyptique, et ce par notre faute, il offre l’image… d’un paradis habité par des meurtriers sans méchanceté et par des victimes sans haine. Nulle part il n’est trace de méchanceté, il n’y a que des décombres. »
Nous avons plus à craindre aujourd’hui les industriels du bien que les méchants. Cette thèse illichienne sur la déconnexion du mal par rapport aux intentions de ceux qui le commettent doit être rapprochée des analyses d’Anders et d’Arendt méditant sur Auschwitz et Hiroshima (12). Le scandale qui n’a pas fini de bouleverser les catégories qui nous servent encore à juger le monde, c’est qu’un mal immense puisse être causé par une absence de malignité ; qu’une responsabilité monstrueuse puisse aller de pair avec une absence d’intentions mauvaises. En visite à Hiroshima en 1958, Anders écrivait : « Le caractère invraisemblable de la situation est tout bonnement à couper le souffle. À l’instant même où le monde devient apocalyptique, et ce par notre faute, il offre l’image… d’un paradis habité par des meurtriers sans méchanceté et par des victimes sans haine. Nulle part il n’est trace de méchanceté, il n’y a que des décombres. »
Anders parle d’« aveuglement face à l’apocalypse ». L’une de ses dimensions principales est le « décalage » (Diskrepanz) entre notre capacité de produire, de fabriquer, de réaliser, de créer (herstellen) et notre capacité, ou plutôt notre incapacité, à nous représenter, à concevoir, à imaginer (vorstellen) les produits et les effets de nos fabrications. Si le savoir se réduit au savoir-faire, surenchérit Arendt, alors c’est la pensée qui est sacrifiée, et les pires horreurs deviennent possibles.
Dans son Eichmann à Jérusalem, Arendt diagnostique l’infirmité d’Eichmann comme « manque d’imagination ». Anders aura montré que ce n’est pas l’infirmité d’un homme, mais de tous les hommes, lorsque leur capacité de faire, et de détruire, devient disproportionnée à la condition humaine. Anders pronostiquait que l’homme allait être rendu « obsolète » par ses productions, et qu’il disparaîtrait accablé par le sentiment de honte de ne pas être soi-même le produit d’une fabrication, la honte d’être né et de ne pas avoir été fait. Cette « honte prométhéenne » devait fortement influencer Sartre et l’existentialisme.
La critique des sciences cognitives
Esprit : Quelles ont été les étapes successives de votre parcours philosophique au-delà ou en deçà de la philosophie de la technique ?
 Jean-Pierre Dupuy : C’est le chemin que j’ai parcouru avec Illich qui m’a fait entrer en philosophie, au prix d’une double négation : arrachement à la technocratie qui était mon destin, d’abord, grâce à Illich ; détachement par rapport à ce que je jugeais être un certain irrationalisme dans la rhétorique (mais non pas la pensée) illichienne, ensuite.
Jean-Pierre Dupuy : C’est le chemin que j’ai parcouru avec Illich qui m’a fait entrer en philosophie, au prix d’une double négation : arrachement à la technocratie qui était mon destin, d’abord, grâce à Illich ; détachement par rapport à ce que je jugeais être un certain irrationalisme dans la rhétorique (mais non pas la pensée) illichienne, ensuite.
J’ai raconté ailleurs (13) comment j’ai connu chez Illich ou par lui certains des fondateurs de la théorie des systèmes complexes à auto-organisation : Heinz von Fœrster, Henri Atlan et Francisco Varela. À l’époque, il s’agissait d’une branche marginale des sciences cognitives qui, depuis, a connu une éclatante revanche. C’est autour de ces idées que j’ai bâti avec Jean-Marie Domenach le projet d’un centre de recherches philosophiques pour l’École polytechnique, où lui et moi enseignions. Ce fut le Crea (14), dont l’histoire se confond avec mon propre parcours à partir de 1981.
Entre autres choses, le Crea aura été le berceau des sciences cognitives en France. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je n’en fus jamais un zélote, bien au contraire. La critique de ce paradigme matérialiste, mécaniste et réductionniste qui fonctionne comme un bulldozer a constitué l’essentiel de mes travaux en philosophie et histoire des sciences (15). Ma recherche actuelle sur les fondements philosophiques des nanotechnologies en représente le point d’aboutissement. On peut en effet dire qu’avec les technologies convergentes (nano, bio, info, cogno), les thèmes de l’auto-organisation et de la complexité, qui n’étaient encore que des idées lorsque nous les explorions en pionniers dans les années 1980, sont en voie de s’inscrire aujourd’hui dans la matière, pour le meilleur ou pour le pire.
La figure de l’auto-organisation a aussi été le point de départ de mes recherches en philosophie économique, sociale, morale et politique, qui ont occupé la moitié de mon temps dans les décennies 1980 et 1990. Elle m’a permis de revisiter cette tradition libérale qui naît au cœur des Lumières écossaises (David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson) et connaît son point d’aboutissement dans la philosophie sociale de Friedrich Hayek. Parmi les philosophes politiques français, je me suis trouvé toujours un peu isolé pour m’intéresser à cette tradition, sans doute jugée trop proche de la théorie économique pour être vraiment admise au royaume de la philosophie – ce que je juge être une absurdité (16).
En matière de philosophie économique, précisément, j’ai contribué avec des économistes comme André Orléan et Olivier Favereau à la constitution d’un nouveau paradigme, que nous avons nommé l’« économie des conventions », en référence à la notion de convention introduite par Hume dans le Traité, ni autorégulation marchande, ni régulation étatique. Cela m’a amené à explorer les possibilités de fertilisation croisée entre les sciences cognitives et les sciences sociales, en particulier sur la question de l’échange symbolique et sur celle de l’omniprésence du religieux dans les sociétés humaines.
La possibilité de fonder une éthique de type kantien (« déontologie » dans le jargon de la philosophie morale) avec les ressources de la théorie du choix rationnel est un défi que la philosophie morale de type analytique (qui s’écrit aujourd’hui essentiellement en anglais) a tenté de relever de multiples manières. J’en ai proposé un bilan systématique (17), en m’intéressant prioritairement à la Théorie de la justice de John Rawls, que j’ai publiée au Seuil, en 1987, dans la traduction de Catherine Audard. C’est au Crea que les premières études rawlsiennes se sont développées en France dans les années 1990.
Mes recherches en philosophie de l’action m’ont conduit à interroger les fondements métaphysiques de la théorie du choix rationnel et de la théorie des jeux et à revisiter pour ce faire la question du libre-arbitre et du déterminisme ouverte par l’argument dominateur de Diodore Kronos. Mes réflexions sur l’insuffisance radicale du cadre probabiliste pour les choix dans un monde incertain ont débouché sur une critique radicale du (trop) fameux « principe de précaution » et m’ont amené à fonder cette attitude philosophique que j’ai nommée le « catastrophisme éclairé ».
J’aurai ainsi séjourné dans des contrées philosophiques très diverses, mais je dois vous avouer que, chaque fois, je l’aurai fait beaucoup plus comme anthropologue que comme indigène. Des sciences cognitives à la philosophie politique, de l’économie théorique à la métaphysique rationnelle, j’ai toujours traité les œuvres que j’étudiais, commentais, critiquais et, parfois, contribuais à développer, comme des symptômes plus que comme des corpus ayant une valeur intrinsèque. Sans être un « déconstructeur » patenté, j’ai par rapport aux textes le même rapport que Derrida, m’intéressant avant tout aux failles, aux contradictions, aux paradoxes, et cela, non pour déclarer les textes nuls et non avenus, mais pour leur faire dire beaucoup plus que ce qu’ils disent explicitement lorsqu’ils se ferment sur eux-mêmes dans un souci de cohérence. Dans cette quête du sens, j’ai été guidé par mon travail sur l’anthropologie de René Girard (18), dont l’influence sur ma pensée n’aura pas été moindre que celle d’Ivan Illich – ce qui n’autorise pas à dire que j’aurai été le disciple de l’un ou de l’autre.
Il y a eu des ruptures dans ce parcours. Après le choc du 11 septembre 2001, j’ai cessé de prendre au sérieux de grands pans de la philosophie sociale et politique à laquelle je m’étais intéressé. Dans un livre qui manifeste ce retournement (19), je me suis laissé aller à écrire de l’œuvre de Rawls qu’« elle concerne un monde possible, qui serait peuplé de zombies raisonnables complètement étrangers au tragique de la condition humaine, mais ce monde n’est pas le nôtre, hélas peut-être. L’irénisme naïf, pompeux, académique et quelquefois ridicule des développements de Théorie de la justice m’apparaît aujourd’hui une faute contre l’esprit. Ne pas voir le mal pour ce qu’il est, c’est s’en rendre complice ». Des collègues ne m’ont pas pardonné ce qu’ils appellent ma trahison.
Permettez-moi de me justifier un instant. La philosophie politique et morale aujourd’hui se partage entre les doctrines « utilitaristes » de l’harmonie naturelle ou artificielle des intérêts et les doctrines déontologiques, lesquelles entendent élever l’individu égoïste et calculateur au rang de sujet universel, opérant ce décentrement soit par l’abstraction (Rawls) soit par la communication (Habermas). C’est tantôt comme problème, tantôt comme solution que l’« égoïsme » se présente, mais il a dans tous les cas pour principal effet d’occulter ce que Rousseau appelait la « méchanceté », c’est-à-dire la place centrale que tient l’Autre dans nos existences. Aucune de ces doctrines ne va plus loin que la question du bon dosage entre égoïsme et altruisme. La question centrale qu’elles traitent est celle du juste sacrifice des intérêts de certains pour le bien de tous ou le bien commun. Aucune ne se situe dans l’univers qui est désormais le nôtre, où certains n’hésitent pas à se sacrifier pour maximiser le mal, et non pas le bien. Le ressentiment est une notion inconnue des théories de la justice. Aussi bien la tâche urgente est-elle moins théorique que pratique : étant entendu qu’on ne supprimera pas le ressentiment, la seule question pertinente est de savoir comment on peut en minimiser ou en différer les effets, les canaliser vers des formes bénignes voire productives.
L’un des traits qui contribuent à l’illimitation de la violence moderne est le statut quasi sacré donné à la position de victime. L’universalisation du souci pour les victimes révèle de la façon la plus éclatante que la civilisation est devenue une à l’échelle de la planète entière. Partout, c’est au nom des victimes, réelles ou prétendues, que l’on persécute, tue, massacre ou mutile. C’est, en bonne « logique », au nom des victimes d’Hiroshima que les kamikaze islamiques ont frappé l’Amérique.
J’ai fait des propositions pour penser et implémenter une justice qui échappe au ressentiment victimaire. Lorsque le puissant, ou celui qui est vu comme tel, humilie l’autre, il l’incite à s’installer dans le statut commode de victime et toute négociation devient impossible. La négociation entre inégaux présuppose qu’ils se voient comme égaux au regard du droit et de la morale. Mais dans le cadre de la justice victimaire, moralement, c’est l’inférieur qui domine absolument le supérieur, comme un dieu vengeur ses créatures pécheresses. En guise de compensation, le « persécuteur » est tenu de rétribuer sa « victime » pour le ressentiment qu’elle éprouve, et seul un prix infini permettrait au premier de s’acquitter de sa dette. Pour sortir de ce piège, il est nécessaire qu’un dialogue s’instaure entre les parties, puisque le seul fait qu’elles y participent rétablit au moins partiellement l’égalité morale. C’est évidemment au plus favorisé, ou celui qui apparaît comme tel à un regard extérieur et non partisan, de prendre l’initiative du dialogue.
Le choix du catastrophisme éclairé
Esprit : Comment, dans la lignée de Hans Jonas, en êtes-vous arrivé à travailler sur l’éthique et la métaphysique, et à définir ce que vous appelez le catastrophisme éclairé ?
 Jean-Pierre Dupuy : La thèse du catastrophisme éclairé est au confluent de beaucoup de mes recherches passées dont la diversité pouvait ressembler à de la dispersion et qui trouvent là une forme d’unité complexe. C’est en ce point « apocalyptique » que tout semble se nouer : mes recherches militantes sur l’avenir du monde, certes, et la nécessité d’un nouveau modèle de civilisation où la science et la technique seraient mises au service du développement des capacités autonomes. Mais je dois avouer, comme peu de mes lecteurs l’ont compris, que ce ne fut pas cela la cause immédiate de mes recherches « catastrophistes ». Ce fut bien plutôt d’une part mes travaux philosophiques sur les fondements d’une éthique rationnelle et la métaphysique temporelle sous-jacente à la théorie du choix rationnel et à la théorie des jeux ; d’autre part mes recherches sur l’anthropologie de la violence et du sacré. Comme Hans Jonas, en effet, je pense que la solution, s’il en existe, à nos problèmes ne peut être que politique à l’échelle mondiale ; mais qu’on ne changera pas la politique sans d’abord concevoir une nouvelle éthique, que Jonas a nommée l’« éthique du futur » – comprendre l’éthique qui entend préserver la possibilité d’un avenir pour l’homme ; et que cette éthique présuppose une nouvelle métaphysique que, contrairement à Jonas, j’ai tenté de bâtir avec les instruments de la philosophie (et de la théologie) analytiques. C’est, comme ce fut le cas pour Jonas mais surtout pour Anders, sur le problème de l’efficacité et de l’éthique de la dissuasion nucléaire que pour moi tout s’est joué.
Jean-Pierre Dupuy : La thèse du catastrophisme éclairé est au confluent de beaucoup de mes recherches passées dont la diversité pouvait ressembler à de la dispersion et qui trouvent là une forme d’unité complexe. C’est en ce point « apocalyptique » que tout semble se nouer : mes recherches militantes sur l’avenir du monde, certes, et la nécessité d’un nouveau modèle de civilisation où la science et la technique seraient mises au service du développement des capacités autonomes. Mais je dois avouer, comme peu de mes lecteurs l’ont compris, que ce ne fut pas cela la cause immédiate de mes recherches « catastrophistes ». Ce fut bien plutôt d’une part mes travaux philosophiques sur les fondements d’une éthique rationnelle et la métaphysique temporelle sous-jacente à la théorie du choix rationnel et à la théorie des jeux ; d’autre part mes recherches sur l’anthropologie de la violence et du sacré. Comme Hans Jonas, en effet, je pense que la solution, s’il en existe, à nos problèmes ne peut être que politique à l’échelle mondiale ; mais qu’on ne changera pas la politique sans d’abord concevoir une nouvelle éthique, que Jonas a nommée l’« éthique du futur » – comprendre l’éthique qui entend préserver la possibilité d’un avenir pour l’homme ; et que cette éthique présuppose une nouvelle métaphysique que, contrairement à Jonas, j’ai tenté de bâtir avec les instruments de la philosophie (et de la théologie) analytiques. C’est, comme ce fut le cas pour Jonas mais surtout pour Anders, sur le problème de l’efficacité et de l’éthique de la dissuasion nucléaire que pour moi tout s’est joué.
Pendant plus de quatre décennies de guerre froide, la situation dite de « vulnérabilité mutuelle » ou « destruction mutuelle assurée » (MAD en anglais) aura donné à la notion d’intention dissuasive un rôle majeur, tant au plan de la stratégie qu’à celui de l’éthique. L’essence de l’intention dissuasive se trouve tout entière contenue dans la réflexion suivante, faite presque sans broncher par un stratège français : « Nos sous-marins sont capables de tuer cinquante millions de personnes en une demi-heure. Nous pensons que cela suffit à dissuader quelque adversaire que ce soit. » Que cette proposition ait pu passer pour le comble de la sagesse et de la rationalité et qu’on puisse la créditer d’avoir assuré la paix du monde pendant toute cette période que d’aucuns vont jusqu’à regretter aujourd’hui, laisse pantois. Rares pourtant sont ceux qui s’en sont émus. Pourquoi ?
Une réponse couramment admise aura été qu’il ne s’agit précisément ici que d’une intention, et non d’un passage à l’acte ; et encore d’une intention d’un genre si particulier que c’est précisément parce qu’on la forme que les conditions qui amèneraient à la mettre à exécution ne sont pas réunies : l’adversaire étant par hypothèse dissuadé n’attaque pas le premier, et l’on n’attaque jamais soi-même en premier, ce qui fait que personne ne bouge. On forme une intention dissuasive afin de ne pas la mettre à exécution. Les spécialistes parlent d’intention auto-invalidante (self-stultifying intention), ce qui donne un nom à l’énigme à défaut de la résoudre.
Ceux qui se sont penchés sur le statut, tant stratégique que moral, de l’intention dissuasive lui ont de fait trouvé un statut extrêmement paradoxal. Ce qui peut la faire échapper à la condamnation éthique est cela même qui la rend nulle sur le plan stratégique, puisque son efficace est directement liée à… l’intention que l’on a de vraiment la mettre à exécution. Quant au point de vue moral, telles les divinités primitives, l’intention dissuasive paraît conjoindre la bonté absolue, puisque c’est grâce à elle que la guerre nucléaire n’a pas lieu, et le mal absolu, puisque l’acte dont elle est l’intention est une abomination sans nom.
Tardivement, certains comprirent qu’il n’est nul besoin d’intention pour rendre la dissuasion nucléaire efficace. La divinité se révélait être un faux dieu. La simple existence d’arsenaux se faisant face, sans que la moindre menace de les utiliser soit proférée ou même suggérée, suffisait à ce que les jumeaux de la violence se tinssent cois. L’apocalypse nucléaire ne disparaissait pas pour autant du tableau, ni une certaine forme de transcendance. Sous le nom de dissuasion « existentielle », la dissuasion apparaissait désormais comme un jeu extrêmement périlleux consistant à faire de l’anéantissement mutuel un destin. Dire qu’elle fonctionnait signifiait simplement ceci : tant qu’on ne le tentait pas inconsidérément, il y avait une chance que le destin nous oublie – pour un temps, peut-être long, voire très long, mais pas infini.
En définitive, si la dissuasion nucléaire a maintenu un temps le monde en paix, c’est en projetant le mal hors de la sphère des hommes, en en faisant une extériorité maléfique mais sans intention mauvaise, toujours prête à fondre sur l’humanité mais sans plus de méchanceté qu’un tremblement de terre ou un tsunami, avec cependant une puissance destructrice capable de faire pâlir la Nature d’envie. Cette menace suspendue au-dessus de leurs têtes a donné aux princes de ce monde la prudence nécessaire pour éviter l’abomination de la désolation qu’aurait été une guerre thermonucléaire les détruisant les uns et les autres et le monde avec eux.
Cependant, tout cet édifice reposait sur des prémisses qui ne sont plus satisfaites aujourd’hui, en particulier l’hypothèse hobbesienne que dans cet état de nature qu’est la prétendue « communauté internationale », chacun a cette rationalité minimale que constitue le souci de se maintenir en vie (self-preservation). Dans la perspective d’un monde multipolaire où des dizaines d’agents disposeront d’armes de destruction massive et où certains d’entre eux n’hésiteront pas à « se sacrifier » pour maximiser le mal autour d’eux, tout l’édifice intellectuel, symbolique et institutionnel qui a permis à l’humanité jusqu’ici de ne pas s’auto-éliminer dans la violence intestine, est à reconstruire à nouveaux frais.
Ce qui rend légitime de rapprocher le problème des catastrophes majeures qui pèsent sur l’avenir de l’humanité (par exemple la mise en chaos du climat et de tous les écosystèmes) de la dissuasion nucléaire est précisément l’interprétation de celle-ci en termes de dissuasion existentielle. La structure, dans les deux cas, est la même : non pas un duel à mort opposant deux adversaires, mais un seul protagoniste, l’humanité, ayant affaire à sa propre violence, réifiée, extériorisée. L’obstacle à la prise de conscience et à l’action est identique : même lorsqu’on sait qu’elle va se produire, la catastrophe n’est pas crédible. Nous savons, ou nous devrions savoir, mais nous ne croyons pas ce que nous savons.
Le catastrophisme éclairé est une ruse qui consiste à faire comme si nous étions la victime d’un destin tout en gardant à l’esprit que nous sommes la cause unique de notre malheur. Il nous faut vivre désormais les yeux fixés sur cet événement impensable, l’autodestruction de l’humanité, avec l’objectif, non pas de le rendre impossible, ce qui serait contradictoire, mais d’en retarder l’échéance le plus possible. Il s’agit de se coordonner sur un projet négatif qui prend la forme d’un avenir fixe dont on ne veut pas. Le paradoxe de l’autoréfutation veille : si l’on réussit à éviter l’avenir indésirable, comment peut-on dire qu’on se sera coordonné, fixé sur l’avenir en question ? J’ai montré qu’il y avait une solution rationnelle à ce paradoxe, et qu’elle fait signe vers la figure du tragique – l’événement tragique relevant à la fois de l’accident et de la fatalité, à l’instar d’Œdipe tuant son père au carrefour funeste ou de Meursault l’Étranger tirant sur l’Arabe sous le soleil d’Alger. C’est seulement parce que l’apocalypse est inscrite dans l’avenir qu’elle peut ne pas se produire.
Comme le dit Hölderlin : « Wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. » (« Mais là où il y a danger, croît aussi/Ce qui sauve. »)
Propos recueillis par Olivier Mongin, Marc-Olivier Padis et Nathalie Lempereur ©Revue Esprit
* Voir ses articles dans Esprit : « De Lisbonne (1755) à Sumatra (2005), sur le mal, nous n’avons rien appris », mai 2005 et « La médicalisation de la vie. Médecine et pouvoir : en hommage à Ivan Illich », octobre 2004.
1. Hannah Arendt, Human Condition, trad. fr. Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961, voir p. 259-261.
2. Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Paris, Le Seuil, 2002 (2e éd., coll. « Points », 2004).
3. Henri Prévot, Trop de pétrole ! Énergie fossile et changement climatique, Paris, Le Seuil, 2007.
4. Voir ici même l’article d’Henri Prévot.
5. Voir l’intervention dans ce débat de Frédéric Worms : « La catastrophe et l’injustice », Esprit, novembre 2005.
6. C’est la thèse que j’ai développée dans mon Retour de Tchernobyl. Journal d’un homme en colère, Paris, Le Seuil, 2006.
7. Jean-Pierre Dupuy et Serge Karsenty, l’Invasion pharmaceutique, Paris, Le Seuil, 1974 (2e éd., coll. « Points », 1977).
8. Ivan Illich et Jean-Pierre Dupuy, Némésis médicale. L’expropriation de la santé, Paris, Le Seuil, 1975 (2e éd., coll. « Points », 1981. Voir I. Illich, Œuvres complètes, 2 vol., Paris, Fayard, 2005 et 2006).
9. Pour se limiter aux dernières années : « Le détour et le sacrifice. Ivan Illich et René Girard », Esprit, mai 2001, p. 26-46 ; « La médicalisation de la vie. Médecine et pouvoir : en hommage à Ivan Illich », Esprit, octobre 2004, p. 26-39.
10. I. Illich, Énergie et équité, avec une annexe de J.-P. Dupuy, Paris, Le Seuil, 1975, p. 9-10.
11. Issus du latin trepalium, instrument de torture à trois pieux.
12. J.-P. Dupuy, Petite métaphysique des tsunamis, Paris, Le Seuil, 2005.
13. J.-P. Dupuy, Ordres et désordres, Paris, Le Seuil, 1982 (2e éd. 1990).
14. Centre de recherche en épistémologie appliquée.
15. J.-P. Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1994 (The Mechanization of the Mind, Princeton, Princeton University Press, 2000).
16. Id., Introduction aux sciences sociales, Paris, Ellipses, 1992 ; Libéralisme et justice sociale, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1997 ; Éthique et philosophie de l’action, Paris, Ellipses, 1999.
17. J.-P. Dupuy, le Sacrifice et l’envie, Paris, Calmann-Lévy, 1992.
18. Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuy, l’Enfer des choses. René Girard et la logique de l’économie, Paris, Le Seuil, 1979.
19. J.-P. Dupuy, Avions-nous oublié le mal ? Penser la politique après le 11 septembre, Paris, Bayard, 2002.