Tant que l’on s’en tient aux équilibres de la nature, on perpétue les dualismes de la modernité (qui opposent l’homme et la nature, l’artificiel et le naturel, la culture et la nature) en se contentant d’en inverser les signes : au lieu de louer en l’homme le conquérant de la nature, on le dénonce comme son destructeur. Cela peut conduire à une dénonciation violente des hommes, au risque de susciter des critiques légitimes. Passer d’une vision statique à une vision dynamique, c’est surmonter ces dualismes, et inclure l’homme dans les processus que l’on veut encourager.
Car l’écologie est la « science subversive » qui met en cause les certitudes réductionnistes de certains courants de la biologie (comme la biologie moléculaire), pour nous montrer que nous ne sommes pas des atomes indépendants, que l’homme n’est pas à part de la nature, mais en fait partie, appartient à un monde dont toutes les composantes sont interdépendantes.
Telle est la bonne nouvelle que les éthiques environnementales – ou une « écosophie » comme celle d’Arne Naess – s’emploient à élaborer en termes philosophiques : comment développer une vision relationnelle du monde, comment passer d’une morale de l’arrachement (à la nature) à une éthique de l’attachement (à notre monde commun) ?
Questionner le monopole de la science
Mais est-il encore nécessaire de parler de nature ? Selon Bruno Latour, la nature, telle que l’on s’y réfère dans les questions environnementales, n’est pas un élément nécessaire de la solution (que l’on s’interroge sur la dimension morale de nos rapports à la nature, ou que l’on veuille « faire entrer la nature en politique »), elle fait partie du problème : elle sert à donner le pouvoir aux scientifiques, en les faisant porte-parole d’une unité, la nature, présupposée comme donnée.
Selon Philippe Descola, il faut apprendre à se situer « par-delà nature et culture ». Mais cela implique-t-il que, comme le déclarent Bruno Latour et Philippe Descola, il faille abandonner toute référence à la nature, et se préoccuper de constituer « un monde commun » réunissant « humains et non-humains » ? Ne faudrait-il pas plutôt considérer que l’un des effets de la crise environnementale est de remettre la discussion sur la nature dans le domaine de la philosophie, en enlevant à la science le monopole sur la question de la nature qu’elle avait fait sien dans la modernité ?
Lorsque Philippe Descola a présenté devant l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN, l’une des plus importantes associations de protection de la nature) les idées qu’il développera plus tard dans Par-delà nature et culture, il entendait mettre en garde contre les conséquences d’une exportation des modèles occidentaux de protection de la nature : imposer les normes occidentales – celles de la wilderness – dans d’autres parties du monde, ce n’est pas protéger la nature, c’est vider des espaces de leurs habitants habituels, pour en faire des parcs de loisir pour touristes occidentaux ou des lieux sous contrôle scientifique. C’est donc en défendant la vie des cultures non occidentales et en respectant leur propre ontologie que l’on protégera ce que nous concevons comme leur nature – car ce qui à nos yeux est nature fait partie de leur culture.
Une nécessaire empathie
Mais s’il est ainsi exclu d’imposer à d’autres cultures que la nôtre des schémas de protection qui conduisent à des formes de néo-colonialisme, cela signifie-t-il qu’il faille renoncer à parler de nature ? Nous ne le pensons pas. Ne serait-ce que parce que l’on ne se débarrasse pas si facilement de la nature. Ce n’est peut-être pas un hasard si les titres mêmes de deux des livres qui ont le plus fait pour mettre en cause l’idée reçue de nature, dans les milieux environnementalistes, Politiques de la nature et Par-delà de la nature et culture, mentionnent le terme qu’ils critiquent. Et, dans des cas comme ceux-là, la mention du mot compte plus que ce que l’on en dit.
La notion de nature n’est certes pas universelle, mais c’est bien parce qu’il s’agit d’une catégorie occidentale que cela nous condamne, jusqu’à un certain point, à y rester attachés. On ne change pas d’ontologie, ni de façons de s’exprimer, sur une simple décision, et les catégories par lesquelles on peut tenter de remplacer la nature (le couple des humains et des non humains, ou la biodiversité) sont elles aussi des catégories occidentales. Et, à ne plus parler que d’humains et de non-humains, on risque, assez vite, de ne plus s’intéresser qu’aux humains, tant la catégorie de non-humains est indéfinie et n’a de sens que par rapport à nous.
Il n’est donc pas question de renoncer à toute idée de la nature, mais on peut en éviter les inconvénients en s’appuyant sur la plasticité du naturalisme, au sens, qui est celui de Philippe Descola, de l’ontologie caractéristique de la modernité occidentale, qui pose la continuité physique de tout ce qui est naturel, tout en réservant l’intériorité aux seuls humains. La caractéristique principale du naturalisme est son dualisme : s’il a permis, en objectivant la nature, d’en développer la connaissance scientifique, il est aussi ce qui permet d’opposer l’homme et la nature, alors même que la distinction entre le naturel et l’artificiel, entre histoire humaine et histoire naturelle, est de plus en plus difficile à faire. Mais le naturalisme est aussi caractérisé par sa plasticité. Celle-ci se remarque dans la capacité critique, ou réflexive, de l’ontologie naturaliste.
Le souci de la nature procède de la modernité : c’est au moment où s’affirme la domination de la nature que l’on se met aussi à mettre en question cette domination et à préserver des espaces naturels. Que des éthiques environnementales aient pu, de l’intérieur même de la modernité naturaliste, mettre celle-ci en question, témoigne de l’inventivité qu’autorise l’idée occidentale de nature. La plasticité se trouve aussi dans la capacité de l’ontologie naturaliste à accueillir des segments d’autres ontologies, notamment animistes : l’intérêt que nous portons de plus en plus à la sensibilité animale va de pair avec une empathie à l’égard des animaux. Or, pour modifier notre attitude à l’égard de la nature, et d’une façon qui ne consiste pas seulement à la laisser en dehors de nous, mais à savoir y intervenir, il nous faut cesser de la considérer comme un pur mécanisme, et manifester une certaine empathie avec le vivant, et la nature en général. Nous pourrons ainsi tenter d’accorder notre attitude vis-à-vis de la nature et la conception que nous en avons.
Catherine Larrère, Professeur des universités en philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Retrouvez ce texte dans son intégralité en consultant l’ouvrage collectif « Guide des humanités environnementales » (édité par Aurélie Choné, Isabelle Hajek et Philippe Hamman, Presses universitaires du Septentrion), à paraître en décembre 2015.
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.





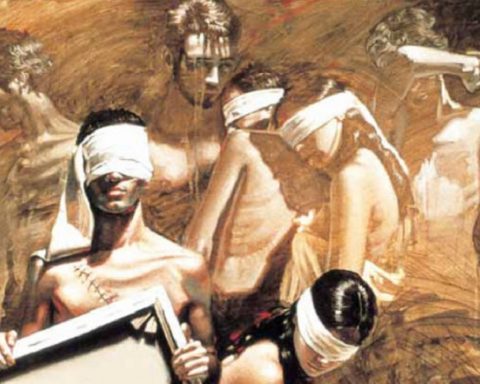



[…] https://up-magazine.info/decryptages/analyses/5240-est-il-encore-necessaire-de-parler-de-nature/ […]