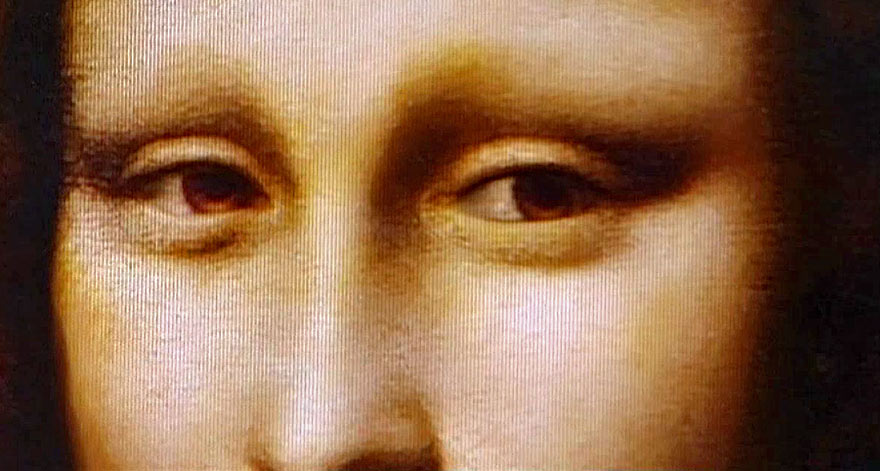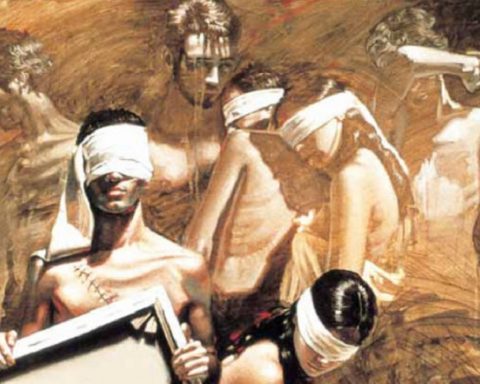Le numérique fournit « une opportunité historique » dont l’Éducation nationale doit s’emparer pour lutter contre la difficulté scolaire en primaire, à condition d’expérimenter, d’équiper les enseignants et de les former, prône un rapport dévoilé lundi 7 mars. « C’est à l’école primaire que les résultats les plus forts peuvent être obtenus », elle « doit être la priorité absolue du numérique éducatif« , estime ce rapport, élaboré par le think tank libéral Institut Montaigne, présidé par le patron de l’assureur Axa Henri de Castries, en partenariat avec le Boston Consulting Group.
En France, l’école primaire est nettement moins équipée en outils numériques que le secondaire, et le plan numérique annoncé par François Hollande pour la rentrée 2016 cible surtout le collège.
Le rapport distingue deux stades pour l’utilisation du numérique éducatif. D’abord les cycles 1 et 2 (maternelle, puis du CP au CE2), où il peut permettre de dégager du temps pour se concentrer sur l’acquisition des fondamentaux par les écoliers en difficulté, au sein de la classe mais aussi pendant le temps périscolaire, voire les vacances. On pourrait ainsi, avec des vidéos, exercices ou questionnaires, mettre à profit une partie du temps que les enfants passent de toute façon devant les écrans à la maison, supérieur au temps de classe annuel, calcule le rapport.
Ensuite, en CM1 et CM2, « le numérique peut être envisagé comme un nouveau savoir fondamental, au même titre que parler, lire, écrire et compter« .
C’est dans cette actualité qu’UP’ Magazine a choisi de publier, en contrepoint, des extraits de cette tribune signée par le collectif PMO (Pièces et main d’œuvre)* :

Savez-vous pourquoi la Joconde sourit ? Parce qu’elle est heureuse. Pour être exact, elle ressent de la joie à 83 %, du dégoût à 9 %, plus 6 % de peur et 2 % de colère. Moins d’un pour cent d’elle est neutre, et elle n’exprime aucune surprise. Le logiciel du professeur Harro Stokman, de l’université d’Amsterdam, n’a pas pu confirmer la dimension sexuelle ou la part de mépris détectées dans le regard de Mona Lisa par certains humains. Mais c’était en 2005 et la machine a dû progresser, puisqu’entre-temps Stokman a monté la startup Euvision pour vendre ses outils de reconnaissance faciale sur smartphone.
Bienvenue dans l’ère des humanités numériques. Celles qui réalisent « l’intégration de la culture numérique dans la définition de la culture générale du XXIe siècle ». Qui verra bientôt la création de « Territoires éducatifs d’innovation numérique », selon le programme du ministère de l’Éducation nationale, car « en ne s’emparant pas du numérique, en ne l’intégrant pas suffisamment, l’École, d’une certaine façon, prive nos élèves de ressources précieuses : celles du savoir. Celles du sens. »
Retenez bien ceci : le numérique est ce qui donnera bientôt aux petits humains accès au sens.
Les humanités numériques ? Un mouvement qui a pris son essor durant les années 2000 au sein des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres, pour les rendre, eux aussi, connectés, numérisés, big datés. Comme le dit un rapport [Humanités numériques, état des lieux et positionnement de la recherche française dans le contexte international, rapport de l’Institut français, 2014], les sciences humaines et sociales sont fortement influencées par les modèles computationnels (…) Dans toutes les disciplines, que ce soit en biologie ou en littérature, en physique nucléaire ou en anthropologie, l’objet étudié est converti, manipulé, analysé sous une catégorie commune : l’information, objet de calculs. Dans le cadre du paradigme computationnel, des rapprochements inattendus se produisent.
Puisque le vivant est désormais computable, pourquoi la culture ne le serait-elle pas ? Il s’agit que les sociologues, linguistes, géographes, bibliothécaires, artistes contemporains, archéologues, passent, comme tout le monde, par la case « codage ». Ils avaient déjà quantifié toute réalité – sociale, humaine, sensible. Pourquoi ne la traduiraient-ils pas en séries de 1 et de 0 ? Reductio ad numero universelle, dont l’effet – sinon l’objectif – est d’annihiler toute appréhension subjective du réel, c’est-à-dire toute humanité dans la compréhension et le récit du monde. Ici aussi, il s’agit de remplacer l’homme par la machine. Voilà pourquoi le ministère de l’Éducation nationale est si pressé d’enseigner le code informatique à la place du latin et du grec.
Comment en est-on arrivé là ? Si les technosciences ont imposé leur suprématie dans les faits après la seconde guerre mondiale, il fallait aussi acclimater les esprits pour que leur victoire soit totale. La défaite des humanités est le résultat d’une lutte d’idées, d’un long travail de sape auxquels ont collaboré de nombreux scientifiques. Parmi eux, un physicien et « romancier » anglais, Charles Percy Snow, est resté célèbre pour une conférence prononcée à Cambridge le 7 mai 1959, intitulée Les deux cultures et la révolution scientifique » [C.P Snow, Les deux cultures, (JJ Pauvert, 1968)].
Il y développe les arguments qui justifient le primat de la science et de la technologie sur la vie des sociétés industrielles, arguments dont la pertinence est intacte à l’ère des nanotechnologies et des technologies convergentes.
La postérité n’a conservé que la première moitié du titre de la conférence : « Les deux cultures ». Et n’a retenu, à tort, que cette idée : C.P Snow aurait prêché la réconciliation entre deux mondes qui s’ignorent : les sciences et les lettres, séparées par un « abîme d’incompréhension mutuelle ». La preuve, les littéraires ne sont pas fichus de réciter la deuxième loi de la thermodynamique et peu de scientifiques ont lu Dickens.
Or, de la rencontre entre les disciplines pourrait « jaillir des chances créatrices » pour le progrès humain. Donc, conclut-on, il faut dispenser un enseignement moins spécialisé et favoriser les croisements entre les deux mondes. Telle serait la leçon, somme toute assez humaniste, du professeur Snow. Dans cet esprit, le prix universitaire « C.P Snow » de l’Ithaca College récompense aujourd’hui des étudiants dont les travaux contribuent à rapprocher les « deux cultures ».
Si Snow regrette le fossé entre ce qu’il appelle « la culture traditionnelle » – littéraire – et la culture scientifique, c’est pour évincer les humanités et faire des sciences et technologies le cœur de la « culture » moderne. Suivez la démonstration : la société industrielle est la seule capable d’assurer aux hommes prospérité et bien-être. Ses progrès dépendent de la « révolution scientifique » – autrement dit de l’innovation, et exigent des ressources humaines dûment formées. En conséquence, arrêtons de perdre du temps avec les matières inutiles, voire hostiles, à cette stratégie – les humanités – et consacrons les efforts de la Nation aux filières scientifiques.
On voit à quel point sa conférence est fondatrice : ses recommandations ont été suivies, si l’on ose dire, à la lettre, pour permettre la domination des technosciences sur tous les champs de pensée. Si vous ne savez pas quoi lire en 2016, demandez aux algorithmes d’Amazon, devenus premiers prescripteurs de livres. Réponse garantie 100 % conforme à votre profil objectif.
En fait de pont entre les « deux cultures », Snow ne cesse de sermonner les littéraires pour leur dédain de la science. Loin de vouloir initier les chimistes à la poésie, le conférencier remâche son aigreur contre les « intellectuels littéraires qui se sont mis un beau jour, en catimini, à se qualifier d’ »intellectuels » tout court, comme s’ils étaient les seuls à avoir droit à cette appellation. »
Devant les merveilles de la technoscience, enrage Snow, les tenants des humanités « s’obstinent à prétendre que la culture traditionnelle constitue toute la « culture ». (…) Comme si l’édifice scientifique du monde physique n’était pas, dans sa profondeur intellectuelle, sa complexité et son articulation, l’œuvre collective la plus belle et la plus étonnante que l’esprit de l’homme ait jamais conçu. »
Belle profession de foi scientiste. Chacun peut, après des décennies de progrès de cette « œuvre collective la plus belle et la plus étonnante », voir ses effets sur la richesse des liens sociaux, sur l’émancipation des individus, la qualité des échanges entre les peuples et les cultures, sans parler de l’excellente santé de la planète. Le monde est tellement plus intelligible depuis qu’on le numérise. À l’évidence, nous n’avons pas besoin des humanités et Snow a eu raison d’asséner : « la science doit être assimilée jusqu’à devenir partie intégrante de notre expérience mentale tout entière ».
La victoire de la technoscience a fait de nous des êtres débarrassés de la question « pourquoi ? », pour nous consacrer au « comment ? ». Il n’est que d’écouter les conversations à la cantine sur les moyens d’optimiser son smartphone, de télécharger la bonne appli, de résoudre tel bug. Dans le monde-machine, il devient vital de savoir comment fonctionner – rappelez-vous Najat Vallaud- Belkacem : le numérique va nous donner accès au sens.
On l’a compris, Snow part de ce postulat : l’industrialisation est un vecteur de progrès universel.
« Santé, nourriture, instruction : seule la révolution industrielle était à même d’en faire profiter jusqu’aux plus déshérités. Voilà ce que nous y avons essentiellement gagné. Le tableau comporte aussi, il est vrai, des aspects négatifs : l’un de ces aspects étant qu’une société fortement industrialisée est plus facile à organiser qu’une autre en vue de la guerre totale. Mais les conquêtes demeurent. Elles sont la base de notre espoir social. »
Passons sur ce détail qu’est « la guerre totale », cet éclair de lucidité n’empêchant pas le scientiste convaincu de s’aveugler comme le dernier des croyants. « Étendre la révolution scientifique à l’Inde, l’Afrique, l’Asie du sud-est, l’Amérique latine et le Moyen-Orient, assure-t-il, est la seule façon de conjurer les trois dangers qui nous menacent, à savoir la guerre nucléaire, la surpopulation, le fossé entre les riches et les pauvres. » Curieusement, il ne vient pas à l’esprit du physicien qu’il puisse exister un lien entre la guerre nucléaire et la « révolution scientifique ». Ni même entre l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres et cette même révolution. Au contraire, il affirme qu’en l’an 2000, la division entre riches et pauvres aura disparu grâce à la technologie.
Snow a eu tort de mépriser les intellectuels. S’il avait lu le livre de Jacques Ellul, La Technique ou l’enjeu du siècle, paru en 1954, ou L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders, paru en 1956, il aurait peut-être écrit moins d’âneries, pour peu qu’il eût compris la logique de la fuite en avant technicienne, et la rupture anthropologique causée par l’innovation nucléaire.
Piètre consolation pour nous, naufragés d’un monde dévasté par les technoscientifiques : les idées d’Ellul, d’Anders, et des penseurs critiques de la technologie, affûtées il y plus de soixante ans, étaient justes. Quant à celles de Snow, aussi erronées furent-elles – on voit ce qu’il en est de l’égalité entre riches et pauvres dans la technosphère -, elles ont gagné. Voilà qui confirme le fait que la science n’a rien avoir avec le sens. En effet, la révolution qui a bouleversé le monde et nos vies fut scientifique. Bravo les labos. On comprend que le texte de Snow ait été publié en France en 1968 par un éditeur jugé subversif, Jean-Jacques Pauvert. Enfin un coup de balai sur les antiquités humanistes pour faire place à l’avenir, à l’innovation, à la révolution !
Comme le note Snow : « La société industrielle de l’électronique, de l’énergie nucléaire et de l’automation est, à bien des égards, d’une nature radicalement différente de celles qui l’ont précédée et est appelée à changer bien davantage la face du monde. C’est cette transformation-là qui, à mon avis, constitue la véritable « révolution scientifique » ».
Mais pourquoi ? Pour que votre montre connectée vérifie que vous avez fait vos 10 000 pas quotidiens. Pour que des millions de Chinois, d’Indiens, de Parisiens voire, se déplacent en ville un masque sur le nez. Pour que les ours polaires disparaissent de la surface du globe. Pour que nous puissions nous greffer les implants électroniques qui nous rendront plus performants dans la compétition universelle. Pour que ce monde d’objets intelligents, de dispositifs technologiques et de machines n’ait plus besoin des humains.
Pour réussir cette révolution, il a fallu l’accélération du techno-capitalisme. Et Snow de s’emballer dans un chapitre que devraient lire à voix haute tous ceux qui ânonnent encore qu’il faut distinguer
« Science pure » et « appliquée ». « La science pure a été mise au service de l’industrie : plus de tâtonnements ni d’idées lancées par une poignée d’ »inventeurs », mais, cette fois, du sérieux, du solide et du vrai. » Certes, des scientifiques « purs » ont un peu renâclé à reconnaître cette évidence. Cependant, « à leur décharge (…) ils prirent assez facilement le tournant » lors de la seconde guerre mondiale qui les poussa à « s’initier aux problèmes de l’industrie. Cela leur ouvrit les yeux ».
Heureux avènement de la Big Science. La mobilisation de bataillons d’ingénieurs, de chercheurs, de techniciens des laboratoires publics aux côtés des industriels et des militaires dans la course à la bombe atomique : le projet Manhattan. Ayant prouvé son efficacité, l’alliance recherche-industrie- armée devint le moteur de la recherche & développement en temps de guerre économique – ce que l’on nomme aujourd’hui innovation.
Pas de composants nano-électroniques implantés dans tous les gadgets communicants sans l’alliance entre le Commissariat à l’énergie atomique de Grenoble et la multinationale STMicroelectronics, sans la participation de l’État, de l’Europe et des collectivités au plan d’investissement public-privé
Nano 2017 d’un montant de 3,5 milliards d’euros. Un programme destiné à aider le fabricant de puces à « franchir le prochain saut technologique nécessaire pour rester compétitifs, au niveau mondial, face aux États-Unis et à l’Asie » [Communiqué de presse Nano 2017, 2013] : voilà de dignes émules de C.P Snow.
Découvrant la subvention de l’État à STMicro pour l’année 2014 dans le projet de loi de finances rectificatif, le professeur de droit à la faculté de Montpellier Yann Bisiou s’étrangle : « 274 millions d’euros, c’est le budget annuel de trois universités LLASHS (NdR : Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales), de deux universités pluridisciplinaires, plus que le budget annuel de l’université de Grenoble 1 ou même de l’université Paris Diderot ! Pourquoi tant de largesses pour un seul projet ? ». Encore un littéraire qui demande « pourquoi ? »
C’est pourtant simple : les universités LLASHS rapportent bien moins que l’usine à puces grenobloise, et nous avons besoin d’une technocratie pour rester dans la course aux innovations technologiques.
Snow admet, dans un supplément à sa conférence ajouté quatre ans plus tard, que le monde-machine va avoir besoin des sciences humaines et sociales pour acclimater les humains. Il appelle cela la Troisième culture : « Certaines difficultés de communication (NdR : entre littéraires et scientifiques) se trouveront, de fait, aplanies : car cette culture devra nécessairement, ne fût-ce que pour remplir son office, entretenir des relations avec la culture scientifique. »
Et voilà pourquoi les humanités numériques existent. Dans l’ensemble, la masse a plié devant le techno-totalitarisme. Quelques réactionnaires pleurent les cours de latin, mais le nombre a renoncé à penser, assailli par tous les « comment ? » que lui pose son existence machinale.
Pièces et main d’œuvre
*Pièces et Main d’Œuvre, est un collectif qui se présente comme un « atelier de bricolage pour la construction d’un esprit critique à Grenoble, agit depuis l’automne 2000 de diverses manières : enquêtes, manifestations, réunions, livres, tracts, affiches, brochures, interventions médiatiques et sur Internet, etc. »
Rejetant les ajustements à la marge et les simples mesures d’encadrement, ce groupe n’hésite pas, après enquête rigoureuse, à déclarer son refus radical de tel ou tel champ technologique : Organismes génétiquement modifiés (OGM), téléphonie mobile, et — surtout — nanotechnologies : loin d’être « obscurantiste », PMO fait la lumière sur la façon dont ces projets technoscientifiques se déploient, avec pour moteurs l’émulation et l’appât du gain.
Revendiquant les chahuts qui ont conduit, début 2010, au naufrage du « débat public sur les nanotechnologies », ces insoumis inscrivent leur pensée dans la lignée de Jacques Ellul, et revendiquent l’héritage des ouvriers luddites qui, au XIXe siècle, brisèrent les machines leur imposant un retour au servage.
L’intégralité de cet article est disponible sur le site PMO
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents
Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments