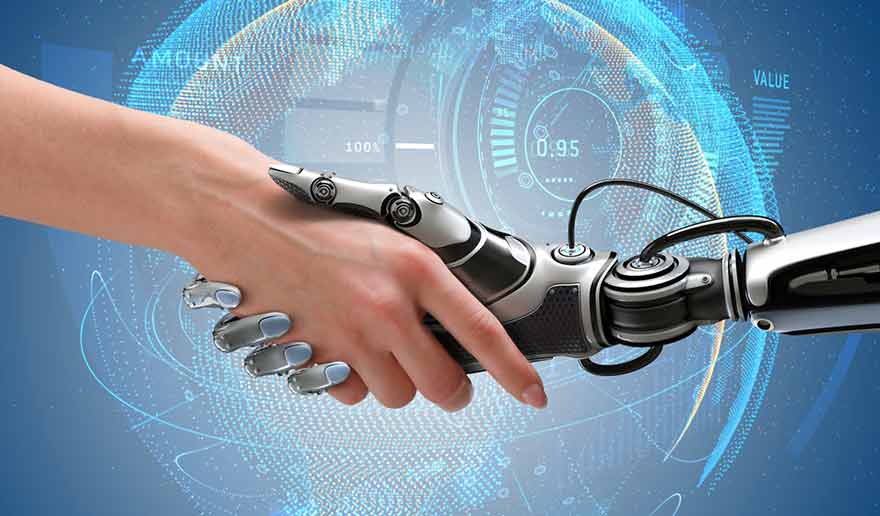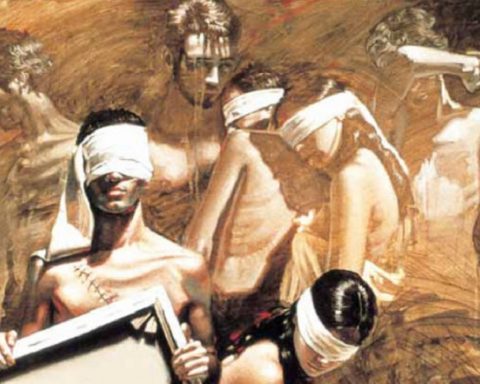Face à la crise climatique, nous restons passifs, comme indifférents alors que depuis une trentaine d’années, nous sommes avertis d’éventuelles catastrophes que nous prédisent toujours les chercheurs. Ce qui aurait pu n’être que crise passagère se transforme sous nos yeux en une « altération de notre rapport au monde », formule qui est aussi, Bruno Latour le souligne, dans son ouvrage « Face à Gaïa » une définition de la folie. La folie appelle une thérapie en ces domaines où l’espoir serait un aveuglement. Est-ce dans cette perspective de « soin » que, sans l’énoncer précisément, ce philosophe anthropologue nous propose de repenser notre conception de la nature et de lui préférer Gaïa nom de la terre, dans un retour à une figure archétypale ? L’« hypothèse Gaïa », dite aussi « hypothèse biogéochimique », il l’emprunte à l’écrivain scientifique écologique James Lovelock (né en 1919 et ayant théorisé « Gaïa » en 1970). « Face à Gaïa » : voilà un titre énigmatique voire inquiétant, évoquant au fil de huit conférences un conflit, conflit dans lequel nous sommes désormais pris, selon l’auteur et dans l’élaboration duquel il devient vital de s’engager.
Ce terme désigne selon les chercheurs, l’ère nouvelle dans laquelle nous nous trouvons, même si les géologues hésitent à la dater nettement, se contentant de constater que nous sommes sortis de l’holocène.
Cette ère nouvelle prend naissance dès le XVIIIème siècle avec l’essor des sciences et des techniques. Et avec le terme qui l’identifie. Ce mot, désignant une période géologique durant laquelle l’action humaine a des répercussions sur la planète, nous met en face de la responsabilité de l’homme vis-à-vis des autres vivants. Nous sommes dès lors, face aux « entités non humaines », (forêts, rivières, montagnes, monde animal), tenus de changer d’échelle pour lire l’histoire. Il semble vital de faire l’apprentissage d’une nouvelle temporalité avec de nouvelles exigences pour freiner une civilisation technologique glissant à vive allure vers l’incontrôlé. Cette problématique était déjà présente dans « Malaise dans la culture » où Freud constatait que les hommes sont en mesure de se détruire en exploitant techniquement, par des voies de plus en plus artificielles, les forces naturelles.
Dans le duo/duel homme/nature nous pouvons repérer quelques pièges. Celui qui caractérise l’ère anthropocène est de « techniciser » l’écologie pour la mettre au seul service de l’homme (anthropocentrisme) et non du vivant (biocentrisme) alors que l’humain fait partie des existants. Cela conduit à reproduire un comportement qui a contribué à la destruction de l’environnement. Or, si l’homme a besoin de la vie, la vie a aussi besoin de l’homme.
Pour Bruno Latour, notre habitude d’opposer ou associer culture et nature est responsable de notre inertie devant la crise actuelle et nous pousse à ignorer la réalité de la nature. Ce mauvais pli conceptuel fonde l’ère anthropocène en laquelle la nature est « désanimée », désormais considérée comme une sorte d’ « objet » au seul service de l’homme.
A l’opposé, toujours si l’on s’en tient à cette sorte de couple nature/culture, une autre erreur aboutissant à la crise climatique serait de « suranimer » la nature, c’est-à-dire de déplacer sur elle des conceptions religieuses, ou, comme l’auteur les nomme aussi, « contre-religieuses », c’est-à-dire prétendument à l’écart de la religion alors qu’elles en restent imprégnées. C’est ce qui se produit lorsque nous considérons la nature comme une unité, une globalité. Elle serait alors « totalisée », considérée comme seul milieu vivable.
On peut penser au film de Sean Pen « Into the wild » qui illustre bien l’aspect mortifère d’une telle conception. Il s’agit de l’histoire vraie de ce baroudeur dont l’obsession est de vivre au seul contact de la nature sauvage. Ceux et celles qu’il rencontre sur sa route et avec lesquels il noue des liens forts, tentent de le dissuader. Avide d’une fantasmatique liberté absolue au sein d’une nature matricielle, il ne distingue plus entre l’attitude légitime qui consiste à s’opposer aux aspects aliénants de la civilisation et la nécessité vitale de rester en lien avec les humains. Au moment où il comprend l’importance de ce lien et veut revenir sur ses pas, la rivière en crue lui barre la route, le poussant à réaliser les débordements implacables des catastrophes naturelles et quand, le gibier venant à manquer, il cherche à se nourrir de champignons, il en absorbe un vénéneux. Il est à l’article de la mort. Un grizzli tout à coup, est là qui l’observe et passe son chemin. Scène extraordinaire : sous l’œil indifférent de la bête, le monde sauvage conduit à la mort cet homme piégé dans une idéalisation de la nature.
Tant que nous ne parvenons pas à dépasser les théories traditionnelles qui opposent la culture et la nature, nous en remettant essentiellement pour la première à la science et à la technique et, pour la seconde à des conceptions philosophico- religieuses, nous restons enlisés dans une sorte d’hébétude passive ou dans des absurdités telles que le climato-scepticisme, sorte de négationnisme ou encore le clivage paradoxal entre les discours politiques et leur absence d’impact sur la réalité, tant sont fortes les puissances d’argent qui veulent poursuivre l’exploitation et bientôt l’épuisement des ressources de la terre.
L’on peut considérer comme une alerte le franchissement d’un seuil irréversible de production de CO2 dont on sait qu’il ne pourra être infléchi dans les prochaines années. Le signal d’alarme est continûment actionné par les chercheurs : il est urgent d’agir mais en même temps, les politiques ne contribuent que chichement à l’action et à la dépense quand ils n’accélèrent pas, en particulier dans les forages, un processus au terme duquel les rétroactions de la nature ne pourront être endiguées.
Pour mieux sortir de l’ignorance concernant le changement climatique, Bruno Latour propose un remaniement conceptuel dont deux aspects m’ont paru fondamentaux : tout d’abord ne plus penser en termes de nature et culture, ce qui comporte quelques difficultés dans la mesure où l’association des deux termes est au fondement de notre pensée aussi bien en ce qui concerne les sciences que la philosophie. Le sociologue propose de remplacer ce binôme en pensant plutôt en termes de terre ou de monde. Mais attention, deuxième point longuement développé par lui au cours d’une des conférences : il faut quitter l’idée de la sphère. Il emprunte ce point de vue à Sloterdijk qui, théorisant ce que l’on peut entendre par environnement (Umwelt) montre qu’il est impossible de le concevoir comme une sphère, c’est-à-dire un tout unifié. S’appuyant sur des recherches scientifiques, ce philosophe introduit l’idée de multiples environnements caractérisant les divers éléments qui composent la vie.
Il propose donc l’idée d’enveloppes multiples vitales pour ces éléments, chacun défendant la sienne.
Les « enveloppes » telles que Sloterdijk les théorise viennent renforcer l’un des concepts fondamentaux de Bruno Latour, celui des puissances d’agir. Même si Spinoza, à ma connaissance, n’est pas nommé sur ce point, on pense inévitablement à l’ « Ethique », Partie III, proposition VI : « Chaque chose autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être » ; si on lit cela avec l’idée des « enveloppes » de Sloterdijk, il devient clair que « pour persévérer dans son être », chaque chose, chaque élément du vivant, humains compris, exercera sa puissance d’agir- formulation récurrente dans les conférences de Bruno Latour mais que l’on rencontre aussi dans l’ « Ethique »- pour défendre son « enveloppe » contre ce qui pourrait la mettre en péril.
C’est là qu’intervient Gaïa, (« figure –enfin profane- de la nature » selon Bruno Latour) conçue, à l’inverse d’une globalité, comme une multitude d’éléments disparates, chacun défendant sa « puissance d’agir ». Au bout du compte, Gaïa, si désanimée par l’action des hommes que cela ne peut plus durer, rétroagit à nos actions, à sa manière, qui peut être cruelle comme elle l’était dans le mythe originel, ambivalente, se montrant tour à tour apaisante et mortifère. Ce faisant, elle devient un acteur jusque dans le champ politique.
L’auteur donne des exemples de ce que représente la « puissance d’agir » et l’on voit qu’il ne s’agit pas de volonté mais de pulsion de vie des existants mus par cette puissance. Le premier est emprunté au roman « Guerre et paix » de Tolstoï où les personnages agissent en dehors de toute prévision : ainsi le général Koutouzov gagnera la bataille de Tarutino contre Napoléon en ne l’engageant pas et il l’emportera parce qu’il sera, tout en y répugnant, resté immobile face aux nombreuses manœuvres de l’empereur. Le général n’agit pas mais se fait agir nous dit Bruno Latour, par des forces qu’il ne peut comprimer : « Il devrait avoir des buts mais il est si impuissant dans sa puissance, qu’il ne parvient même pas à les définir ».
Le second exemple, emprunté à un article journalistique met en scène l’action de l’équivalent américain des Ponts et Chaussées pour endiguer le cours du Mississipi dont le bassin méridional a été artificialisé et qui déborde régulièrement.. Deux acteurs, deux « puissances d’agir », sont face à face dans une situation de conflit entre ceux que l’auteur nomme anthropomorphes et ceux qu’il nomme « hydromorphes ».
Le troisième exemple, emprunté à la médecine, met en relief l’action du CRF, (facteur de libération de la corticotropine et de son action de régulation des systèmes endocrinien, cardiovasculaire, reproductif, gastro-intestinal et immunitaire.) Voici donc une nouvelle « puissance d’agir » dont l’auteur dit qu’elle ne se laisse pas approcher « avec le même plaisir que « Guerre et Paix ». Mais il n’y a aucun doute qu’en suivant le CRF, on pénètre bien dans les tours et détours de l’action qui se découvrent encore plus complexes que les replis de la décision de Koutouzof ou les méandres du Mississipi. »
Gaïa est donc, non pas un objet exploitable ou une globalité, mais une juxtaposition hétéroclite de « puissances d’agir » dont l’homme n’est que l’un des modes. Est-ce que savoir cela ouvre des issues à l’impasse climatique qui nous concerne actuellement ?
Laisser faire conduirait à la domination d’un principe de « raison du plus fort » entre la manifestation de toutes les « puissances d’agir » et à un irréversible règne de l’entropie qui m’a rappelé ce que décrit Nietzsche dans « La volonté de puissance » : « Le monde « n’a plus de sens » car il est mené par « un jeu de forces et d’ondes de force, s’accumulant sur un point si elles diminuent sur un autre une mer de forces en tempête, éternellement en train de changer, avec de gigantesques années au retour régulier, un flux et un reflux de formes allant des plus simples aux plus complexes, des plus calmes au plus fixes, des plus froides au plus ardentes, aux plus violentes, aux plus contradictoires, pour revenir ensuite de la complexité à la simplicité… ». Ce jeu des forces qui constituent le monde est immanent et Nietzsche l’a nommé « volonté de puissance ». Il s’agit de l’imprévisible quantum d’énergie qui anime aussi bien le monde que chacun d’entre nous, une sorte de poussée vitale : « Voulez-vous un nom pour ce monde ? Une solution pour toutes ses énigmes ? Ce monde est la volonté de puissance et rien en-dehors. Et vous-même êtes aussi cette volonté de puissance et-rien en-dehors- »
Nous placer « face à Gaïa » semble bien être, pour Bruno Latour, une façon de nous transmettre un savoir de ces interactions se déployant entre la terre et les hommes. Car désormais, Gaïa contre réagit à leurs actions par les multiples « puissances d’agir » qui la constituent. Et cela mène aux catastrophes bien répertoriées : épuisement des sols, déferlements climatiques, destruction des espèces (à quand la nôtre ?) etc.
Pour que ce duel ne soit pas meurtrier, il faudrait élaborer un travail de composition dont l’auteur nous donne des exemples. En particulier, il serait utile de donner une voix aux éléments de la nature, en s’en faisant porte-parole ou avocat dans des instances politiques, c’est-à-dire en l’animant sans la « suranimer ». En admettant que nous ne sommes pas « seuls aux commandes », nous devons partager le pouvoir avec les forêts, l’eau, la terre, les animaux.
C’est ce qui se passe en Hollande où les députés représentent les sujets humains mais où sont aussi élus des délégués appelés à siéger dans le Rijkwaterstaat, Autorité nationale de l’eau. Donc des autorités superposées s’exercent empiétant l’une sur l’autre et conduites par là même au partage d’un « modus vivendi ». Cet arrangement doit être élaboré et là où il ne l’est pas, en Californie par exemple, où personne ne représente dans la Vallée centrale, l’aquifère dans lequel pompent les arboriculteurs, une situation anarchique s’installe, quand chaque fermier vole l’eau de ses voisins, préludant à une tragédie des communs. Il est donc vital que Gaïa devienne un acteur politique.
Une simulation théâtrale au théâtre des Amandiers a eu pour objectif, en mai 2015 juste avant la Cop21 de réaliser une vision politique prenant en compte la question des diverses « puissances d’action » animant la terre. Plusieurs délégations (41) furent constituées, conscientes du fait que l’on ne peut plus laisser les Etats occuper seuls la scène dans la mesure où ils prennent principalement en considération les enjeux économico- politiques, laissant les forces de la nature à l’extérieur de leurs calculs et négociations, aucune instance ne se faisant porte-parole de ces forces, de sorte que l’on en reste à des actions managériales comme à des promesses vite trahies.
Au théâtre des Amandiers, par contre, il y eut, à côté des délégations « Australie », « Etats Unis » etc., représentant les Etats, des délégations « Sols », « Océans », « Espèces en voie de disparition » etc. Chaque délégation travaillait seule, complètement isolée des autres. Ensuite avaient lieu débats et négociations animés par une présidente. L’entreprise faillit rater à plusieurs reprises et il n’y eut pas de conclusion mais cette fiction peut apparaître comme l’anticipation d’une politisation nécessaire des rapports de forces constituant la terre si nous ne voulons pas que ses contre- réactions aux actions exercées sur elle, ne génèrent une entropie menant à la destruction des humains. Et cette politisation à venir est, elle aussi, de l’ordre de la fiction, celle qu’il faut pour imaginer un progrès.
Deux aspects de l’ouvrage m’ont troublée : la référence à Schmitt et une sorte de point aveugle quant au religieux resté prépondérant, me semble-t-il, dans la conceptualisation de Gaïa.
J’ai une aversion profonde pour Carl Schmitt et sa pensée proche du nazisme. Bruno Latour tout en se démarquant quelque peu de lui, lui emprunte l’idée d’une nécessité d’identifier son ennemi. C’est toute la théorie de l’ennemi chez Schmitt que je récuse. Une nécessaire identification de l’« ennemi » est conceptualisée par lui comme le fondement même du politique, ce qui laisse envisager, selon lui, des guerres absolues, qui, dès lors qu’on les prévoit, ont déjà commencé. Je ne peux m’empêcher de penser à l’idéologie de l’E.I. Carl Schmitt va jusqu’à désigner « le Juif » comme « ennemi absolu » : «L’’ennemi, «l’autre, l’étranger», dont la désignation constitue pour Schmitt l’essence même de la politique, est ici clairement identifié. C’est le juif – un ennemi non pas «conventionnel», mais, selon une distinction que fera ultérieurement Carl Schmitt lui-même, un ennemi «absolu» ( article de l’Express sur Google : « Schmitt nazi à l’insu de son plein gré ») ; rien qu’à les lire/écrire, ces propos souillent la langue et la pensée ; ils sont juste bons à être vomis et, pour en revenir à la lutte entre Gaïa et les humains, pourquoi pas, plutôt, puisque des interrelations conflictuelles se produisent entre tous les éléments qui constituent les « puissances d’agir » de la terre et du monde, ne pas préférer « adversaire » à « ennemi », dans une sorte de « partenariat antagoniste » ?
En ce qui concerne le religieux, Bruno Latour le dénonce disant que, sous son influence, nous avons développé, même en toute mécréance, une représentation de la Nature une et globale. Alors je me suis étonnée des accents chrétiens accompagnant dans ses conférences l’idée d’une incarnation des multiples éléments constitutifs de la terre. Pour ma part, si je peux penser qu’en effet, incarnation il y a, je la considère plutôt sous l’angle d’une affinité des particules/ondes constituant les existants influencés par les champs d’énergie qui, s’exerçant sur eux, les informent. Et puis pourquoi recourir pour évoquer la disparate du monde, à une figure originaire de la Terre-Mère n’excluant pas l’élément religieux, fût-il païen ? Le non-lien tel qu’il s’énonce ici, entre Gaïa et religion, reste à mes yeux, ambigu voire paradoxal. Mais peut-être a-t-il en partie échappé à mon entendement.
Quoiqu’il en soit, j’ai le plus souvent parcouru cet ouvrage avec beaucoup d’enthousiasme mais ne parviens à en donner ici une qu’une vision fragmentaire et simplificatrice tant il est foisonnant et étayé. L’inventivité manifeste y invite à la pensée, dénonce la catastrophique inertie des humains face à l’évolution climatique, propose des outils politiques permettant d’envisager une issue possible à l’impasse, faute de quoi la terre se déroberait sous nos pas, d’autant plus inexorablement que ceux des vivants humains qui spéculent dans le domaine du profit, du pouvoir, des idéologies, des algorithmes, tendent à étouffer, pour mieux régner, l’esprit critique de leurs congénères de telle sorte que l’on pourrait bien assister à une destruction de l’espèce humaine par elle-même si aucun sursaut ne se produit. Bruno Latour énonce dans « Face à Gaïa » les conditions d’une possibilité de ce sursaut.
Noëlle Combet, ©Copyright Temps marranes n°28
Avec tous nos remerciements à Claude Corman et Paule Pérez, éditeurs de la Revue Temps marranes
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents
Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments