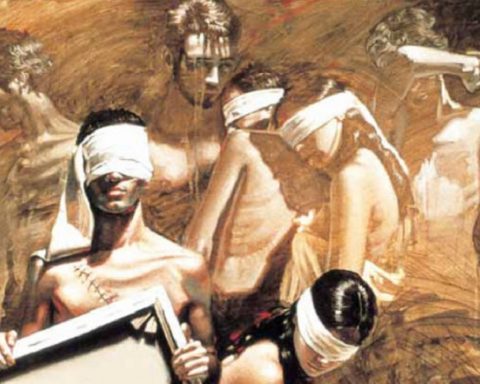Nous verrons, dans une série de trois articles publiés cette semaine sur The Conversation France, que la définition de règles strictes sur les conflits d’intérêts reste inutile tant qu’elle ne s’accompagne pas de garanties sur la transparence et sur l’existence de garde-fous dans les modalités d’élaboration de la décision politique.
Les quatre étapes de la gestion du risque sanitaire
Comment les risques sanitaires et environnementaux sont-ils censés être pris en charge ? Très schématiquement, on peut considérer que cette prise en charge se fait en quatre étapes successives :
Etape 1, l’alerte
Une question scientifique est posée par des chercheurs, des associations, des citoyens, des agences gouvernementales – par exemple sur les effets cardiaques de tel médicament prescrit comme coupe-faim aux patients diabétiques, ou sur la nocivité d’un pesticide ;
Etape 2, la recherche
Des études scientifiques s’appuyant sur différentes disciplines pouvant éclairer les divers aspects du problème sont réalisées ;
Etape 3, l’expertise
Les connaissances des études publiées au niveau international sont synthétisées par des scientifiques encadrés par les agences sanitaires, les « experts » ;
Etape 4, la décision politique
Enfin, une décision de gestion du risque est prise au niveau politique. Elle peut être de limiter l’exposition à une substance, d’interdire la prescription d’un médicament globalement, ou pour certaines indications ou populations à risque, de limiter les émissions d’un site polluant ou la teneur d’un additif dans l’alimentation, ou encore de ne rien changer.
Ce processus est fragile et peut être perturbé à chacune de ces quatre étapes, comme l’illustre l’histoire de la gestion des risques sanitaires et environnementaux. Illustrons d’abord le problème de l’émergence éventuelle de conflits d’intérêt au moment où les scientifiques, puis les experts, se saisissent d’un dossier.
Minamata, années 19500
Dans les années 1950, dans la baie de Minamata, au sud du Japon, le directeur de l’hôpital de l’entreprise Chisso, principal centre sanitaire de la région, annonce avoir observé des troubles neurologiques n’évoquant aucune pathologie connue (troubles de la marche, convulsions…) chez une petite fille de cinq ans, puis chez sa sœur. Des symptômes neurologiques similaires sont observés dans la faune, tels que les chats de la baie (la maladie est aussi appelée maladie des chats qui dansent). L’alerte concernant ce qu’on appellera la maladie de Minamata est lancée. Elle donnera lieu à plusieurs années de recherches pour identifier le facteur causal (qui s’avérera être le mercure et son dérivé organique le méthylmercure), la voie de contamination (les poissons et fruits de mer locaux), et la source –les rejets de l’usine Chisso employant les médecins de l’hôpital.
Une commission d’enquête a été mise en place : l’alerte a donc bien été reçue par les pouvoirs publics (ce qui n’a toutefois pas suffi à régler le problème rapidement). Ce n’est pas toujours le cas. Dans un autre dossier, aux États-Unis en 1925, la commercialisation par General Motors d’une essence au plomb a suscité des craintes de la part de médecins concernant sa toxicité. Ils n’ont pas été entendus et le débat sur cette question a longtemps été étouffé.
« Tobacco papers »
Une fois l’alerte donnée, les scientifiques entrent en scène pour vérifier la réalité du problème et le cas échéant, caractériser son ampleur, ses causes, éventuellement les mécanismes sous-jacents. Ici, le processus peut dérailler si des scientifiques sont incités à fabriquer une étude de toutes pièces, ou à la falsifier délibérément. Un exemple célèbre est l’action de l’industrie du tabac. Des chercheurs ont, ainsi, été approchés, financés, et leurs travaux, qui avaient tendance à minimiser les effets sanitaires du tabac, publiés dans des revues scientifiques. Le processus a été dévoilé, bien après coup, par les « Tobacco papers », documents internes des industries du tabac dont la justice américaine a exigé la publication.
Dans d’autres domaines, il a été montré que la probabilité qu’une étude ait une conclusion en faveur des intérêts d’une industrie est nettement plus importante si l’étude a été soutenue par cette industrie que si elle a été réalisée à partir de fonds publics.
Il peut aussi arriver qu’à ce stade, en raison d’un conflit d’intérêt, la publication d’une étude soit empêchée. C’est d’autant plus facile s’il existe un lien de hiérarchie qui lie le chercheur à des mandataires qui n’ont pas intérêt à la révélation du risque. Lors des investigations visant à identifier l’origine de la maladie de Minamata, le médecin dirigeant l’hôpital avait entrepris des expériences dans lesquelles il avait fait ingérer à des chats de la nourriture contaminée par les effluents de l’usine.
Il a ainsi reproduit dans ces expériences les mêmes symptômes neurologiques que ceux observés parmi les chats de la baie. La direction de l’entreprise lui a ordonné de cesser ses travaux et de ne pas les divulguer, retardant la démonstration de la culpabilité de l’usine. Il n’avouera avoir obtenu ces résultats, et les pressions subies, que sur son lit de mort.
Des lettres qui sèment le doute
Ce processus de falsification de la science est lent et lourd à mettre en œuvre, et probablement rare aujourd’hui. Mais d’autres situations, moins « brutales », peuvent survenir. Il peut par exemple s’agir d’une présentation sélective de certains résultats, ou de choix méthodologiques qui ne mettent pas le chercheur dans la situation la plus favorable pour mettre en évidence un effet éventuel d’une substance (par exemple en choisissant un modèle animal peu « sensible » ou en réalisant une étude sur un effectif trop faible pour mettre en évidence un effet).
Mais bien souvent, les interventions d’intérêts extérieurs dans le jeu de la science se font aujourd’hui par de simples lettres à l’éditeur des revues scientifiques qui viennent de publier une étude suggérant un effet néfaste d’une substance. Ces lettres vont généralement mettre en doute la méthodologie, accuser l’auteur de ne pas avoir cité des références importantes… L’exercice est assez simple à réaliser car peu d’études sont parfaites, et car l’on se dispense généralement de fournir des résultats contradictoires.
Ces lettres ou commentaires peuvent ensuite être cités pour dire que l’étude en question n’était pas si bien faite que cela, ou est « débattue » par les scientifiques. C’est ce qu’on appelle la fabrique quotidienne du doute.
Des « mercenaires parlant science »
Si le doute est au cœur de la démarche scientifique et est constructif quand il provient de chercheurs spécialistes de la question, mus par la volonté d’amélioration des connaissances et s’appuyant sur une démarche transparente et rigoureuse, il n’a plus de sens lorsqu’il est motivé par des intérêts extérieurs à la question scientifique et propagé par des « mercenaires parlant science ». Dans ce cas, la pratique du débat et de la mise en question des résultats scientifiques, normalement interne à la science, est dévoyée par des intérêts extérieurs.
Un exemple récent est celui d’un « éditorial » publié en 2013 par des chercheurs, rédacteurs en chef de revues de toxicologie et pharmacologie, dans leurs propres revues et critiquant la politique européenne concernant la réglementation des perturbateurs endocriniens. Le format (l’éditorial), et le fait que l’article était signé par les rédacteurs en chef des journaux scientifiques les publiant, ont probablement permis de passer outre la procédure classique de relecture et examen par les pairs. Les rédacteurs en chef s’étaient aussi dispensés de déclarer tout conflit d’intérêts sur ce sujet concernant de nombreux secteurs de l’industrie, ce qui leur a été par la suite reproché. Une enquête journalistique a mis en évidence qu’ils étaient nombreux. Malgré ces ficelles grossières, ce texte a pu contribuer à retarder l’application de la loi réglementant la présence de perturbateurs endocriniens dans les pesticides, votée en 2009, et qui à ce jour n’est toujours pas pleinement appliquée.
Dans un second article, nous montrerons comment les conflits d’intérêts peuvent fausser le processus d’expertise. Dans le troisième et dernier volet de cette série, nous aborderons les progrès qui restent à accomplir dans la manière de les gérer.
Rémy Slama, Directeur de recherche en épidémiologie environnementale, Inserm, Université Grenoble Alpes
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.