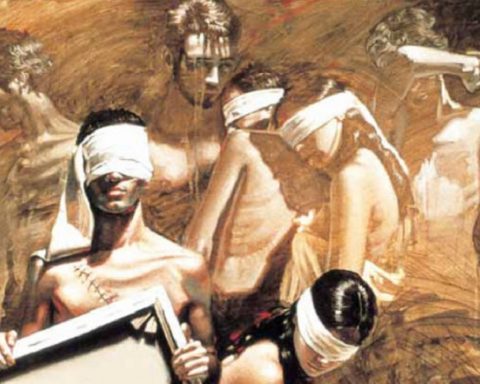L’incendie de Notre-Dame de Paris, le lundi 15 avril, a produit une sidération d’une ampleur aussi rare que subite, saisissant la France entière et bien d’autres pays au-delà des frontières, en Europe, en Amérique, en Asie. Alors que les braises n’étaient pas encore éteintes, très tôt s’est manifestée de façon spontanée une volonté de contribuer fortement à l’immense chantier de reconstruction qui s’annonçait. Tout le monde l’aura noté, ce furent les familles du luxe qui lancèrent le mouvement : la famille Pinault, la famille Arnault, la famille Bettencourt. Ce sont les trois grands noms du luxe en France, ceux-là même qui contribuent à développer le soft power de la France, sa culture, son rayonnement sur les marchés mondiaux, à travers les marques de luxe réputées des groupes Kering, LVMH et L’Oréal.
Chacun aura été frappé aussi par le montant significatif des dons annoncés, dont le cumul dépassait le milliard d’euros à peine 48 heures après le drame. Ces sommes sont à la hauteur de la fortune, immense, des donateurs, mais également à la mesure du coût probable des travaux. Elles sont enfin au niveau de la charge symbolique exceptionnelle de cet incendie qui faillit mettre à terre un édifice incarnant à lui seul toute l’Histoire de France, ses racines, sa culture, son identité, que l’on soit croyant ou non.
Pourquoi le luxe s’est-il porté aux avant postes de la volonté de refuser le destin annoncé et des forces de la reconstruction de Notre-Dame ? Éliminons d’emblée les thèses qui voudront ne voir là que stratégie de communication ou fiscale. C’est mal connaître les créateurs de ces groupes. En réalité, les causes sont d’une autre nature, liée à la fonction profonde du luxe et à la spécificité du luxe à la française.
Le luxe, une origine religieuse
Le luxe est l’industrie de l’excellence, mais elle a commencé comme une activité sacrée. De tout temps, dans tous les pays où l’activité de luxe a pu se développer, les meilleurs artisans se sont mobilisés pour inventer, créer, fabriquer des produits d’exception, faits de matières rares les plus précieuses, et sur lesquels le temps de travail n’était pas compté, présents inestimables offerts en sacrifice aux dieux, soit pour se les concilier avant la bataille, soit pour les remercier à la hauteur des victoires, ou des bonnes récoltes. Le prix très élevé de ces produits est précisément ce qui permet d’être offert en sacrifice, c’est-à-dire au sens littéral « ce qui fait le sacré ». C’est pourquoi les temples étaient recouverts d’or, les églises ornées des plus beaux objets, et les artistes prompts à donner le meilleur d’eux-mêmes à cette fin.
Après les dieux vinrent les demi-dieux, les nobles, les castes dominantes, auxquelles rien n’était refusé, privilège de la naissance. La Révolution française mit fin aux privilèges de la naissance, mais pas au droit d’accéder au beau, au sublime par la vertu de sa propre fortune, c’est-à-dire de son destin et de ses moyens. Les révolutions communistes elles-mêmes ont commencé par une phase d’éradication des inégalités, mais les pays qui les ont vécues ont été obligés de relancer leurs économies en lâchant la bride à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Autrement dit, à une libéralisation… qui a recréé des inégalités à l’arrivée.
Or le luxe se nourrit justement des inégalités, car il faut que certains aient plus d’argent pour que l’on puisse payer les objets à la hauteur de leur préciosité. Partout dans le monde, les classes sociales montantes veulent jouir de leurs efforts et se voir reconnues. D’où la croissance remarquable de l’industrie du luxe.
Même s’il est réel que cette croissance soutenue résulte de l’arrivée successive des vagues de nouveaux riches, hier du Japon, puis de Russie et maintenant de Chine, ce serait une erreur de ne voir dans la consommation de luxe que la recherche du paraître, du « bling bling ». C’est vrai dans une première étape de la vie des clients mais très vite ceux-ci accèdent à une vérité plus profonde, celle de la dimension culturelle et sacrée des objets qu’ils achètent si cher. Car le paradoxe du luxe est qu’il élève les acheteurs, pas uniquement dans la perception des autres par la valeur connue des produits et logos affichés, mais aussi en leur offrant une voie de sortie du quotidien, grâce à la possession d’une pièce incomparable qui condense toute la spiritualité, la culture vivante d’un pays, son histoire, son art.
Cultures du lieu, du temps, du sacré
Le luxe, en particulier à la française, érige en condition sine qua non pour être luxe de pouvoir condenser l’unicité d’un lieu, d’un héritage historique, et d’une filiation. Ce luxe-là fait de l’espace, du temps long et du sang les bases de son rayonnement et de sa quête de suprématie. D’où l’importance du « made in », du culte des origines, du respect du fondateur et de son legs. Les marques de luxe, à l’image d’Hermès ou de Chanel, y font en permanence référence comme leur patrimoine le plus précieux car cette pérennité ancrée dans un lieu d’origine et portée par un créateur est ce qui fonde leur « non-commercialité », le refus de se considérer comme des produits de simple commerce.
En réalité, l’industrie du luxe se veut elle aussi sacrée : ses marques parlent de leurs « icônes », elles bâtissent des « cathédrales » dans les capitales du monde entier, dédiées à la magnificence de la marque, au développement de la communauté des croyants, qui adhèrent émotionnellement. Aucune autre industrie ne valorise autant la notion de patrimoine, comme fondement de son unicité : les marques de luxe se projettent d’autant plus dans le futur qu’elles ont l’assurance de leur passé qui les distingue, comme il confère distinction aux adeptes de la marque.
On comprend alors l’affinité profonde entre ce secteur et Notre-Dame, patrimoine de la culture française, de son histoire, là où se concentre le sacré national depuis huit siècles. Le luxe est la vitrine de la France, de sa capacité à produire des objets dérivés de l’art issus de marques d’élégance nourries par leur histoire et leurs lieux. La France, qui représente une histoire et un terroir communs à ces marques, a pour symbole quelques monuments érigés au rang de patrimoine de l’humanité, au premier rang desquels figure Notre-Dame.
Les familles, pas les marques
Il n’aura échappé à personne que les maisons de luxe sont les nouveaux mécènes de l’art aujourd’hui. Hier les familles patriciennes de Florence ou de Venise encourageaient les arts, tout comme nos Rois de France avant que l’État ne se porte garant de la culture et de sa diffusion à tous en développant musées, écoles d’art, académies, etc. Mais l’État-providence ne peut pas tout. En outre, l’art est devenu un marché très spéculatif où les prix des tableaux ou sculptures s’envolent, car ces pièces sont uniques, donc objets de rivalité pour leur possession par les musées du monde entier, dont ceux, désormais, des pays émergents.
L’État étant limité dans ses dépenses, le luxe est devenu mécène incontournable de l’art. Il en a les moyens et le savoir-faire. Cela s’inscrit également dans une démarche à long terme dite d’artification visant à transformer le non-art en art. Le luxe se veut le produit dérivé de l’art. D’où la multiplication des collaborations avec les artistes contemporains de tous pays, le sponsorship d’expositions grandioses hymne aux créateurs de mode, ou encore la création de musées comme la Fondation Louis Vuitton.

Le bâtiment de la Fondation d’entreprise Louis Vuitton, à Paris, a été inauguré en 2014. Oliverouge 3 / Shutterstock
Cela change la perception des objets du luxe eux-mêmes. À ce titre, il était naturel que les grandes maisons du luxe se portent d’emblée au secours de cette grande maison symbolique qu’est Notre-Dame. Le secteur du luxe doit beaucoup à la France, il se devait de le lui rendre.
On notera enfin que les offres de dons furent portées au nom des familles elles-mêmes, Pinault, Arnault, Bettencourt… certes à travers leurs fondations dont c’est la fonction, mais pas à travers leurs marques notoires. Car la portée symbolique eût été toute autre. La mise en avant des marques, c’est « faire du commerce », c’est réintroduire les marchands du temple au moment où l’édifice lui-même avait un pied à terre, et où toute idée d’intérêt à court terme est bannie. C’eût été surtout déroger au sacré…
Jean-Noël Kapferer, Professeur Senior, INSEEC Business School
Cet article est republié à partir de The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine. Lire l’article original.
Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.![]()