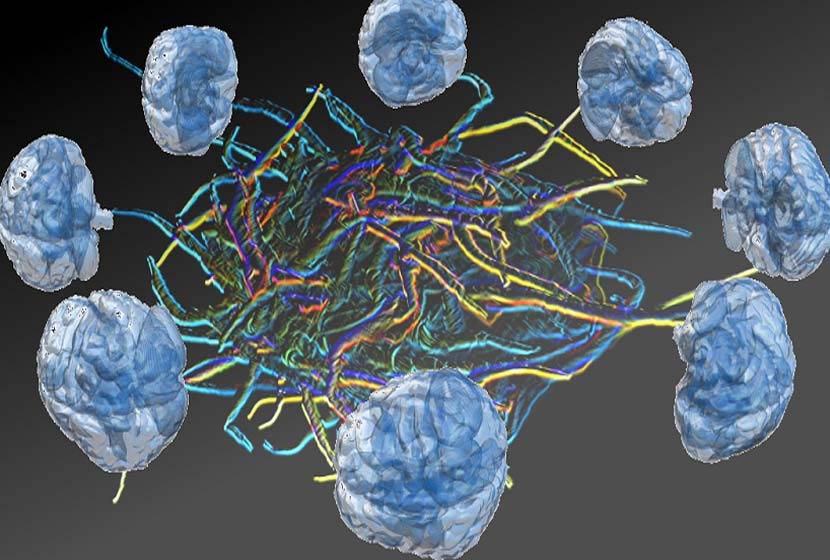Le libéralisme moderne n’est pas totalitaire mais il est intransigeant ; il fournit un programme maximum dans lequel les gouvernements vont choisir ce qui est le plus adapté en fonction des circonstances conjoncturelles ou du contexte institutionnel. Il est ainsi hautement fonctionnel puisqu’il fournit un répertoire très large de mesures radicales possibles, adaptées aux diverses circonstances. De ce fait, il démontre sa capacité à embrasser tous les aspects de la société et à fonctionner comme vecteur d’une vision hégémonique du monde. C’est dans cette logique qu’apparaît un terme relativement nouveau dans le lexique politique : la gouvernance, qui serait, par excellence, l’ « outil idéologique pour une politique de l’État minimum » (1).
Véritable concept-valise, le concept de gouvernance est souvent présenté de façon très générale et abstraite comme une solution à des problèmes très hétéroclites allant du développement au sous-développement, de la crise du politique à celle des relations internationales, de la vie des entreprises aux prises en compte humanitaires et éthiques. Dans le contexte de perte de vitesse des États, la gouvernance est présentée comme un moteur de régulation sociale, politique et économique aussi bien à l’échelle de la communauté locale qu’à celle de la planète ; en bref, ce serait l’outil miracle pour repenser les fondements démocratiques de nos sociétés.
● D’une manière générale, il est attribué deux types de définitions au concept de gouvernance : une définition restrictive renvoyant à l’idée de modèle de gestion institutionnel ou administratif ; une deuxième définition faisant référence à un système de régulation destiné à faire vivre ensemble des individus ou des communautés. Dans un sens restrictif qui délimite la gouvernance politique, le concept est en général assorti de l’épithète « bonne » qui appelle l’idée de gouverner sans faire de déficit important, sans gaspillage des fonds publics et sans trop de corruption. A l’échelle des ambassades et des institutions internationales, le concept prend une dimension complémentaire à la première. La gouvernance consiste à ce que les pouvoirs publics gouvernent de manière non-autoritaire, en se concertant avec des groupes organisés tels que les syndicats, les partis, et plus généralement tous les protagonistes de la société dite ‘civile’. S’introduit ici une certaine idée de la démocratie, ouverte à d’autres acteurs que les protagonistes habituels. La gouvernance sert alors à désigner une situation dans laquelle la responsabilité n’est plus du ressort du seul gouvernement, d’un seul type d’acteur étatique. Elle est élargie à « l’ensemble des activités de médiation et de domination entre acteurs aux statuts et aux ressources très divers en vue de mettre en place des politiques efficaces et cohérentes. »(2) Les enjeux dépassent alors mécaniquement les limites administratives et l’organisation verticale de l’État.
● Il est intéressant de remarquer que le concept de gouvernance appliqué à l’État a été porté sur les fonts baptismaux du monde actuel par la finance et plus particulièrement par la Banque mondiale, en 1989, à l’occasion d’un rapport sur l’Afrique sub-saharienne. Mais c’est en 1992 que la Banque définit la gouvernance, d’une part par les processus à travers desquels l’autorité est exercée dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays, d’autre part, par la capacité des gouvernements à concevoir, formuler et exécuter des politiques et à s’acquitter de leurs fonctions.
En 1999 la Banque passe un nouveau cap en introduisant l’idée d’ « indicateurs de gouvernance ». Démontrant par une pirouette logique que la gouvernance est une réalité… puisque l’on peut la mesurer, la Banque énonce les critères –objectifs car mesurables– du type de « gouvernance idéale » (3) . Nous retrouvons dans cette conception de la gouvernance, la logique de la corporate governance, appliquée aux entreprises dès les années soixante-dix, et visant essentiellement à articuler les intérêts des actionnaires à ceux des gestionnaires, à améliorer la transparence et à aménager les relations entre l’entreprise et son environnement extérieur. Dans cette acception, la gouvernance d’entreprise pose d’emblée des questions d’essence politique telles que la séparation des pouvoirs, la distinction entre la possession et le contrôle.
Il est donc intellectuellement aisé de transposer le sens du domaine de l’entreprise à celui de la politique : le gouvernement étant conçu comme un organe de gestion, l’État comme une entreprise, le citoyen comme un usager ou un consommateur, élément du « capital humain ». L’ensemble vivant au contact d’un ensemble flou d’organismes, d’institutions, d’individus formant la ‘société civile’ et devant tenir compte des réalités du marché, de la concurrence et des intérêts financiers des bailleurs de fonds. Dans cette conception, sont préférées les régulations molles (soft laws) ou normes, –privilégiées par les acteurs du marché–, aux lois, juridictions dures (hard laws), habituellement pratiquées par les États.
 ● Ce glissement de la gouvernance d’entreprise à la gouvernance d’un État n’est pas une caricature ou une simplification littéraire. Le concept de gouvernance entérine en effet la privatisation de la décision politique au profit des acteurs économiques et sociaux ; elle poursuit le travail du libéralisme moderne de réduction du périmètre de l’État et de la transformation de son gouvernement en une question de gestion et d’administration technique.
● Ce glissement de la gouvernance d’entreprise à la gouvernance d’un État n’est pas une caricature ou une simplification littéraire. Le concept de gouvernance entérine en effet la privatisation de la décision politique au profit des acteurs économiques et sociaux ; elle poursuit le travail du libéralisme moderne de réduction du périmètre de l’État et de la transformation de son gouvernement en une question de gestion et d’administration technique.
Dans cette optique de privatisation de la décision politique, des fonctions de plus en plus nombreuses, qui étaient assignées autrefois à l’État, sont déléguées à la société civile ou au marché. Se posent alors de vraies questions portant sur les confins de la souveraineté étatique.
● Pourtant, paradoxalement, la gouvernance symbolise aussi le renouveau du politique, celui du passage d’une gouvernementalité verticale fondée sur la représentation à une gouvernementalité horizontale articulée sur des logiques participatives et transversales. Cette ambivalence, que d’aucuns prendront pour une belle utopie, s’appuie pourtant sur une argumentation logique. En effet, la gouvernance a pour objectif de définir des modes de gestion cohérents dans un contexte où les sociétés deviennent de plus en plus ingouvernables selon les procédés classiques. Face à l’éclatement du territoire, à la force des réseaux de toutes natures, à la montée des individualismes, à la mondialisation extrême des problèmes comme à leur régionalisation, il faut redéfinir le mode de gestion gouvernementale. La gouvernance en permettant notamment l’articulation entre les acteurs publics et des acteurs privés, entre les protagonistes de la triade État/société civile/marché, serait un modèle de gestion des affaires communes et d’exercice partagé de la responsabilité. Dans cette logique, l’action publique prend en compte la multiplicité des acteurs et abandonne le sens vertical d’un pouvoir imposé par le haut.
● Quand cette conception de la gouvernance est transposée à l’international, elle devient « gouvernance globale » et impacte directement les modes de relations entre États à travers notamment le droit international classique (4). Cette conception rompt avec l’idée d’un ordre mondial unique ou d’un gouvernement mondial dont certains rêvent ou cauchemardent. Rupture provisoire peut-être mais toujours est-il que la conception actuelle de la gouvernance globale prend acte de la différenciation des acteurs et des mécanismes plus ou moins légitimes de régulation qui façonnent le monde contemporain : États, sociétés multinationales, diasporas, réseaux de solidarité, organisations internationales, etc.
James N. Rosenau, professeur à Cambridge, explique que raisonner en terme de « gouvernance globale », c’est adopter une posture de recherche qui parie sur la possibilité d’actions de coopération à l’échelle internationale prenant en considération des intérêts divergents et des rationalités conflictuelles (5).
Cependant, en y regardant de plus près, on voit, en filigrane de cette notion, le façonnage des intérêts du marché. La notion de gouvernance globale est en effet un moyen d’envisager de nouvelles formes d’élaboration de normes sociales et juridiques destinées à combler le vide qui existe actuellement entre le droit international classique –apanage exclusif des États– et un droit transnational construit par les opérateurs privés pour la bonne marche des affaires et le respect de la concurrence.
(1) Marie-Claude SMOUTS, Du bon usage de la gouvernance en relations internationales, in Revue internationale des sciences sociales, Unesco, n° 155, mars 1998
(2) Bernard JOUVE, Globalisation et politiques d’environnement : le cas du Protocole de Kyoto, in espaceTemps.net, mai 2004
(3) Trois cents critères sont ainsi définis par trois économistes de la Banque auxquels se joignent des experts du Forum économique mondial de Davos, du Wall Street Journal et de la Heritage Foundation. La mission de cette Fondation est décrite sur son site Internet (heritage.org) : « formuler et promouvoir des politiques publiques conservatrices basées sur les principes de libre entreprise et de limitation de l’État, sur la liberté individuelle, les valeurs traditionnelles américaines et sur une défense nationale solide. » Les indicateurs de gouvernance sont regroupés en six grandes catégories : pouvoir d’influence et responsabilité, instabilité politique et violence, efficacité des pouvoirs publics, poids de la réglementation, primauté du droit et lutte contre la corruption. Ces indicateurs sont utilisés par la Banque pour ses attributions de prêts en complément de sa grille de notation politique, le Country Policy and Institutional Assessment (CPIA). Cette grille comprend quatre catégories (Management économique, Politiques structurelles, Politiques sociales, Institutions et management des services publics) qui permettent d’évaluer la « performance politique » des États débiteurs. Cf. : Thibault LE TEXIER, Gouvernances, in rinoceros.org, décembre 2004.
(4) Cf. Bertrand BADIE & Marie-Claude SMOUTS
(5) Cf. : James N. Rosenau & Ernt-Otto Czempiel, Governance without Governement : Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992