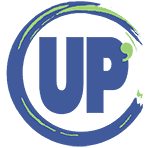La Haute mer commence où s’arrêtent les zones économiques exclusives des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes et n’est donc sous la juridiction d’aucun Etat. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques. La preuve a été faite de l’importance de protéger tout entier ces océans foisonnant d’une biodiversité souvent microscopique, qui fournit aussi la moitié de l’oxygène que nous respirons et limite le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. Mais les océans s’affaiblissent, victimes de ces émissions (réchauffement, acidification de l’eau…), des pollutions en tout genre, et de la surpêche. Le 4 mars 2023, les États membres de l’ONU se sont enfin mis d’accord sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l’humanité. Selon les scientifiques, la politique de protection de la haute mer offre ainsi une opportunité historique d’adaptation au changement climatique. Dans un nouvel article, ils détaillent comment le nouveau Traité des Nations unies sur la haute mer peut aider à protéger les espèces marines dans les eaux chaudes d’un océan en mutation.
En juin 2022, à la Conférence des Nations Unies pour l’océan, l’UNESCO rappelait la communauté internationale à renforcer au plus vite ses actions « pour mieux comprendre et mieux protéger les océans ». L’humanité a dix ans devant elle pour comprendre que la Terre est d’abord et avant tout un océan. « Notre destin dépend de la façon dont nous en prenons soin, ensemble. » Dès l’année prochaine, les vastes eaux internationales de l’océan pourraient bénéficier, pour la première fois, de règles destinées à protéger entièrement la biodiversité, une fois que le très attendu Traité des Nations unies sur la haute mer aura été ratifié par 60 juridictions nationales pour pouvoir entrer en vigueur. Alors que les pays se réunissent plus tard ce mois–ci en vue d’identifier les institutions et processus nécessaires à la mise en œuvre du Traité, les scientifiques soulignent dans un nouvel article publié aujourd’hui dans Nature combien il est important de tenir compte des défis spécifiques posés par la crise climatique.
La « haute mer », soit toutes les eaux internationales et le fond marin en dehors de la juridiction d’un pays, est un espace que la science ne connaît pas encore parfaitement bien. Elle comprend deux tiers de l’océan mondial et constitue l’un des plus grands réservoirs de biodiversité sur Terre, fournissant des itinéraires migratoires pour des espèces telles que les baleines, les requins et le thon, et hébergeant des écosystèmes de haute mer uniques. Cependant, seulement 1 % de ces eaux sont entièrement protégées. Le besoin de protections en haute mer est essentiel pour pouvoir atteindre les objectifs mondiaux de durabilité, tels que ceux du Cadre mondial de la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique, ceci incluant la protection d’au moins 30 % des océans d’ici 2030 (30 x 30).
- LIRE DANS UP’ : Protection des océans : les « efforts significatifs » de la communauté internationale
Les obligations des États de préserver les océans
Le 21 avril 2024, le Tribunal international du droit de la Mer (TIDM) est rentré dans l’histoire en devenant le premier organe judiciaire international à rendre un avis consultatif sur le climat. Comme l’explique un article de The Conversation, cet avis qui fera date conclut à l’obligation des États de protéger et de préserver les océans de la planète des effets du changement climatique. C’est la première fois qu’un tribunal international se penche sur les obligations des États en matière de changement climatique dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dite « de Montego Bay ».
Trois points décisifs ont permis au Tribunal d’affirmer l’obligation de protection et de préservation pour les États :
- Le rôle des océans dans la protection contre le changement climatique ;
- La qualification des émissions de gaz à effet de serre (GES) en tant que « polluants » marins ;
- Les obligations des États de préserver les océans à cet égard.
Pour cela, les arguments scientifiques ont tenu une place centrale. Dans son raisonnement, le Tribunal a repris le dernier rapport du GIEC à travers plusieurs arguments clés, notamment :
- l’océan est « un régulateur climatique fondamental à des échelles de temps saisonnières à millénaires » ;
- l’accumulation de GES anthropiques (définies par les juges comme « résultant des activités humaines ou produit par elles ») dans l’atmosphère a eu de nombreux effets sur l’océan ;
- les émissions anthropiques de GES « ont conduit à des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux qui sont sans précédent depuis au moins les 800 000 dernières années ».
En ce qui concerne les risques liés au climat, le Tribunal rappelle que, selon le GIEC toujours : « Les risques et les effets néfastes prévus ainsi que les pertes et dommages connexes liés aux changements climatiques augmentent. »
« L’augmentation de la fréquence des vagues de chaleur marine accroîtra les risques de perte de biodiversité dans les océans. »
Autrement dit, le Tribunal établit, grâce aux arguments scientifiques du GIEC, un lien de causalité entre les émissions de GES d’une part, et le réchauffement des océans et la perte de biodiversité marine d’autre part. Ce sont ces éléments qui ont ensuite permis aux juges de conclure que les émissions anthropiques de GES dans l’atmosphère constituent une pollution du milieu marin.
Pour sauver la haute mer, planifier le changement climatique
Le nouvel article, « To save the high seas, plan for climate change » (Pour sauver la haute mer, planifier le changement climatique), décrit pourquoi et comment le « High Seas Treaty on biodiversity beyond national jurisdiction » (BBNJ – Traité sur la haute mer et la biodiversité au-delà de la juridiction nationale) offre l’opportunité unique d’intégrer les changements du milieu marin liés au climat dans son cadre de mise en œuvre. Alors que les gouvernements se préparent à l’entrée en vigueur du Traité, les scientifiques soutiennent que des questions essentielles doivent être prises en compte quant à la meilleure façon de définir et mettre en œuvre les aires marines protégées (AMP) en haute mer, particulièrement pour les espèces migratrices dont les habitats et les schémas de migration se modifient en raison du réchauffement des eaux, de l’évolution des courants océaniques et de l’altération des réseaux alimentaires.
« La protection de la biodiversité en haute mer face au changement climatique est une partie d’échecs en cours », a déclaré le Dr Lee Hannah, scientifique principal en biologie du changement climatique au Moore Center for Science de Conservation International, et auteur principal de l’article. « Tout, des baleines aux poissons, se déplace pour suivre le réchauffement des eaux. Ce bouleversement des océans, largement dû au changement climatique, peut être abordé par le Traité de la haute mer, ce qui démontre combien sa ratification rapide est importante. »
L’article présente trois étapes cruciales que le Traité de la haute mer doit effectuer pour traiter efficacement les impacts du changement climatique sur les espèces :
- collaborer avec les directions de pêcheries et autres organisations axées sur la haute mer pour préserver les espèces en mouvement ;
- coordonner les plans stratégiques pour les réseaux de conservation en haute mer et au niveau des juridictions nationales ;
- partager et renforcer les capacités scientifiques parmi les juridictions en vue de modéliser la dynamique de l’écosystème océanique et les mouvements des espèces en réponse au changement climatique.
Selon les auteurs, chacune des trois étapes aidera à répondre aux questions essentielles sur la manière de délimiter les AMP pour les espèces qui pourraient bientôt se déplacer en dehors de leur aire de répartition actuelle, y compris les espèces migrant sur de longues distances à travers l’océan.
« Nous devons envisager deux calendriers à la fois, en s’interrogeant sur la manière dont les espèces en haute mer vivent maintenant et sur la manière dont elles pourraient vivre dans des décennies à mesure que le changement climatique s’aggrave. Et, naturellement, ce travail est d’autant plus compliqué qu’aucun pays n’est responsable de la haute mer, ce qui en fait donc un effort collectif mondial. Mais c’est la raison pour laquelle il est si important de commencer à planifier dès maintenant, afin de disposer d’une feuille de route robuste au moment où le Traité entrera en vigueur et sera prêt à être mis en œuvre », a fait savoir le Dr Hannah.
Actuellement, sept pays ont ratifié le Traité de la haute mer et 90 l’ont signé, indiquant ainsi leur intention de le ratifier. La High Seas Alliance fait campagne pour qu’au minimum 60 pays ratifient le Traité d’ici la tenue de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’océan en juin 2025.
« Notre réussite à répondre aux crises climatiques et en matière de biodiversité dépend également de la manière dont nous pouvons nous adapter à un environnement en constante évolution », a souligné Rebecca Hubbard, directrice de la High Seas Alliance. « Nous devons saisir la formidable opportunité que nous offre la réunion des gouvernements, ce mois-ci, visant à définir les processus de mise en œuvre du Traité en vue d’intégrer des mesures de protection marine efficaces et prendre une longueur d’avance sur les impacts du changement climatique dans plus des deux tiers de l’océan mondial. »
L’article a été co-écrit par des scientifiques de plusieurs organisations membres de la High Seas Alliance, notamment Conservation International, BirdLife International et Oceans North. D’autres auteurs représentant les organisations suivantes : Blue Nature Alliance, University of California Santa Barbara, Pêches et Océans Canada, Dalhousie University, Environnement et Changement climatique Canada, German Federal Agency for Nature Conservation et Swedish Agency for Marine and Water Management ont également contribué à l’article.
Au moment de la publication, le Traité de la haute mer a été ratifié par le Belize, le Chili, l’île Maurice, la Micronésie, Monaco, les Palaos et les Seychelles.
Photo d’en-tête : Biosphoto via AFP / Gabriel Barathieu
Pour aller plus loin :
- Livre « L’océan est-il le maire du climat ? de Paul Tréguer – Editions l’Apogée, 12 juin 2024