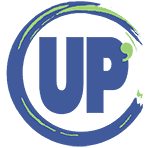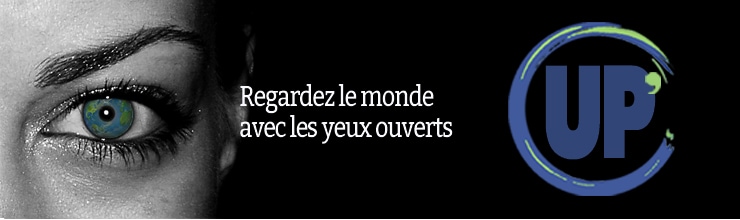Depuis un demi-siècle, les climatologues envisagent la possibilité d’injecter de petites particules dans la stratosphère pour contrer certains aspects du changement climatique. L’idée est qu’en réfléchissant une petite fraction de la lumière solaire vers l’espace, ces particules pourraient partiellement compenser le déséquilibre énergétique causé par l’accumulation de dioxyde de carbone, réduisant ainsi le réchauffement ainsi que les tempêtes extrêmes et de nombreux autres risques climatiques. Il pourrait être possible de commencer un déploiement de ces techniques à petite échelle. Les effets sur le climat seraient certes minimes, mais l’impact géopolitique pourrait être considérable.
Les débats sur cette idée, une forme de géoingénierie solaire appelée injection d’aérosols stratosphériques (IAS), se concentrent généralement soit sur la recherche à petite échelle qui cherche à comprendre les processus physiques impliqués, soit sur le déploiement à une échelle qui modifie perceptiblement le climat. L’écart entre les deux est gigantesque : une expérience peut utiliser de simples kilogrammes d’aérosols, alors qu’un déploiement susceptible de ralentir considérablement le réchauffement, voire de l’inverser, impliquerait des millions de tonnes par an, soit une différence d’échelle d’un milliard de fois. Pour refroidir sensiblement la planète grâce à cette technique, il faudrait également disposer d’une flotte d’avions de haute altitude spécialement conçue à cet effet, dont l’assemblage pourrait prendre une ou deux décennies. Ce long délai encourage les décideurs politiques à ignorer les décisions difficiles à prendre pour réglementer le déploiement de ce type de géoingénierie.
Une telle prudence n’est pas forcément judicieuse. La barrière entre la recherche et le déploiement peut être moins nette qu’on ne le pense souvent. David W. Keith, professeur de sciences géophysiques et directeur fondateur de l’initiative d’ingénierie des systèmes climatiques à l’université de Chicago et Wake Smith, maître de conférences à la Yale School of Environment et chercheur à la Harvard Kennedy School ont fait état de leurs travaux dans la revue du MIT. Ils suggèrent qu’un pays ou un groupe de pays pourrait vraisemblablement lancer un déploiement de géoingénierie solaire à petite échelle dans un délai de cinq ans seulement, qui produirait des changements indubitables dans la composition de la stratosphère.
Un déploiement à petite échelle bien géré profiterait à la recherche en réduisant les incertitudes importantes concernant le IAS, mais il ne pourrait pas être justifié en tant que recherche seule – des recherches similaires pourraient être menées avec une quantité beaucoup plus faible de particules d’aérosol. En outre, il aurait un impact non négligeable sur le climat, en apportant autant de refroidissement que la pollution au soufre provenant du transport maritime international avant la récente dépollution des carburants utilisés pour le transport maritime. En même temps, l’ampleur du refroidissement serait suffisamment faible pour que ses effets sur le climat, à l’échelle nationale ou régionale, soient très difficiles à détecter face à la variabilité normale.
Alors que l’impact sur le climat d’un tel déploiement à petite échelle serait faible (et très probablement bénéfique), l’impact politique pourrait être profond. Il pourrait déclencher une réaction brutale qui bouleverserait la géopolitique du climat et menacerait la stabilité internationale. Il pourrait constituer une rampe de lancement pour un déploiement à grande échelle. Et il pourrait être exploité par les intérêts des combustibles fossiles qui cherchent à ralentir la tâche essentielle de réduction des émissions.
Obstacles à un déploiement rapide
L’homme émet déjà une énorme quantité d’aérosols dans la troposphère (la couche inférieure turbulente de l’atmosphère) à partir de sources telles que le transport maritime et l’industrie lourde, mais ces aérosols retombent sur Terre ou sont éliminés par les précipitations et d’autres processus en l’espace d’une semaine environ. Les éruptions volcaniques peuvent avoir un effet plus durable. Lorsque les éruptions sont suffisamment puissantes pour traverser la troposphère et atteindre la stratosphère, les aérosols qui s’y déposent peuvent durer environ un an. À l’instar des plus grandes éruptions volcaniques, l’IAS injecterait des aérosols ou leurs précurseurs dans la stratosphère. Étant donné leur durée de vie beaucoup plus longue dans l’atmosphère, les aérosols qui y sont déposés peuvent avoir un effet de refroidissement 100 fois plus important que s’ils étaient émis à la surface.
L’acheminement des aérosols vers la stratosphère est une autre affaire. Les avions de ligne atteignent régulièrement la basse stratosphère lors de vols transpolaires. Mais pour obtenir une couverture mondiale efficace, il est préférable de déployer les aérosols aux basses latitudes, où la circulation naturelle de retournement de la stratosphère les transportera vers les pôles et les distribuera ainsi dans le monde entier. La hauteur moyenne du sommet de la troposphère est d’environ 17 kilomètres sous les tropiques, et les modèles suggèrent que l’injection doit se faire quelques kilomètres plus haut pour être capturée par la circulation stratosphérique ascendante. On considère généralement que l’altitude nécessaire à un déploiement efficace est d’au moins 20 kilomètres, soit près de deux fois l’altitude à laquelle les avions commerciaux ou les grands avions militaires effectuent leur croisière.
Bien que de petits avions espions puissent voler dans cet air très fin, ils ne peuvent transporter qu’une à deux tonnes de charge utile. Ce serait insuffisant, sauf pour des essais à petite échelle : pour compenser une fraction substantielle du réchauffement de la planète – par exemple, un refroidissement de 1 °C – il faudrait des plates-formes capables d’envoyer plusieurs millions de tonnes de matériaux par an dans la stratosphère. Ni les fusées ni les ballons ne sont adaptés au transport d’une masse aussi importante vers cette altitude. Par conséquent, un déploiement à grande échelle nécessiterait une flotte de nouveaux avions – quelques centaines pour atteindre l’objectif d’un refroidissement de 1 °C. L’acquisition du premier avion, à l’instar des grands programmes de développement d’avions commerciaux ou militaires, pourrait prendre une dizaine d’années, et la fabrication de la flotte nécessaire plusieurs années supplémentaires.
Mais commencer par un déploiement à grande échelle est à la fois imprudent et improbable. Même si nous baissons le thermostat mondial, plus nous modifions rapidement le climat, plus le risque d’impacts imprévus est élevé. Un pays ou un groupe de pays qui souhaite déployer l’ingénierie solaire est susceptible d’apprécier les avantages politiques et techniques d’un démarrage plus lent, avec une inversion progressive du réchauffement qui facilite l’optimisation et « l’apprentissage par la pratique », tout en minimisant la probabilité et l’impact des conséquences imprévues.
Les auteurs de l’article publié dans la revue du MIT envisagent des scénarios dans lesquels, au lieu d’essayer d’injecter des aérosols de la manière la plus efficace près de l’équateur, un pays ou un groupe de pays essaierait de placer une plus petite quantité de matériaux dans la basse stratosphère à des latitudes plus élevées. Ils pourraient le faire avec les avions existants, car la partie supérieure de la troposphère descend brusquement à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur. À 35° nord et sud, elle se trouve à environ 12 kilomètres. En ajoutant une marge de 3 kilomètres, l’altitude de déploiement effective à 35° nord et sud serait de 15 kilomètres. Cette altitude reste trop élevée pour les avions de ligne, mais se situe juste en dessous du plafond de service de 15,5 kilomètres des avions d’affaires haut de gamme, fabriqués par Gulfstream, Bombardier ou Dassault. La liste des pays dont le territoire est situé à 35° nord ou sud ou à proximité comprend non seulement des pays riches comme les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, l’Espagne et la Chine, mais aussi des pays plus pauvres comme le Maroc, l’Algérie, l’Irak, l’Iran, le Pakistan, l’Inde, le Chili et l’Argentine.
Déploiement à petite échelle
Comment le déploiement à petite échelle pourrait-il être réalisé ? La plupart des études scientifiques sur l’injection d’aérosols dans la stratosphère partent du principe que le matériau utilisé est le dioxyde de soufre (SO2), qui contient 50 % de soufre en masse. Une autre option plausible est le sulfure d’hydrogène (H2S), qui réduit presque de moitié la masse requise, bien qu’il soit plus dangereux pour les équipes au sol et en vol que le SO2 et qu’il puisse donc être éliminé de la réflexion. Le disulfure de carbone (CS2) réduit la masse requise de 40 % et est généralement moins dangereux que le SO2. Il est également possible d’utiliser du soufre élémentaire, qui est le plus sûr et le plus facile à manipuler, mais cela nécessiterait une méthode de combustion à bord avant la mise à l’air libre ou l’utilisation de brûleurs de postcombustion. Personne n’a encore réalisé les études techniques nécessaires pour déterminer lequel de ces composés sulfurés serait le meilleur choix.
Sur la base d’hypothèses confirmées par Gulfstream, les recherches estiment que n’importe lequel de ses avions G500/600 pourrait transporter environ 10 kilotonnes de matériaux par an à une distance de 15,5 kilomètres. En cas d’utilisation de CS2 à haute efficacité massique, une flotte de 15 avions au maximum pourrait transporter jusqu’à 100 kilotonnes de soufre par an. Les G650 usagés mais opérationnels coûtent environ 25 millions de dollars. Si l’on ajoute le coût des modifications, de la maintenance, des pièces de rechange, des salaires, du carburant, des matériaux et de l’assurance, le coût total moyen d’un déploiement à petite échelle sur une décennie devrait s’élever à environ 500 millions de dollars par an. Un déploiement à grande échelle coûterait au moins dix fois plus.
Que représentent 100 kilotonnes de soufre par an ? Cela représente à peine 0,3 % des émissions annuelles mondiales actuelles de pollution par le soufre dans l’atmosphère. Sa contribution à l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique particulaire serait nettement inférieure à un dixième de ce qu’elle serait si la même quantité était émise à la surface. Quant à son impact sur le climat, il représenterait environ 1 % du soufre injecté dans la stratosphère par l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1992. Cet événement bien étudié confirme l’affirmation selon laquelle il n’y aurait pas d’effets inconnus à haute conséquence.
En même temps, 100 kilotonnes de soufre par an ne sont pas négligeables : cela représenterait plus du double du flux naturel de soufre de la troposphère vers la stratosphère, en l’absence d’activité volcanique inhabituelle. L’effet de refroidissement serait suffisant pour retarder l’augmentation de la température mondiale d’environ un tiers d’année, un décalage qui durerait aussi longtemps que le déploiement à petite échelle serait maintenu. Et comme la géoingénierie solaire est plus efficace pour contrer l’augmentation des précipitations extrêmes que l’augmentation de la température, le déploiement retarderait l’augmentation de l’intensité des cyclones tropicaux de plus de la moitié d’une année. Ces avantages ne sont pas négligeables pour les personnes les plus exposées aux effets du climat (bien qu’aucun de ces avantages ne soit nécessairement visible en raison de la variabilité naturelle du système climatique).
Bien entendu, aucune géoingénierie solaire ne peut éliminer la nécessité de réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Au mieux, la géoingénierie solaire est un complément aux réductions d’émissions. Mais même le scénario de déploiement à petite échelle serait, pour les auteurs du rapport, un complément significatif : sur une décennie, il aurait environ la moitié de l’effet de refroidissement que produirait l’élimination de toutes les émissions de l’Union européenne.
Impact politique
Un tel déploiement à petite échelle pourrait servir plusieurs objectifs scientifiques et technologiques plausibles. Il permettrait de démontrer les technologies de stockage, d’envol et de dispersion en vue d’un déploiement à plus grande échelle. S’il est associé à un programme d’observation, il permettrait également d’évaluer les capacités de surveillance. Il clarifierait directement la façon dont les sulfates sont transportés dans la stratosphère et comment les aérosols de sulfate interagissent avec la couche d’ozone. Après quelques années d’un tel déploiement à petite échelle, les scientifiques auraient une bien meilleure compréhension des obstacles scientifiques et technologiques à un déploiement à grande échelle.
Dans le même temps, le déploiement à petite échelle présenterait des risques pour celui qui le mettrait en œuvre. Il pourrait déclencher une instabilité politique et susciter des représailles de la part d’autres pays et d’organismes internationaux qui ne verraient pas d’un bon œil que des entités manipulent le thermostat de la planète sans coordination ni contrôle à l’échelle mondiale. L’opposition peut provenir d’une aversion profondément enracinée pour la modification de l’environnement ou de préoccupations plus pragmatiques selon lesquelles un déploiement à grande échelle serait préjudiciable à certaines régions.
Les déploiements peuvent être motivés par un large éventail de considérations. De toute évidence, un État ou une coalition d’États pourrait conclure que la géoingénierie solaire pourrait réduire de manière significative son risque climatique et qu’un déploiement à petite échelle permettrait de trouver un équilibre efficace entre les objectifs de pousser le monde vers un déploiement à grande échelle et de minimiser le risque de réactions politiques négatives.
Les responsables du déploiement pourraient décider qu’un projet à petite échelle pourrait permettre des interventions plus importantes. Alors que les scientifiques peuvent être à l’aise pour tirer des conclusions sur la géoingénierie solaire à partir d’expériences et de modèles minuscules, les politiciens et le public peuvent être très prudents quant aux interventions atmosphériques susceptibles de modifier le système climatique et d’affecter toutes les créatures qui y vivent. Un déploiement à petite échelle sans surprise majeure pourrait grandement contribuer à réduire les inquiétudes extrêmes suscitées par un déploiement à grande échelle.
Les responsables du déploiement pourraient également revendiquer certains avantages limités du déploiement à petite échelle lui-même. Bien que les effets soient trop faibles pour être facilement perceptibles sur le terrain, les méthodes utilisées pour attribuer les phénomènes météorologiques extrêmes au changement climatique pourraient étayer les affirmations relatives à une légère réduction de la gravité de ces phénomènes.
Ils pourraient également faire valoir que le déploiement ne fait que rétablir une protection atmosphérique récemment perdue. La réduction des émissions de soufre des navires sauve aujourd’hui des vies en assainissant l’air, mais elle accélère également le réchauffement en amincissant le voile réfléchissant créé par cette pollution. Le scénario à petite échelle esquissé par les chercheurs rétablirait près de la moitié de cette protection solaire, sans la contrepartie de la pollution atmosphérique.
Les responsables du déploiement pourraient également se convaincre que leur action est conforme au droit international parce qu’ils peuvent effectuer le déploiement entièrement dans leur espace aérien national et parce que les effets, bien que globaux, ne produiraient pas de « dommage transfrontalier significatif », le seuil pertinent en vertu du droit international coutumier.
Les implications d’un tel déploiement à petite échelle en termes de gouvernance dépendraient des circonstances politiques. S’il était réalisé par une grande puissance sans tentative significative d’engagement multilatéral, on pourrait s’attendre à une réaction brutale. En revanche, si le déploiement était entrepris par une coalition comprenant des États très vulnérables sur le plan climatique et invitant d’autres États à rejoindre la coalition et à développer une architecture de gouvernance partagée, de nombreux États pourraient se montrer publiquement critiques mais, en privé, satisfaits que la géoingénierie réduise les risques climatiques.
L’injection d’aérosols stratosphériques est parfois décrite comme un scénario sociotechnique imaginaire qui se situe dans un futur lointain de science-fiction. Mais il est techniquement possible de commencer des déploiements à petite échelle dans les cinq ans qui viennent. Un État ou une coalition d’États souhaitant tester de manière significative les aspects scientifiques et politiques du déploiement pourrait envisager de tels déploiements à petite échelle ou de démonstration au fur et à mesure que les risques climatiques deviennent plus importants.