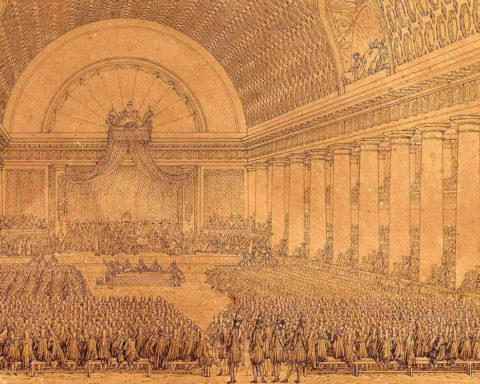La France de 2021 compte dix millions de pauvres, une autre épidémie dans celle du coronavirus. Des gens souffrent d’une précarité, aggravée par les mesures sanitaires, dans tous les domaines —économique, immobilier, énergétique, mais aussi alimentaire. Des organisations caritatives veillent, distribuent des colis issus des banques alimentaires, mais que contiennent-ils ? Les invendus des supermarchés, ce que l’agro-industrie produit de pire. En France on ne meurt pas de faim, on souffre de malnutrition. Frédéric Denez, ingénieur écologue et Alexis Jenni, écrivain (prix Goncourt 2011) sont partis enquêter dans toute la France pour voir comment des gens s’organisent pour manger correctement. En pleine crise sanitaire, ces « pauvres » inventent de nouveaux modèles de production et de consommation qui pourraient s’étendre à toute la société. Un livre de questions, mais aussi de solutions dont UP’ a choisi, grâce à la courtoisie des Editions Actes Sud, de vous en présenter sa très belle introduction.
Le hasard des choses a fait que durant tout le second trimestre de l’année 2020, un virus étrange a figé le monde. Un des symptômes de l’infection a été l’extrême lucidité dont elle a doté chacun d’entre nous. C’était à se demander si elle n’allait pas rendre la vue aux aveugles ! Car avec le sang tout imprégné par le port couronné de Sars-CoV-2, notre cerveau s’est mis à enregistrer ce qu’auparavant il avait du mal à concevoir : en France, il y a des gens qui ont du mal à se payer de quoi manger. Des pauvres, osons le mot. Des gens qui allaient, nous disait-on, se trouver encore plus incapables de subvenir à leurs besoins essentiels, et seraient bientôt rejoints par la cohorte des effondrés de la crise économique provoquée par le confinement. C’est-à-dire nous tous, hormis les fonctionnaires et les CDI de grosses entreprises, tirés au hasard de la grande loterie des faillites. Dès mars 2020, la France a eu peur de connaître à nouveau le sort commun imposé par la défaite de 1940. Recluse volontairement chez elle, elle s’est vue devoir faire des queues de documentaire en noir et blanc pour faire ses courses dans des magasins vides, et réclamer d’inhabituelles aides financières au gouvernement.
La plupart d’entre nous ont pris en pleine figure leur image déformée par l’angoisse de la paupérisation. Et si c’était moi, demain, celui-là que je vois à la télé dans les files d’attente des Restos du cœur ? Et si c’était bientôt mon cas d’aller faire le marché à sa fermeture, pour glaner quelques invendus… Notre quotidien si facile, dans un pays aussi riche, pouvait être brisé en quelques semaines.
Nos libertés avaient déjà été mises en quelques jours devant le fait accompli des nécessités sanitaires ; en dépit des aides de l’État, rien n’empêchait de penser que notre vie pouvait basculer vers un monde que l’on ne connaissait pas, et que l’on fuyait en l’enfermant dans des représentations rassurantes.
La révélation en a frappé certains jusqu’à prendre possession de leurs corps, qui se retrouvèrent poussés, tels des gueux du Moyen Âge tordus par la faim, à presque piller les magasins aux premières heures du confinement. Une forme d’expérimentation, un jeu de rôle spontané. Durant les quinze premiers jours de notre servitude sanitaire, nous n’avons pu trouver de farine, de riz, de pâtes, d’œufs, mais non plus, c’est curieux, de papier-toilette et de litière pour chat. Des gens apeurés, jusque-là bien élevés, vivant dans un pays aux mœurs civilisées, où règne l’abondance au regard des trois quarts de l’humanité condamnés au fatalisme de la survie, ont empli leurs caddies de kilos de produits de base, allant jusqu’à insulter, pousser, frapper quiconque s’autorisait une remarque.
En mars 2020, la France s’est fait un film.Elle adore se penser au passé, se rejouer la guerre. Elle était un peu redevenue celle de 1990, aussi, quand le déclenchement de la première guerre en Irak avait conduit des millions d’entre nous à faire des réserves, car on ne sait jamais. Le syndrome du panzer. La prophétie autoréalisatrice : si je n’accumule pas de farine, l’autre va le faire, et je ne pourrai plus en acheter, alors je rafle tout ce que je trouve, mais puisque l’autre pense pareil, il fait pareil, et effectivement, la farine vient à disparaître du rayon. J’avais donc raison ! La peur de manquer, de ne pas manger suffisamment, rend bête, et se nourrit d’elle-même. Le virus de la Covid-19 nous a rappelé cela. Il est un pédagogue malicieux. Car bien planté dans nos neurones, il nous a obligés à jouer le rôle qu’on s’imaginait être celui du pauvre qui ne sait pas de quoi demain sera remplie son assiette et se retrouve, fébrile, incapable devant un étalage. Plutôt piller qu’être affamé ! Comme un produit illicite aspiré par les narines, la Covid nous a soulevés dans les airs pour nous promener au-dessus des tristes plaines du misérabilisme. En réalité, pas du tout. Car la compulsion du remplissage était juste la manifestation de l’égoïsme viscéral, première étape de la confrontation à l’angoisse étouffante. Nous avons trop acheté pour nous rassurer. Ensuite, nous sommes redevenus un peu moins stupides.C’est alors que nous avons rouvert les yeux, comme après une transe, que nous avons deviné ce que pouvait être la vie des gens qui, eux, devaient connaître vraiment le manque avant la fin du mois, sans avoir toutefois les moyens d’accumuler des réserves au début. Dans notre société individualiste, il n’y a que lorsque nous sommes nous-mêmes concernés que nous prenons conscience des choses affreuses. C’est toujours après que l’eau a envahi le salon que l’on comprend, un peu tard, les alertes des petits vieux qui disaient de ne pourtant pas construire là, en zone inondable. Alors oui, la France a fait semblant de découvrir qu’elle avait des pauvres.
La France a fait semblant de découvrir qu’elle avait des pauvres.Beaucoup de pauvres. Entre 5 et 8 millions. Et elle a eu réellement peur qu’ils ne souffrent de la faim alors que l’aide alimentaire, les cantines et les marchés étaient empêchés par les interdits. Comment allait-on faire ? Les collapsologues et autres catastrophistes jubilaient d’avance : enfin allait-on voir la démonstration de notre théorie, le pays allait s’effondrer par sa base, son peuple qui a faim, il allait y avoir des émeutes de gens amaigris. En définitive, il ne s’est rien passé de tout cela, car nous nous sommes organisés spontanément, entre associations, citoyens, magasins, agriculteurs, industriels et services publics, et nous avons pu faire face au million de pauvres supplémentaires, à l’augmentation de 10 % du nombre des demandeurs de RSA, à celle d’un bon quart des distributions alimentaires.L’État a été là pour empêcher l’effondrement, on ne s’en rend pas bien compte mais c’est une réalité tangible, il est redevenu providence, certes au prix d’un endettement que tout le monde paiera à un moment ou un autre. Mais en ce qui concerne l’alimentation, la France n’a pas eu besoin de lui pour s’occuper d’elle-même, les énergies locales ont pourvu sans le génie habituellement inefficace de la haute administration. Nous sommes restés des gens de bien.
Nous avons quand même senti le vent du boulet. Nous avons pris en pleine figure une piètre image de nous-mêmes, celle d’un pays, l’un des plus riches du monde, où des millions vivent en comptant chaque sou, chaque jour, chaque année. Des citoyens que la moindre anicroche peut faire basculer dans la grande précarité, en compagnie des nouveaux pauvres précipités par cette crise imprévue. Ces derniers ne seraient pas loin d’un million, cent fois plus dans le monde, depuis le début de la crise virale.
La peur de basculer a fait qu’aussitôt oublié le confinement, la France a accéléré sa réflexion, entamée avant crise, sur la réfection de l’aide alimentaire. Car si celle-ci a su empêcher la catastrophe espérée par les jouisseurs de spectacles de fin du monde, ce fut après quelques semaines d’un statu quo particulièrement angoissant pour les bénéficiaires des aides ordinaires. Durant le confinement, des spécialistes de la question ont très vite alerté sur les manques et les défauts du caritatif à la française. Avant cela, fin 2019, un rapport de la très officielle Inspection générale des affaires sociales (Igas) nous avait déjà appris que l’aide était aussi complexe que de mauvaise qualité, et il avait proposé des idées pour la corriger, afin que les gens sans moyens eussent accès à une alimentation digne de leur nature d’être humain.
Être pauvre est toujours une indignité, car c’est une altération du regard que l’on porte sur soi.Car ce n’est pas le cas. Être pauvre est toujours une indignité, car c’est une altération du regard que l’on porte sur soi et, en France, c’est particulièrement une offense. Dans un pays catholique qui érige la pitié en vertu, alimenté par une économie fondée sur la responsabilité de l’individu, l’état de nécessité est un état de quémandeur. Il faut sans cesse oser réclamer, pour ne pas en définitive pouvoir choisir parmi la nourriture proposée que n’ont pas voulue les autres. Les autres qui ont, eux, du boulot, parce qu’ils ont eu le courage de traverser la rue. Les autres qui font du sport, des régimes, mangent frais et bio, font chaque jour des efforts pour conserver le ventre plat et une bonne tension. Et qui plaignent tant ces pauvres gens tout en leur faisant la morale : quand on est sans argent, en France, quand on mange mal, c’est qu’on l’a d’une façon ou d’une autre un peu cherché, ou bien, que voulez-vous, c’est l’hérédité, un déterminisme social auquel il faut bien s’habituer parce que c’est comme ça, on ne va pas changer le monde. L’obésité fille de la malbouffe ? Mais ils n’ont qu’à faire la cuisine ! Quel manque de courage, il faut faire des efforts dans la vie, etc.Pour compenser, pour vivre avec ce qui nous met quand même mal à l’aise, d’autant que le confinement a rendu plus tangible un appauvrissement jusque-là vécu comme théorique, nous considérons ces pauvres gens, en tout cas celles et ceux qui correspondent à l’idée que nous nous faisons de la pauvreté, forcément grasse, mal habillée et avec de mauvaises dents, le regard honteux et la parole difficile. Conforme à un cliché tiré de Zola et Dickens, l’image que nous avons de la pauvreté est commode, car elle maintient à distance : caricaturé de la sorte, le démuni ne pourra jamais être nous. Nous pouvons donc lui donner, en lui faisant la leçon. Mange ce qu’on te donne, et tais-toi. Pour vivre avec la peur, il faut l’affronter ou la chasser de notre vie en l’enfermant dans un monde inaccessible.
Collectivement, la société préfère la deuxième solution, qui a le mérite de ne nécessiter que peu d’efforts. Comme on va voir des animaux du patrimoine derrière une grille, on fait semblant de se mobiliser pour les bons pauvres, ceux de la Bible, le migrant échoué, le réfugié sous un pont, le rançonné des camps de toiles, ce qui flatte toujours un peu l’ego, autorise à pontifier, mais on a du mal à donner la pièce au clochard à l’haleine lourde et à acheter autre chose que des produits premiers prix lors des collectes en grands magasins, et on met des lunettes de soudeur dans la rue pour ne pas voir la réalité telle qu’elle est : même la France, avec son infrastructure sociale formidable, est un pays qui vacille.
On peut devenir pauvre parce qu’on en est à choisir entre l’essence pour aller travailler et le gaz pour chauffer la maison.En réalité, la pauvreté ordinaire est invisible, car elle est innombrable. Les gens qui manquent ne regardent pas forcément par terre, ils sont habillés comme tout le monde, se lèvent le matin, ont un smartphone et une carte bleue, lisent le journal, conversent et rient, ils conduisent leur voiture et ne tendent pas toujours la main. C’est le voisin, le collègue, le cousin, on le croise dans la rue, il a les chaussures cirées et ne s’habille pas pareil le dimanche. Leurs vêtements ne sont pas forcément usés, ils ont leur fierté, et quand ils en sont à réclamer de l’aide, ils ne le crient pas sur les toits.Du coup, on ne les entend pas toujours, ce qui nous arrange. Il n’y a guère que lorsqu’ils ont revêtu un gilet jaune et fait de la fumée sur les ronds-points qu’on a commencé à les voir et mesuré l’étendue du gouffre social qui sépare notre pays. Oui, on peut être pauvre sans être chômeur de père en fils, obèse ou immigré clandestin. On peut devenir pauvre parce qu’on en est à choisir entre l’essence pour aller travailler et le gaz pour chauffer la maison. On se retrouve pauvre lorsqu’on en est à ne plus pouvoir faire autrement, opprimé par les dépenses contraintes, que de considérer le budget alimentation comme seule variable d’ajustement des finances familiales.
Par la trouille qu’elle a plantée dans nos cœurs, la crise du coronavirus nous a fait voir la réalité sans artifices. Durant le confinement, chacun de nous a, à un moment ou un autre, expérimenté en pensée, interrogeant sa banque, ce qu’est la vie d’une personne dans la gêne : le décompte. Combien va-t-il rester ? Pourrai-je encore, demain ? Le regard a changé car la fragilisation financière installée pour beaucoup par la Covid-19 nous a projetés dans un avenir très incertain. Déjà, les dernières semaines du confinement ont conduit des milliers de gens qui se pensaient à l’abri, tout en se sachant pas si loin du précipice, à réduire leurs achats alimentaires qui avaient été considérablement augmentés par ces deux inédits repas par jour, chaque jour pour toute la famille. Ces milliers savaient que la pauvreté, c’est un autre de ses visages, est un piège qui a un fond, celui de l’aide sociale, auxquels conduisent des murs glissants. Les murs de nos représentations, qui sont des miroirs impudiques.
Comment se sent-on lorsqu’on commence par ne plus recevoir ses amis, ou ne plus honorer les invitations parce qu’on n’aurait autrement plus assez pour faire les courses ?Comment se sent-on lorsqu’on commence par ne plus recevoir ses amis, ou ne plus honorer les invitations parce qu’on n’aurait autrement plus assez pour faire les courses ? Comment se voit-on lorsque l’on commence à sauter un repas, pour que les enfants puissent manger en quantité ? Comment se considère-t-on quand on ne peut plus faire autrement que d’aller au bureau d’aide sociale de sa commune pour savoir de quelle manière on pourrait… avoir à manger ? Quelle image peut-on avoir de soi-même quand le colis qu’on nous donne est composé d’invendus et de presque périmés, de plats préparés basiques et de conserves sans rapport avec les besoins quotidiens ? Comment se sent-on quand, à force de mal manger, et on le sait qu’on mange mal, on se regarde dans la glace chaque jour grossir un peu plus ? La pauvreté est une prison dont les murs sont troués du regard des autres. On y mange mal, ce qui érode le moral : puisqu’on me nourrit avec des rebuts, c’est que je dois en être un aussi. Après tout, dans notre société latine, où la bouffe est avant tout un symbole, un langage, nous sommes ce que nous mangeons. Alors, si nous mangeons mal, c’est que nous sommes mauvais…Voilà encore un autre enseignement de la crise sanitaire. La pandémie de la Covid n’aurait jamais fait autant de morts si elle n’avait rencontré l’autre grande pandémie du monde, bien plus grave, celle de l’obésité. En France et ailleurs, sept malades atteints de Covid en réanimation sur dix étaient obèses, en surpoids, diabétiques, insuffisants cardiaques ou respiratoires, ou un peu tout cela. Or, l’obésité est en grande partie corrélée avec la pauvreté alimentaire, caractérisée par la misère en nutriments et la richesse en calories vides, les sucres rapides et les graisses hydrogénées.
Le virus nous a plongés en abîme : pour s’en protéger, nous avons cessé de travailler, ce qui nous a rendus plus susceptibles que jamais de devenir pauvres.Le virus nous a plongés en abîme : pour s’en protéger, nous avons cessé de travailler, ce qui nous a rendus plus susceptibles que jamais de devenir pauvres, glissant sur la pente de la mauvaise nutrition qui accroît les risques de développer une forme grave de la maladie. On l’a vu aux États-Unis, au Mexique, on l’a vu aussi en France, et même en Suisse. La pauvreté, c’est une peine qui se renouvelle sans cesse, c’est une cage dont les barreaux se multiplient à chaque regard qui confirme que l’on n’est plus tout à fait dans la société de consommation des bien portants. Avec ce paradoxe invivable qu’on y est quand même : la pauvreté est un marché comme un autre, qui génère de l’argent par la multiplication des crédits pour payer les crédits, et l’aide alimentaire qui valorise les invendus de la grande distribution. Dès lors, il semble impossible de s’en sortir.Nous avons voulu en avoir le cœur net. Alors nous sommes allés un peu partout en France à la rencontre des personnes qui ont du mal à manger, et de celles qui les aident. Nous avions fini ce tour des initiatives bien avant que le pangolin grillé n’empuantisse l’atmosphère. Alors, nous avons posé le crayon et observé. Le confinement a donné à voir en grand ce que nous avions observé. Il a remué tout le monde, obligeant chacun à penser au-delà de sa zone de confort, à se mettre à la place du pauvre, qui pourrait être la nôtre, bientôt. Il nous a tous ramenés à l’essentiel, c’est-à-dire à nos besoins fondamentaux. Entre quatre murs, sans pouvoir sortir autrement que par des dérogations aussi incompréhensibles qu’infantilisantes, nous avons eu le temps de réfléchir au sens des choses et au sel de la vie. À la valeur de la bouffe. En France, quand on est pauvre, on est condamné à mal manger en raison même de la structure de l’aide alimentaire. Le confinement aura permis d’en prendre conscience, et d’éclairer une nouvelle façon de voir les choses portées par des structures formidables qui ne considèrent pas les pauvres comme des personnes à plaindre mais comme des citoyens capables d’agir et d’exercer leur choix. C’est beau, l’humanité du quotidien.
Ensemble pour mieux se nourrir – Enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire, de Frédéric Denhez et Alexis Jenni – Préface de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, sous la direction de Boris Tavernier – Editions Actes Sud / Collection Domaine du possible, 2021 – 208 pages
Image d’en-tête : Illustration Anne Derenne ©Adene pour UP’ Magazine
Première publication dans UP’ Magazine : 8/4/21