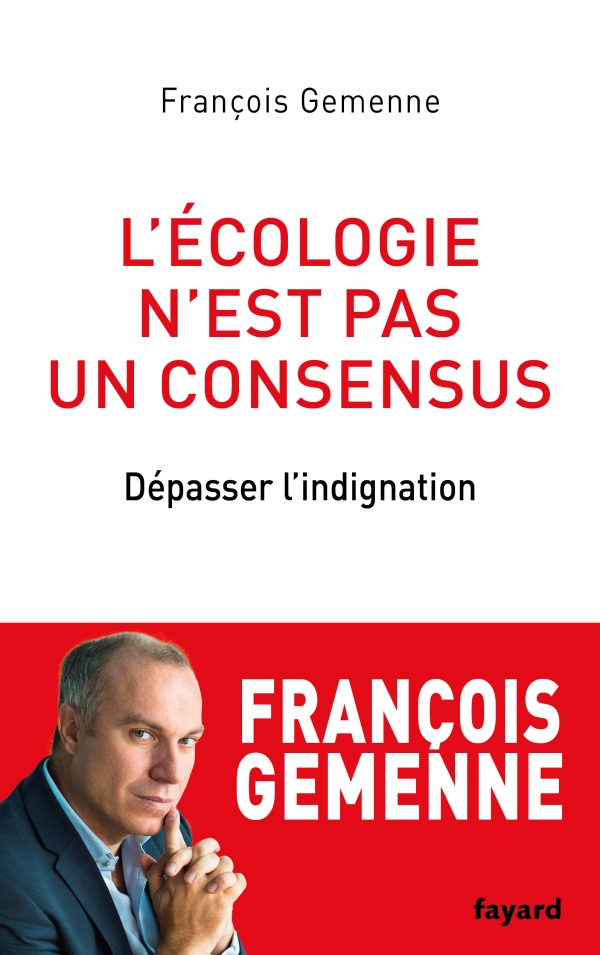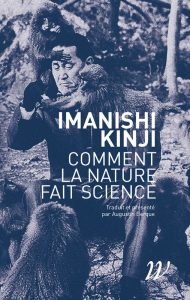 Comment la nature fait science – Entretiens, souvenirs et intuitions, de Kinji Imanishi – Introduction d’Augustin Berque « Science naturelle » et refondation mésologique du vivant – Editions Wildproject, 4 novembre 2022 – 280 pages
Comment la nature fait science – Entretiens, souvenirs et intuitions, de Kinji Imanishi – Introduction d’Augustin Berque « Science naturelle » et refondation mésologique du vivant – Editions Wildproject, 4 novembre 2022 – 280 pages
« Il faut dépasser le monde occidental de la conscience et cesser de soumettre la Terre. Il faut établir en nous-mêmes la manière de voir la nature dans son ensemble et dans son unité. À vous, les êtres vivants qui, pendant des centaines de millions d’années, avez traversé tant d’épreuves, merci, merci ! Et quant à moi, je quitte le monde. »
Kinji Imanishi, Comment la nature fait science, 1987
Contre les sciences à l’occidentale, Imanishi appelle à l’émergence d’une véritable science naturelle, qui rende justice à la vie concrète des êtres vivants et à leur créativité. « Écosystèmes », « populations », « communautés »… : les notions fondamentales de l’écologie décrivent mal, selon lui, la réalité de la vie sur Terre.
À la fin de sa vie, ce pionnier mondial rompt avec ce qu’est devenue l’écologie scientifique – et esquisse les principes d’une autre science, basée sur le terrain et l’intuition, qui appréhende la nature de l’intérieur. Par sa « sociologie du vivant », il a élevé le rang des animaux en montrant leur qualité de sujet et leur créativité.
Par-delà le morcellement croissant des sciences, il forge ici de nouvelles notions – dialoguant avec Charles Darwin, Arthur Tansley, Eugene Odum, Carl Gustav Jung, Lao Tseu et d’autres encore. Il avance notamment l’idée de la « proto-identité » : un sentiment de soi et de son lieu, un « je sens donc je suis » qui nous intègre à tous les vivants et qui n’est ni la conscience, ni l’instinct, mais un sentiment de soi et de son lieu, qui caractérisent les êtres vivants.
« Je dis ‘je sens, donc je suis’. Comme ça, on inclut les animaux. La personne qui dit ‘je pense, donc je suis’ est toute seule. Même si ce n’est pas de l’autisme, cette personne s’aliène de toute société. En revanche, dire ‘je sens, donc je suis’ ouvre un monde, et cela inclut toutes sortes de choses. »
Kinji IMANISHI (1902-1992), naturaliste, est un pionnier de l’écologie, et le fondateur de la primatologie empathique. Proche de l’École de Kyoto, il s’inscrit dans cette critique japonaise des savoirs occidentaux. Alpiniste chevronné, il est le plus célèbre naturaliste japonais du XXe siècle.
Augustin BERQUE, né en 1942 à Rabat, est un géographe, orientaliste et philosophe français. Spécialiste de la culture japonaise, il est l’auteur de plus d’une trentaine de livres et lauréat du prix Fukuoka (2009) et du prix Cosmos (2018).
Extrait de l’introduction par Augustin Berque
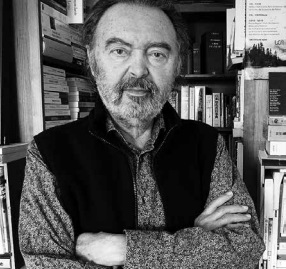
Imanishi Kinji (1902-1992) est sans conteste le plus célèbre des naturalistes japonais du XXe siècle, mais aussi le plus contesté dans le monde académique des sciences de la nature ; cela pour diverses raisons, dont la moindre n’est pas que, vers la fin de sa vie, il a rejeté les sciences de la nature (shizen kagaku) pour professer ce qu’il a nommé « science naturelle* » (shizengaku).
La différence entre les deux termes est que le premier fait de la nature un objet mécanique, dont l’observateur s’est abstrait, tandis que le second refuse cette scission. Autrement dit, la science naturelle refuse le dualisme moderne. Que met-elle à la place ? Telle est la question. La réponse que j’entends y apporter est qu’il ne s’agit pas là de dissoudre mystiquement le dualisme en monisme, mais d’envisager une relation plus complexe, relevant fondamentalement de la mésologie mise en avant au XXe siècle par le naturaliste balte germanophone Jakob von Uexküll (1864-1944) sous le nom d’Umweltlehre, ainsi que par le philosophe japonais Watsuji Tetsurô (1889-1960) sous le nom de fûdogaku – deux expressions qu’on peut traduire par « science du milieu ».
Hors du Japon, Imanishi est relativement peu connu, et s’il l’est, c’est comme primatologue plutôt que comme naturaliste, donc sans guère de rapport avec son idée générale de science naturelle. Comme primatologue, la cause est entendue depuis un livre paru en 2001, The Ape and the sushi master. Cultural reflections by a primatologist, où l’auteur, Frans de Waal – vedette, s’il en est, en la matière – parle des « enormous accomplishments of Imanishi’s approach to primate behavior, which amount to a paradigm shift adopted by all of primatology and beyond. The basic premises of his school, and the application of ethnography to the study of animal societies, are now all but taken for granted . »
De Waal parle aussi du préjugé culturel qui a fait que, pendant une bonne génération, les thèses de l’école imanishienne n’ont pas été acceptées en Occident, où elles furent taxées d’anthropomorphisme et considérées de ce fait comme non scientifiques. Du reste, même de nos jours, où, comme l’écrit de Waal, elles se sont imposées dans toute la discipline comme un changement de paradigme, bien des jeunes anthropologues occidentaux, pourtant élevés dans cette nouvelle optique, ignorent jusqu’au nom d’Imanishi.
C’est qu’il ne leur viendrait pas à l’idée qu’un cadre méthodologique, dans les sciences modernes de la nature, puisse venir d’Orient… La révolution accomplie après-guerre en primatologie par l’école imanishienne est d’avoir considéré les singes comme doués de subjectité (shutaisei), de culturalité et de socialité, qualités jusque-là considérées comme proprement humaines.
Appliquée ici aux singes, cette idée domine la conception qu’Imanishi s’est faite du vivant en général. Elle a guidé notamment sa théorie de l’évolution des espèces, ce qui l’a très tôt amené à une critique radicale du néodarwinisme, où le vivant relève plutôt de la mécanique. C’était là défier le courant dominant de la science moderne, en particulier le nominalisme régnant depuis Ockham dans le monde anglo-saxon. Sacrilège ! Au point qu’un géologue britannique, Beverly Halstead, certes affrété par des ennemis d’Imanishi au Japon même, vint spécialement à Kyôto pour le contredire et l’amener à résipiscence. Il y resta plusieurs semaines et, bien que ne lisant pas un mot de japonais, écrivit un livre dans lequel il démolissait la théorie imanishienne de l’évolution : Kinji Imanishi, the view from the mountain top (« mountain top » étant un jeu de mots combinant l’image de l’alpiniste qu’était Imanishi et l’idée de préjugé conservateur, Imanishi étant issu d’une famille riche).
Ce livre ne fut publié que dans sa traduction japonaise, mais l’auteur en ramassa les vues dans Nature (317, 17 oct. 1985, p. 587-589). La science évoluant néanmoins, Frans de Waal devait plus tard dénoncer l’impudence et la « colonial attitude » caractérisée de Halstead.
Extrait de la troisième partie « Je sens donc je suis »

Permettez-moi un détour. La thèse de Descartes, « je pense, donc je suis », donne une très grande importance à la conscience humaine. Il se trouve que cette façon de penser coïncide avec la société occidentale, où elle est fort répandue. Or il en résulte que les oiseaux ou les mammifères ne sont pas la même chose que les humains, qu’ils n’ont pas de sentiments, et que la place des animaux est très dépréciée. L’un de mes vœux, c’est de leur rendre justice.
En parodiant le mot de Descartes, je dis donc « je sens, donc je suis ». Comme ça, on inclut les animaux. Ce n’est qu’un début. Maintenant, pourquoi faire intervenir la question de l’identité ? C’est que la personne qui dit « je pense, donc je suis » est toute seule. Même si ce n’est pas de l’autisme, cette personne s’aliène de toute société. En revanche, dire « je sens, donc je suis » ouvre un monde, et cela inclut toutes sortes de choses. D’un point de vue sociologique, /187/ cela s’impose. À partir de là, il faut changer la façon occidentale de considérer les choses.
En pratique, il y a deux manières de considérer l’identité. Le « je pense, donc je suis » cartésien suppose un soi. C’est ce que j’appelle self consciousness : la conscience de soi (jiishiki). Tout le monde la possède, y compris les animaux, je pense ; mais c’est quelque chose d’assez mal défini.
L’autre manière, extrêmement importante mais dont on ne parle guère, c’est le là* (ba). Plus en détail, tout l’environnement en fait partie ; mais comme, d’habitude, on ne pense pas en termes si universels, le là, c’est en gros ce qui nous entoure. Quand le bébé prend conscience de la mère, c’est du là qu’il prend conscience ; et c’est en même temps, je pense, qu’il prend conscience de lui-même.
Cette y-conscience, conscience d’être là (baishiki), je l’appelle en anglais site consciousness. Conscience de soi et y-conscience vont de pair et se complètent. Dans l’exemple que je viens de prendre, c’est sur ce fond que le bébé, vers le même stade, prend conscience de lui-même en distinguant sa mère. Les êtres vivants lient ce qu’ils sont et là où ils sont. Je l’ai écrit dans Le monde des êtres vivants, /188/ mais la plupart des écologues séparent les deux. Ils pensent que l’environnement, c’est un autre monde que le soi, mais en fait, il faut comprendre que l’environnement, c’est soi-même. Dans ces conditions, le là n’est pas simplement le monde physique. Cela comprend le monde physique, mais ce sont plutôt les circonstances du monde environnant le soi. Ces conditions changent d’un moment à l’autre, c’est la situation.
Je posais plus haut la question de savoir comment on peut connaître les sentiments des animaux ; c’est que nous partageons avec eux un là. D’avoir ce là en commun va naître un sentiment commun (kyôkan). Ce « sentir » est important ; c’est celui du « je sens, donc je suis ». C’est là que s’établit le sentiment commun. Ainsi, bien que l’on ne comprenne pas le langage des oiseaux ou des mammifères, avoir un là commun permet de ressentir un sentiment commun. Par exemple, en montagne, après deux jours de pluie passés sous la tente, quand il fait enfin beau le troisième jour et qu’on se dit « allez, on y va ! », que tous les oiseaux qui se taisaient pendant la pluie se mettent à chanter, que tout est véritablement joyeux, là, est-ce qu’on n’a pas un sentiment commun ? Quand les oiseaux aussi gazouillent à pleine voix, je le prends comme un hymne à la liberté. Ce n’est pas du raisonnement, c’est du sentiment commun. /189/.