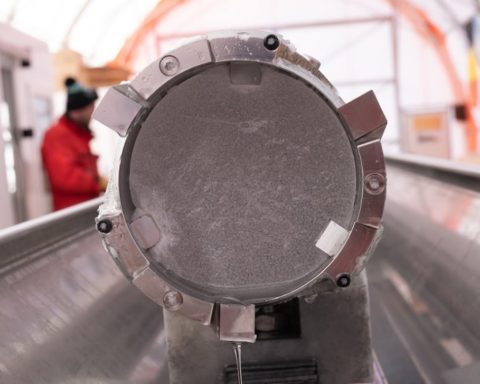Le climat fait des ravages sur l’ensemble de la planète et ce sont les peuples les plus faibles qui subissent les plus terribles conséquences. Les indigènes d’Amazonie voient leur forêt disparaître, les Bangladais coulent sous les eaux, les Pakistanais ont vu un tiers de leur pays noyé par des inondations féroces, les îles du Pacifique sont en train d’être rayées des cartes de géographie, rongées par l’océan. Tous appellent au secours et s’insurgent devant l’inaction des pays plus riches, premiers responsables de leur tragédie. En marge de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui s’est tenue à New-York la semaine dernière, des appels au secours venus des quatre coins du monde ont retenti et se sont multipliés. Écoutons-les.
« Nous avons le savoir pour sauver la planète »
Uyukar Domingo Peas, un indigène équatorien, regrette que malgré l’urgence de la crise climatique, des États et des entreprises continuent de détruire l’Amazonie et ne recourent pas aux savoirs ancestraux des peuples autochtones pour sauver la planète. « L’Amazonie doit rester intacte pour la jeunesse et le reste de l’humanité », déclare à l’AFP cet homme de 58 ans de la nation achuar, qui lutte depuis trois décennies contre la destruction des forêts. S’il existe encore des « réservoirs de ressources naturelles », c’est « parce que nous les avons protégés pendant des milliers d’années », ajoute-t-il, dans le cadre de la Semaine de l’environnement.
Il s’agit d’une série d’événements indépendants auxquels participent des peuples autochtones du monde entier, organisés à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, où des dirigeants de la planète ont plaidé en faveur de mesures pour arrêter le changement climatique. Quelque 80% des forêts tropicales de la planète — environ 800 millions d’hectares — se trouvent sur des territoires indigènes, selon les organisations qui les défendent.
Mais Uyukar Domingo Peas réclame des fonds pour mener à bien l’initiative dite du Bassin sacré territoires de vie, qui vise à protéger 35 millions d’hectares (la taille de l’Italie) dans la forêt amazonienne du Pérou et de l’Equateur, et abrite 30 peuples autochtones avec 600.000 habitants. Il espère que les neuf pays qui se partagent l’Amazonie — poumon de la planète avec près de 300 millions d’hectares, 3 millions d’habitants regroupés dans plus de 500 peuples et autant de langues —, rejoindront également cette initiative.
« Nous voulons que les entreprises et les banques arrêtent d’investir pour l’argent et investissent pour le bien commun » car « le changement climatique nuit à chaque être humain », dit-il. « L’économie doit être solidaire », souligne Uyukar Domingo Peas. Il prône une « nouvelle bioéconomie », avec de nouvelles sources d’énergie, des programmes touristiques, des produits à valeur ajoutée pour s’assurer que les jeunes autochtones n’émigrent pas vers les villes. « Nous voulons prendre soin de la jungle et vivre de la jungle », assure-t-il.
Par rapport aux sommes importantes nécessaires aux projets pétroliers et miniers qui polluent leurs terres et leurs rivières, son initiative nécessite seulement 19 millions de dollars sur 10 ans. « La Terre Mère ne s’attend pas à ce que nous la sauvions, elle attend de nous que nous la respections ! », clame pour sa part le chef équatorien de la nation waorani, Nemonte Nenquimo.
La pandémie de Covid et « l’hystérie collective des pays qui dépendent du pétrole » à la suite du conflit en Ukraine ont porté un coup sévère à la lutte indigène pour le climat, note Levi Sucre, de la communauté Bribri, un peuple indigène vivant entre le Costa Rica et le Panama. Avec les priorités fixées sur la relance économique, les droits des indigènes « ont régressé de manière alarmante ces deux, trois dernières années », explique-t-il à l’AFP. Il affirme que cas le plus alarmant est celui du Brésil, où le gouvernement « ignore délibérément les peuples indigènes ».
Les représentants des peuples autochtones se plaignent que les ressources convenues lors des réunions sur le climat leur parviennent à peine. Monica Kristiani Ndoen, une jeune leader indigène indonésienne, a rappelé cette semaine que « le défi est d’accéder directement aux fonds pour le climat ». « La question est de savoir où va l’argent », s’est-elle interrogée.
Pour le Vénézuélien Gregorio Díaz Mirabal, responsable d’une association regroupant des organisations indigènes du bassin amazonien (Coica), le problème est que « nous ne sommes pas présents dans les réunions où les décisions sont prises ». « Si vous voulez que nous continuions à fournir de l’oxygène, des rivières, des forêts, de l’eau potable, respectez notre maison », lance-t-il.
Le Bangladesh dénonce la « tragédie » de l’inaction des pays riches
« Ils n’agissent pas. Ils parlent mais ils n’agissent pas ». Face aux promesses climatiques non tenues des pays riches, la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina s’impatiente : Ils sont responsables des dégâts » mais ne font rien, « c’est une tragédie ». « Les pays riches veulent simplement devenir plus riches et encore plus riches, ils ne s’embêtent pas avec les autres », lance-t-elle lors d’un entretien avec l’AFP en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.
Pays de deltas, le Bangladesh fait partie des plus vulnérables aux impacts du changement climatique, en première ligne en particulier face à l’augmentation du niveau des océans et aux inondations qui se multiplient. Mais comme la plus grande partie du monde en développement, il n’est pas responsable du réchauffement de la planète qui a gagné près de 1,2°C en moyenne depuis l’ère pré-industrielle. « Nous ne sommes pas des émetteurs (de gaz à effet de serre) mais nous sommes victimes de ces émissions et du réchauffement », martèle la Première ministre. « C’est très fâcheux », poursuit-elle, mettant notamment en avant les « risques » et les « souffrances » des petits États insulaires qui « pourraient disparaître ».
Face aux menaces qui augmentent, les gouvernements du Sud dénoncent régulièrement les vaines promesses des pays développés, notamment l’engagement non tenu de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 leur aide pour que les pays les plus pauvres puissent réduire leurs émissions et se préparer aux impacts. Mais le sujet brûlant à deux mois de la conférence climat COP27 en Égypte concerne les « pertes et dommages » déjà subis, comme les dévastations provoquées par les inondations historiques au Pakistan, et la revendication d’un fonds pour les compenser. « Nous avons réclamé ce fonds. Nous voulons que cet argent soit levé, mais malheureusement nous n’avons pas de réponse positive des pays développés », regrette la Première ministre. Ils ont simplement obtenu un « dialogue » sur ce sujet jusqu’en 2024.
« Ils parlent mais ils n’agissent pas », dénonce-t-elle. « Ils parlent beaucoup, ils font des promesses, tout va bien, mais nous ne voyons aucune action, nous ne voyons pas d’argent ». Pourtant, « c’est la responsabilité des pays développés », « c’est leur devoir d’aider les victimes ». Malgré tout, elle assure qu’elle fera « de son mieux, toute seule », même sans l’aide internationale.
Le Pakistan, sous les eaux, lance à l’ONU un appel désespéré à sauver la planète
Le Pakistan, victime cet été d’inondations « dévastatrices », a lancé vendredi à l’ONU un appel désespéré à sauver la planète menacée par le dérèglement climatique provoqué par les pays riches et qui frappe injustement cette nation pauvre d’Asie du Sud, selon son Premier ministre. Lorsque le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s’était rendu le 10 septembre dans ce pays sous les eaux, il s’était écrié n’avoir « jamais vu un carnage climatique de cette ampleur ».
À la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU ce 23 septembre, le chef du gouvernement pakistanais Shehbaz Sharif a enfoncé le clou : « Le Pakistan n’a jamais vu une telle illustration absolue et dévastatrice de l’impact du réchauffement climatique ». Mais le Premier ministre, dans un discours vibrant, y a ajouté une sombre prédiction. Il a prévenu la communauté internationale que cette « calamité » climatique due à des pluies de « mousson monstrueuses » n’était qu’un prélude à ce qui attend le reste du monde. « Une chose est très claire : ce qu’il s’est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan », a lancé M. Sharif, la voix parfois prise par la colère et le visage fermé.
D’après le dirigeant « la définition même de la sécurité nationale a aujourd’hui changé et à moins que les dirigeants mondiaux ne s’unissent et n’agissent maintenant sur un programme minimal, il n’y aura plus de Terre pour y mener des guerres ». « La Nature va contre-attaquer et pour cela l’humanité n’est pas de taille », a prévenu le leader de 71 ans, au pouvoir à Islamabad depuis avril.
Causées par des pluies de mousson diluviennes, à la force accrue par le réchauffement climatique selon des experts, les inondations avaient recouvert un tiers du Pakistan — soit la superficie du Royaume-Uni — et provoqué la mort de près 1.600 personnes depuis juin, selon le dernier bilan. Habitations, commerces, routes, ponts et récoltes agricoles ont été détruits. Islamabad a évalué ses pertes financières à 30 milliards de dollars et son ministre des Finances Miftah Ismail a annoncé ce 23 septembre sur Twitter qu’il demanderait un allègement de sa dette auprès de créanciers bilatéraux.
Dans ce pays coincé entre l’Afghanistan, l’Iran, l’Inde et la Chine, plus de sept millions de personnes ont été déplacées, beaucoup vivant dans des camps de fortune sans protection contre les moustiques et où manquent l’eau potable et les sanitaires.
Sur place début septembre, M. Guterres avait exhorté les grands pollueurs de la planète à « arrêter cette folie » consistant à investir encore dans les énergies fossiles. La star hollywoodienne Angelina Jolie, qui s’est aussi rendue au Pakistan cette semaine en tant qu’émissaire du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), a déclaré n’avoir « jamais rien vu de tel » et que cela devait servir d’avertissement au reste du monde.
Mais pour Islamabad, les effets du climat sont particulièrement injustes pour un pays pauvre en développement de 220 millions d’habitants et d’à peine 350 milliards de PIB annuel (en 2021 selon la Banque mondiale). « Pourquoi mon peuple paie le prix d’un tel réchauffement climatique » alors que le Pakistan représente 0,8% des émissions mondiales de CO2, s’est interrogé le Premier ministre. Il s’est emporté contre une « Nature (qui) a déchaîné sa furie contre le Pakistan sans même regarder notre empreinte carbone ».
« Le Pakistan et les Pakistanais n’ont pas créé cette crise dont ils sont (maintenant) les victimes » en raison de « l’industrialisation de plus grands pays », a renchéri devant la presse à l’ONU le jeune ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari. « Nous ne faisons pas la charité, nous ne voulons ni armes, ni aide. Mais la justice pour notre peuple et pour les autres pays frappés par le (dérèglement du) climat », a lancé ce fils de l’ex-Première ministre Benazir Bhutto tuée en 2007 et de l’ancien président Asif Ali Zardari.
Dans le hall du palais des Nations unies à New York, des photos et des cartes du Pakistan sous les eaux sont exposées. L’une est frappée de cette mise en garde : « Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ça peut être n’importe quel autre pays !!!! ».
Le Vanuatu lance la bataille contre les énergies fossiles
Le petit Etat insulaire du Vanuatu menacé par la montée des océans a lancé à l’ONU la bataille pour la création d’un « traité de non-prolifération des énergies fossiles », visant à débarrasser à terme la planète des principaux responsables du réchauffement. « Nous appelons au développement d’un traité de non-prolifération des énergies fossiles pour sortir progressivement du charbon, du pétrole et du gaz en accord avec +1,5°C », objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris, a déclaré le président de l’île du Pacifique Nikenike Vurobaravu à l’Assemblée générale des Nations unies.
« Tous les jours, nous vivons les conséquences débilitantes de la crise climatique », a-t-il déclaré à la tribune, soulignant que « personne n’est immunisé contre les événements météo extrêmes qui ravagent nos îles, nos villes, nos États ». « Il ne reste plus de temps du tout, il faut agir maintenant ». « Notre jeunesse est terrifiée par l’avenir et le monde que nous allons leur laisser », a encore insisté le président, alors que des gouvernements ont relancé des centrales à charbon en réponse à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.
Le « traité de non-prolifération des énergies fossiles » est une initiative lancée par des défenseurs du climat inspirés par le texte du même nom sur les armes nucléaires, dans l’objectif de sortir des fossiles en les remplaçant par des énergies « propres et bas carbone ». « Le changement climatique, comme les armes nucléaires, est une menace majeure », soulignent ses promoteurs qui ont qualifié ce vendredi d' »historique » le soutien du Vanuatu, « premier Etat-Nation » à les rejoindre.
La campagne assure avoir déjà reçu le soutien de plus de 65 villes et régions dans le monde, ainsi que celui de la cité-Etat du Vatican. La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la Santé et quelque 200 autres organisations de santé avaient elles aussi appelé les gouvernements à mettre en place un tel traité, soulignant « la grave menace qui s’intensifie pour la santé humaine ».
Pour limiter le réchauffement à +1,5°C, sans capture de carbone (technologie non mature à grande échelle), l’usage du charbon devrait être totalement stoppé et ceux du pétrole et du gaz réduits de 60% et 70%, respectivement, d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2019, selon le dernier rapport de référence des experts climat de l’ONU (Giec) publié en avril. La planète a déjà gagné environ 1,2°C en moyenne et se dirige vers un réchauffement de +2,8°C d’ici 2100 même si les engagements individuels pris par les États dans le cadre de l’accord de Paris sont respectés. « Si nous continuons à brûler des énergies fossiles, nous allons voir des îles du Pacifique disparaître, des îles comme ma patrie, les Tonga », a commenté vendredi dans un communiqué Kalo Afeaki, militant pour le climat, soulignant sa « peur » de l’avenir.
« Une nouvelle fois le Vanuatu montre au monde le leadership climatique du Pacifique », s’est félicitée Mary Gafaomalietoa Sapati Moeono-Kolio, militante néo-zélandaise. Le Vanuatu fait en effet figure de pionnier dans les batailles juridiques contre le réchauffement et la destruction des ressources naturelles. Il mène ainsi une campagne pour modifier le statut de la Cour pénale internationale, souhaitant que le crime d’écocide — destruction à grande échelle des écosystèmes — vienne rejoindre génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre dans les actes que la juridiction peut poursuivre.
Avec d’autres États du Pacifique, le Vanuatu plaide également pour que la Cour internationale de justice (CIJ), qui règle les litiges entre États, se saisisse de la question climatique. « Dans cette Assemblée, avec le soutien des États membres de l’ONU, nous allons demander à la CIJ un avis consultatif sur ses obligations existantes, en vertu du droit international, pour protéger les droits des générations présentes et futures contre les effets néfastes du réchauffement », a précisé le président Nikenike Vurobaravu, alors qu’une résolution est en préparation.
« Apporter le climat à la CIJ par l’intermédiaire de l’Assemblée générale n’est pas un remède miracle pour accroître l’action climatique », a-t-il noté. « Mais le seul outil pour nous rapprocher de l’objectif d’une planète vivable pour l’humanité ».
Avec AFP