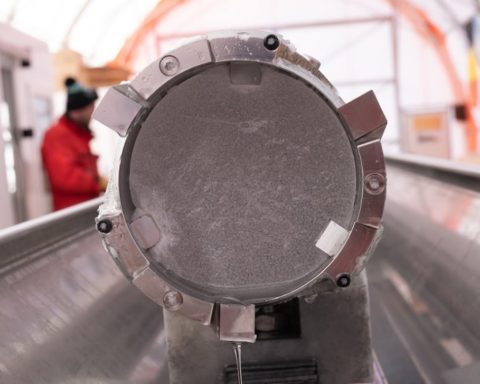Les satellites pilotes des cultures, les filets-capteurs d’eau comme l’organisation des tours d’eau dans les villages, garantissent encore l’accès à l’eau au Maroc. Jusqu’à quand ? Pour un pays pris entre augmentation de la productivité fruitière et céréalière et le changement climatique, l’optimisation des utilisations de l’eau est un défi vital.
 Au Maroc comme en Inde, les puits sont à sec. Ici comme presque partout dans le monde, on prend la mesure d’une rupture : l’eau qui courait dans les Khettaras (1), ces galeries drainantes souterraines, creusées dans les contreforts de l’Atlas au XIIe siècle, circule … à 20 voire 40 mètres plus bas !
Au Maroc comme en Inde, les puits sont à sec. Ici comme presque partout dans le monde, on prend la mesure d’une rupture : l’eau qui courait dans les Khettaras (1), ces galeries drainantes souterraines, creusées dans les contreforts de l’Atlas au XIIe siècle, circule … à 20 voire 40 mètres plus bas !

« Le bassin du Tensift (où se trouve Marrakech) avec ses 24 000 forages et puits, voient ses nappes baisser de 1 à 3 mètres par an », explique Lionel Jarlan, climatologue et Co-directeur du Laboratoire Mixte International TREMA (IRD-UCAM-DMN-CNESTEN) qui joue le rôle d’observatoire des réserves hydrologiques de la région. « Nous consommons notre patrimoine, c’est pourquoi l’avenir n’est pas souriant » lâche-t-il.
En clair, les quantités pompées essentiellement pour l’irrigation (pour les cultures de betteraves, blés, abricotiers, orangers…) dépassent le potentiel de renouvellement des nappes phréatiques.
 La première démarche pour inverser la tendance consiste à éviter le gâchis. Michel Lepage (informaticien à l’IRD) met au point des outils de modélisation éco-hydro-géologique et de télédétection spatiale pour un usage raisonné de l’eau. Il recourt à l’assistance d’un œil céleste, celui de Spot 4, qui fournit des images renseignant sur l’état hydrique des sols, l’évaporation, le flux de sève (transpiration), le stress des plantes quand elles manquent d’eau…
La première démarche pour inverser la tendance consiste à éviter le gâchis. Michel Lepage (informaticien à l’IRD) met au point des outils de modélisation éco-hydro-géologique et de télédétection spatiale pour un usage raisonné de l’eau. Il recourt à l’assistance d’un œil céleste, celui de Spot 4, qui fournit des images renseignant sur l’état hydrique des sols, l’évaporation, le flux de sève (transpiration), le stress des plantes quand elles manquent d’eau…
« L’ambition est de proposer un pilotage agricole à 65 000 agriculteurs qui sont obligés chaque année de déposer auprès de leur agence de bassin leur demandes en eau (assolement prévisionnel) ». La tradition de répartition des ressources en eau est ancienne et bien ancrée dans les villages, puisque les agriculteurs eux-mêmes nomment une personne de confiance pour surveiller les temps et volumes d’eau que chacun utilise.
 L’œil des satellites peut-il concurrencer l’art agronomique basé sur les pratiques ancestrales ?
L’œil des satellites peut-il concurrencer l’art agronomique basé sur les pratiques ancestrales ?
Le programme de monitoring par satellite SAMIR (Satellite Monitoring if Irrigation) doit encore faire la preuve de sa pertinence. « Sur des parcelles de blé, nous avons réalisé une comparaison entre un pilotage des cultures par satellite et un pilotage classique par l’agriculteur connaisseur de ses terres en l’occurrence Mr Tarbaoui, décrit Michel Lepage.
Trois types de données sont nécessaires pour savoir quand il faut irriguer : les conditions climatiques (obtenues avec les stations météorologiques au sol) ; l’évolution du développement des plantes (par les captures satellitaires infra-rouge et proche infra-rouge) ; l’évolution de la teneur en eau du sol variable selon la texture du sol (stress hydrique). Résultat des courses : l’agriculteur a obtenu 20% de croissance en plus mais le pilotage satellitaire a été probant sur le rendement final. Reste à savoir si l’accès aux images (issues de Spot 4 en fin de vie, avec une résolution de 10 mètres et envoyées tous les cinq jours) restera gratuit comme cela est le cas en phase d’expérimentation…
Un des financements de ce programme provient de l’action Amethyst (de l’agence française de la recherche) qui vise à repérer depuis l’espace, dans la plaine du Haouz, les signaux du changement climatique. Le laboratoire CESBIO (Centre d’études spatiales de la biosphère) est ainsi impliqué dans ce travail de sentinelle.
 Capter l’eau des brouillards
Capter l’eau des brouillards
Dans l’ouest du Maroc, au delà d’Agadir, d’autres expérimentations sont visibles sur les hauteurs de Guelmim (la porte du Sahara). Il s’agit de filets attrape-brouillard qui capturent les gouttelettes en suspension présentes en abondance dans les brumes et dont le flux est alimenté par le vent côtier. Ces derniers récoltent une eau qui s’écoule ensuite vers une citerne villageoise. C’est le scientifique Aïssa Derhem qui nous explique le projet. « Nous avons repéré que des pays comme le Chili, le Pérou ou les Canaries utilisaient des arbres comme le dragonnier ou le Garoé (arbre à fontaine) pour capter l’eau dans leurs feuilles et le restituer à travers un pavage souterrain, explique le chercheur marocain qui s’emploie à développer des solutions pratiques locales.
Depuis les années 2000, des associations ont mis en place des projets pour imiter ces arbres avec des filets. Ici, 600 m2 de filets en polypropylène sont installés. On estime que cette technique permet de récolter 30 litres d’eau par mètres carrés de filet. « Une ressource en eau qui permet d’installer quelques cultures dans cette région retirée où les ressources sont rares, souligne Aïssa Derhem, fondateur de l’association Dar Si Hmad qui fait tourner une arganerie où travaillent un douzaine de femmes pour produire de l’huile d’argan. Pour implanter les filets capteurs de brouillard son équipe s’est inspirée des installations faites en Afrique du Sud, Namibie, Yémen, Chili, Pérou, Mexique, Canaries et îles du Cap-Vert. Elle s’est appuyée sur l’expertise de l’ONG FogQuest, fondée en 2000 par Sherry Bennett et Bob Schemenauer, qui a développé des prototypes au Chili, dans le désert d’Atacama. La-bas, les « Fog Catchers », simples filets capables de récupérer l’eau condensée des brouillards permettent de collecter jusqu’à 1 000 litres d’eau par jour. «
« Le procédé présente néanmoins l’inconvénient d’être très dépendant du vent et ne peut donc pas être employé partout » précise Alain Gioda, historien du climat et spécialiste de cette démarche sur l’ile d’El Hierro (iles Canaries).
Ainsi des améliorations ont été recherchées du côté des matériaux des filets afin d’optimiser l’absorption de l’eau. Une équipe de chercheurs d’Eindhoven, associée à une équipe de Hong Kong, a ainsi mis au point un matériau (actuellement en cours d’expérimentation) alliant du coton et un polymère hydrophile (le poly-N-isopropylacrylamide appelé également PNIPAAm), visant à récupérer l’eau du brouillard.
 Les résultats, publiés dans la revue Advance Materials et repris dans Futura Sciences, montrent qu’en appliquant sur le tissu de coton un polymère, sa capacité d’absorption augmente considérablement. Alors qu’en temps normal il est capable d’absorber l’équivalent de 18% de son poids, ce pourcentage atteint les 340% grâce au polymère. Des propriétés jugées particulièrement prometteuses, d’autant que ce coton fonctionne indépendamment du vent.
Les résultats, publiés dans la revue Advance Materials et repris dans Futura Sciences, montrent qu’en appliquant sur le tissu de coton un polymère, sa capacité d’absorption augmente considérablement. Alors qu’en temps normal il est capable d’absorber l’équivalent de 18% de son poids, ce pourcentage atteint les 340% grâce au polymère. Des propriétés jugées particulièrement prometteuses, d’autant que ce coton fonctionne indépendamment du vent.
Il faut ajouter que ces démarches sont optimisées dès lors que les écosystèmes pour maintenir l’humidité sont cohérents. « L’arganier est un arbre qui vit en symbiose avec le brouillard et son développement est fort important ces dernières années à la suite du boom de la demande de son huile, explique Alain Gioda. C’est un arbre fontaine naturel et maintenant les villageois le plante en abondance et le protège des assauts des chèvres. Pour Alain Gioda, « Plus d’arbres veut dire plus d’eau car mécaniquement c’est un obstacle et le brouillard stagne ou plutôt tourbillonne autour de lui. C’est du gagnant-gagnant pour les communautés villageoises ».
(1) Les khettaras sont des galeries drainantes qui amènent l’eau de la nappe phréatique à la surface du sol, par gravité. La sortie de la Khettara se situe toujours au village (vu la maîtrise du nivellement). La conduite souterraine est accompagnée sur le sol par des puits d’aération qui servent aussi de points d’épuration.
![]()
– Article UP’ « Comment obtenir de l’eau douce à partir de rien »
– Lire « La gestion sociale de l’eau au Maroc, de Azerf à la Loi sur l’eau »