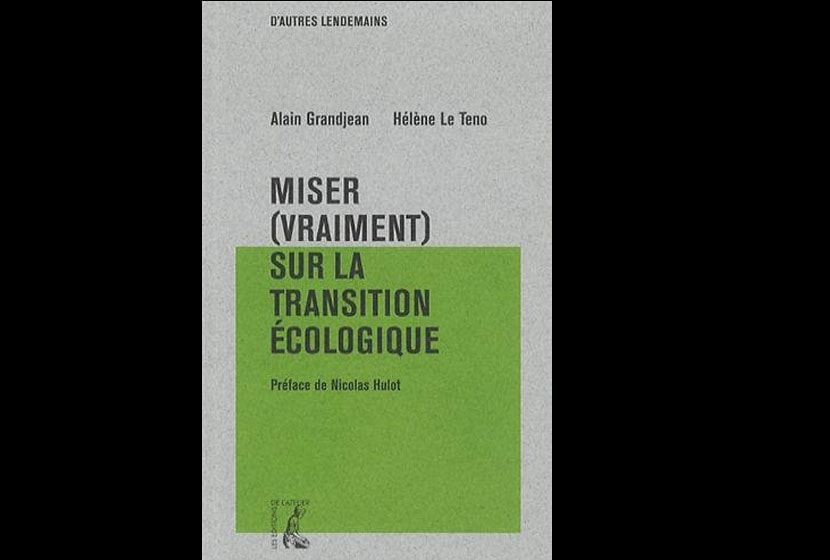Le Giec (1) a publié le mois dernier (13 avril 2014) le troisième volet de son rapport, consacré cette fois à l’atténuation du réchauffement climatique. Jean-Charles Hourcade, économiste au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement, fait le point sur la nécessaire transition économique à laquelle le monde doit désormais s’atteler.
Après la publication des rapports des groupes I et II, consacrés respectivement aux bases physiques de l’évolution du climat et à l’adaptation et la vulnérabilité face aux évolutions climatiques, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) vient de publier le rapport du groupe III. Quel est son rôle ?
Jean-Charles Hourcade : Ce groupe est centré sur les mesures dites d’atténuation, c’est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Son travail consiste en l’évaluation des enjeux économiques associés, essentiellement l’impact sur la croissance. Et ce, en tenant compte des marges de manœuvres technologiques et des aspects éthiques comme la solidarité ou l’équité entre les pays selon leur niveau de développement, mais aussi entre les générations. De fait, il est essentiel de mener une réflexion sur la ventilation du coût (processus qui consiste à répartir une somme entre différents postes, différents groupes ou individus) de la nécessaire transition énergétique. Par ailleurs, il est important de noter que l’objectif du groupe n’est ni de prédire ni de prescrire, mais de permettre une meilleure compréhension des mécanismes en jeu. Le futur énergétique dépend en effet des choix que font les sociétés : sortir ou pas du nucléaire, mettre en place ou pas une taxe carbone, lutter contre l’étalement urbain, etc. Notre mandat n’est ni de prévoir ce qu’elles feront ni de leur conseiller ce qu’elles doivent faire.
Ce nouveau rapport fait suite à trois autres, publiés en 1995, 2001 et 2007, qu’apporte-t-il de nouveau ?
J.-C. H. : En matière économique, on ne peut pas attendre de vraies découvertes, seulement une meilleure description et compréhension des mécanismes. Ainsi, les chapitres sectoriels qui traitent respectivement de l’énergie, des transports, du bâtiment, de l’industrie et de l’agriculture/forêt sont enrichis. Et nous avons inclus à nos analyses les dynamiques urbaines et spatiales, soulignant que des politiques climatiques ambitieuses ne peuvent se réduire à des politiques énergétiques.
Mais la vraie nouveauté a consisté à remettre au centre la question du lien entre climat et développement, avec en particulier deux chapitres dédiés. De plus, nous présentons une analyse des possibilités de stabilisation du réchauffement à différents niveaux de température, dont la cible de 2 °C. Par rapport au rapport de 2001, cette polarisation sur le long terme, qui correspond à une demande politique et médiatique forte, a fait que le rapport contient moins de données chiffrées sur l’amorçage de la transition, sur les impacts à court terme sur la croissance et l’emploi. Heureusement, cela est équilibré par l’apparition de chapitres sur le développement.

La ville de Curitiba au Brésil est connue comme ville-modèle en matière de transports et d’environnement. Mais ces dernières années, elle a été rattrapée par les problématiques qui touchent les autres métropoles brésiliennes. ©CNRS Photothèque / H. THERY
Alors, l’objectif de 2 °C est-il tenable ?
J.-C. H. : À partir d’une quinzaine de modèles mondiaux différents qui ont produit des centaines de scénarios sur la manière dont les différentes trajectoires économiques possibles affectent l’évolution du climat, le rapport montre que l’on parvient à une stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère en dessous de 450 ppm (seuil au-delà duquel le réchauffement dépassera 2 °C) dans 60 % des cas. Cela implique néanmoins une action forte et immédiate, dans la plupart des cas un dépassement temporaire des 2 °C et, à partir de 2070-2080, un piégeage du carbone permettant de faire plus que compenser les émissions, c’est-à-dire de faire baisser le taux de CO2 dans l’atmosphère.
C’est donc un objectif très difficile à atteindre ?
J.-C. H. : Je laisse juge le lecteur ! Plus sérieusement, ainsi formulée, la question réduit les politiques climatiques à la mise en place d’une contrainte sur l’économie. C’est pourquoi le nouveau rapport fait une place importante aux liens entre les objectifs climatiques et la problématique générale du développement.
Dans cette perspective, les politiques climatiques deviennent des opportunités impactant positivement le contenu et le caractère soutenable du développement. Autrement dit, si on fait du climat un défi qui questionne notre mode de développement, on s’aperçoit qu’il existe des marges de manœuvre qui permettent de protéger le climat tout en contribuant à renforcer nos économies et rendre possible un enclenchement rapide de la transition. Cela ne garantit pas de pouvoir atteindre l’objectif des 2 °C.
Pour autant, on constate qu’il est possible de se donner les moyens d’éviter des dérives vite irréversibles vu la rapidité avec laquelle les pays en développement bâtissent leurs infrastructures. Si on lance un cercle vertueux entre protection du climat et environnement, on libérera des potentiels d’innovation technique et institutionnelle tels qu’on pourra peut-être, in fine, respecter les 2 °C sans recourir à de très incertaines séquestrations de carbone à grande échelle.
Pouvez-vous donner des exemples concrets de la manière dont on peut articuler objectif climatique et développement ?
J.-C. H. : Prenez la pollution atmosphérique engendrée par la combustion de pétrole et de gaz. Le rapport du Giec montre clairement qu’elle est responsable de coûts importants pour la santé et la productivité agricole (en particulier en Chine et en Inde), et que la réduction des émissions de GES rapporterait un co-bénéfice de l’ordre de 0,6 % du PIB. Par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre serait à la fois bénéfique pour le climat, mais également pour l’économie de ce pays. De même, en réduisant notre dépendance au pétrole et au gaz au profit d’énergies moins carbonées, on réduirait les fluctuations de prix des énergies fossiles, instabilité dont l’impact économique est négatif et, surtout, les tensions géopolitiques qui ont marqué le dernier quart du XXe siècle. Il y a aussi la meilleure valorisation des ressources énergétiques locales ou l’accès à un habitat de meilleure qualité.
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre atténuerait aussi la pollution qui affecte de nombreuses villes (ici, Hong Kong) et régions du monde. Or celle-ci a un coût énorme, notamment en matière de santé publique. ©Stripped Pixel – Fotolia.com
La réduction des émissions de gaz à effet de serre atténuerait aussi la pollution qui affecte de nombreuses villes (ici, Hong Kong) et régions du monde. Or celle-ci a un coût énorme, notamment en matière de santé publique. ©Stripped Pixel – Fotolia.com
Existe-t-il un chiffrage global du coût de la transition à opérer pour atteindre l’objectif climatique ?
J.-C. H. : Il y a autant de coûts que d’hypothèses sur les technologies ou sur l’efficacité des politiques mises en place. Le point important est que les analyses montrent que, cumulé sur le siècle, le coût macroéconomique de la transition n’excède pas 4 % du PIB mondial soit, en gros un an de retard de croissance. Le message est le suivant : l’impératif climatique ne nous condamne nullement à la décroissance. En revanche, une grande attention doit être donnée à la distribution de ces pertes dans le temps. Il y a des cas où les pertes à court terme peuvent être importantes et interdire de fait la transition. On revient ici à la question liant climat et développement.
Pourquoi la transition « bas carbone » passe-t-elle par une meilleure prise en compte des dynamiques urbaines et d’aménagement du territoire ?
J.-C. H. : On doit bien sûr s’appuyer sur les progrès techniques dans tous les domaines : énergie, transports, bâtiments, industrie, agriculture, foresterie. Mais la technologie ne suffit pas, car bien souvent les gains énergétiques que l’on en tire ne suffisent pas à compenser la croissance de la consommation. Le secteur des transports est typique : les moteurs consomment de moins en moins, mais la demande de mobilité ne fait que croître ; de même, le just-in-time dans la production industrielle et les grands réseaux de commercialisation de produits agricoles fait que la croissance des transports de marchandises est supérieure à celle du produit total. Concrètement, la transition à opérer ne peut se passer d’une réflexion qui dépasse le seul prix du carbone. Bien qu’important, celui-ci sera impuissant à contrôler des dynamiques nourries par les prix de l’immobilier, les prix de la terre et les divers dispositifs de planification urbaine.
Les outils économiques et financiers sont néanmoins très importants pour accompagner le changement ?
J.-C. H. : Bien entendu. Et sur ce point, il est désormais clair que l’existant ne suffit pas, et la compréhension de l’échec dans divers pays, dont le nôtre, à expliquer ce que pourrait être une taxe carbone mérite de mobiliser les sciences sociales. De même, les aspects financiers du climat ne peuvent se réduire aux marchés de permis d’émissions négociables. Il y a un point nouveau, souligné par le résumé pour décideur du Giec qui est la différence entre la comptabilité des émissions carbonées par localisations géographiques et par lieu de consommation. Dans ce dernier cas, on incorpore les émissions des produits que vous importez (et on déduit celles des produits que vous exportez). Pour le dire vite, si vous consommez en France du poulet brésilien, vous êtes coresponsable des émissions associées à l’élevage de cette volaille. Or on constate que, si les émissions des pays en développement ont considérablement crû ces dernières années, le résultat est notablement différent si on prend les émissions incorporées dans la consommation. Cela renvoie à tout une réflexion sur l’usage des instruments économiques, sur le dessin des taxes par exemple ou sur le rôle d’accords sectoriels de coopération industrielle.
Pour autant, en particulier depuis la crise financière et économique de 2008, la question climatique semble un peu avoir été reléguée au second plan ?
J.-C. H. : Nous vivons un moment paradoxal. D’un côté, nous sommes totalement sortis de l’innocence quant à la nécessité d’une transition économique pour faire face au défi climatique et la compréhension des mécanismes en jeu est aujourd’hui arrivée à maturité. De l’autre, comme le montre la multiplication des tensions et conflits, la gouvernance mondiale est de plus en plus chaotique, ce qui rend plus difficile le démarrage de la transition. Ainsi, nous n’avons pas d’autre choix que de rendre attractive cette nécessaire transformation de notre économie afin d’amorcer un nouveau cercle vertueux assez fort pour paraître crédible. La lutte contre le changement climatique n’est pas une punition, mais un levier pour repenser notre monde et, par exemple, inventer une finance climat qui détourne l’épargne mondiale, surabondante, des investissements spéculatifs pour l’orienter vers des infrastructures « bas carbone » et sortir l’économie mondiale de sa langueur. Nous avons entre dix et vingt ans devant nous pour prendre le problème à bras-le-corps. Au-delà, trop d’investissements dans les infrastructures, en particulier dans les pays en développement, nous aurons éloignés d’une trajectoire qui tienne compte des enjeux climatiques. Il sera alors trop tard.
Mathieu Grousson – Le Journal CNRS – Avril 2014
(1) Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est un organe international chargé d’évaluer les activités scientifiques consacrées aux changements climatiques. Il a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement afin d’offrir aux décideurs des évaluations régulières du fondement scientifique de l’évolution du climat, des incidences et des risques associés et des possibilités d’adaptation et d’atténuation.