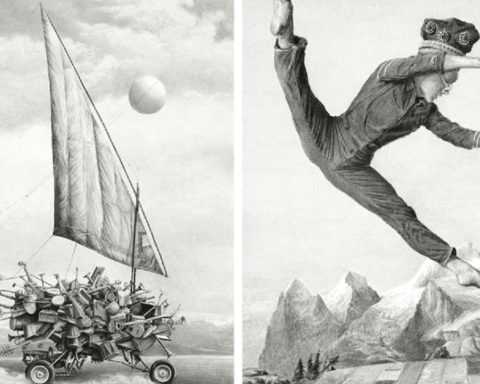Du 17 mars au 19 juillet la Fondation groupe EDF présente Courants verts, Créer pour l’environnement. Pour la première fois en France, une exposition d’envergure qui réunit des artistes internationaux engagés dans le combat écologique.
Joseph Beuys, Barbara et Michael Leisgen, Lucy et Jorge Orta, Sarah Trouche, Nicole Dextras, Jéremy Gobé, Nathan Grimes… tous sont résolument engagés à travers leurs installations, photographies, vidéos ou dessins à affronter les défis que pose l’Anthropocène : ce moment où les activités humaines perturbent en profondeur les processus naturels, impose à l’humanité de nouveaux comportements, un rapport à l’environnement, une culture et des mentalités à refondre.
Sans pessimisme, Courants verts, Créer pour l’environnement souligne avec les œuvres présentées le processus d’adaptation que traverse aujourd’hui l’humanité. L’exposition rappelle que l’art joue son rôle dans cette mutation essentielle caractéristique de l’actuelle transition climatique en agissant sur les imaginaires et en proposant de nouveaux récits.
Avertir, Agir et Rêver sont les trois axes qui composent le parcours de l’exposition sous le regard de son commissaire, Paul Ardenne, historien de l’art et auteur de l’ouvrage Un Art écologique. Création plasticienne et anthropocène (Le Bord de l’Eau, 2018 ; sec. Édition augmentée, 2019).
Déployée sur les 400 m² de l’espace Fondation groupe EDF, l’exposition est accompagnée d’un large volet pédagogique invitant les visiteurs à poursuivre la réflexion engagée à travers des masterclasses, des conférences et des ateliers.
Parcours de l’exposition
AVERTIR
Avec l’urgence environnementale, l’un des premiers réflexes de l’artiste est d’avertir. L’exposition donne à voir cette position de l’artiste, celle de sentinelle et de lanceur d’alerte. Avertir, pour l’artiste soucieux des questions environnementales, c’est fréquemment rendre manifeste une anomalie, à l’instar des grands planisphères muraux, de type wallpainting, diversement nommés Dérive des continents ou Anthropocène de Christiane Geoffroy (depuis 2010).
À nos regards, l’artiste offre le dessin d’une carte du monde modifiée de façon à dilater les zones de notre planète où l’on pollue beaucoup tandis que se voient parallèlement réduites celles où l’on pollue peu. La déformation des contours géographiques induit pour l’occasion une autre déformation, celle de l’écosystème même. L’avertissement peut aller jusqu’à convoquer la notion de disparition – parce que l’irrespect de l’environnement, rien moins, le détruit et contribue à tuer….

Disparition de l’écosystème liquide de la mer d’Aral avec Sarah Trouche qui, perchée sur la carcasse d’un bateau de pêche abandonné, lutte de tout son corps peint de bleu (la couleur de l’eau qui a disparu de cette zone pour cause de sur-irrigation du coton) contre le vent qui balaye un espace sec devenu un désert de roches, de sable et de sodium (Aral Survival, 2013).
Disparition des animaux avec Ackroyd & Harvey (Stranded, 2006) qui transforment le cadavre d’une baleine échouée sur la côte du RoyaumeUni, en une stupéfiante sculpture d’os et de bijouterie. Comment ne pas lire en cette œuvre qui mélange les sciences naturelles et l’art un hommage à la vie dans sa manifestation la plus ultime et aussi la désolation ou la tristesse face à la faune menacée de disparition.
AGIR
La pulsion qui consiste à avertir induit que l’on agisse, que l’on ne demeure pas inerte face à une situation devenue scandaleuse ou insoutenable. L’art écologique, volontiers modeste dans ses entreprises, ne vise pas la grande échelle, le bouleversement, il agit volontiers localement, en interaction constante avec des scientifiques, des territoires, des habitants, des communautés.
Thierry Boutonnier, incarne et valorise la figure de l’artiste jardinier (le jardin, comme un tableau, comme une sculpture, est une œuvre d’art). Son objectif est de récupérer et de faire revivre la flore de la région parisienne mise à mal par l’urbanisation.
La dimension sociale de l’œuvre d’art redouble sa dimension écologique. Il s’inscrit dans le sillage de Joseph Beuys qui a réalisé, en 1982 en Allemagne, une « action » appelée à devenir légendaire en mettant à contribution le public d’une manifestation d’art contemporain pour planter avec lui « 7000 mille chênes ».
Jérémy Gobé ou encore Olga Kisseleva illustrent eux aussi l’engagement local des artistes pour changer le monde et du lien fort qui existent depuis les années 2010 entre l’art et les scientifiques. Ces deux artistes, l’un français, l’autre russe, entreprennent de sauver la nature avec des moyens variés, pour le premier, la barrière de corail (Corail Artefact), pour la seconde, des espèces d’arbres disparues de Méditerranée ou d’Océanie (EDEN).
RÊVER
L’art n’est pas un moyen d’action comparable à l’engagement des militants, des associations et des entreprises. Demander à l’artiste « vert » d’être le sauveur d’un monde dont l’environnement se délite sous ses yeux est nécessaire et évident mais excessif.
Dans cette section, les artistes représentés ont à cœur, non l’illusion que l’on peut sauver le monde avec des créations nées de leurs imaginaires, mais l’espoir que ces derniers soient contagieux. Ils ont pour point commun une volonté d’indiquer une direction et d’impulser des comportements vertueux, donnant sens à ce paradigme : « Nous avons l’art pour admettre le possible d’une autre réalité ».
Se rappelant que la Bible parle de la présence, dans le jardin d’Eden, d’un arbre qui porte quarante fruits différents, Sam Van Aken met toute sa compétence d’artiste biologiste à récréer ce végétal mythologique et magiquement nourricier à coup de greffes, de boutures et de combinaisons arbustives contre-nature – et y parvient.
Nathan Grimes, à partir d’une écorce de bouleau, crée de la musique en s’inspirant, en guise de partition, des stries horizontales discontinues dont est marquée la peau de cet arbre.
Quant à Jacques Rougerie, architecte spécialiste des milieux marins qui se définit lui-même de « rêveur pragmatique », il se souvient dans ses projets de ville marine ou de vaisseaux explorateurs que la mer et l’océan sont avant tout des producteurs d’énergie et de ressources. Leurs mouvements, leurs courants, leurs capacités de filtration de la lumière, leurs températures et leurs degrés de salinité, leurs populations animale et végétale… et comme tels, les vecteurs d’une autonomie accrue pour ceux qui choisiront demain de les habiter avec sagesse et dans le respect de leur offre environnementale.
L’art rend possible de telles propositions, propositions dont l’avenir humain fera ce qu’il veut, les démocratisant ou pas, leur donnant ou non une consistance vivable hors du périmètre exigu des centres d’art.
Restaurer, avec l’aide des artistes, notre lien intime au vivant
Entretien de Lauranne Germont, COAL, par Paul Ardenne

Lauranne Germond historienne de l’art et commissaire d’exposition, est co-fondatrice de l’association COAL qu’elle dirige depuis son origine en 2008 aux côtés de Loïc Fel et de Clément Willemin. À travers le Prix COAL, des actions de coopérations internationales et plus d’une cinquantaine d’expositions et de projets culturels de territoire, COAL est le premier acteur français à promouvoir l’émergence d’une nouvelle culture de l’écologie.
Paul Ardenne : la notion d’art « environnemental » est complexe. Les Anglo-saxons parlent d’« Eco Art », ce qui n’est pas forcément clair non plus. Comment définiriez-vous, pour couper au plus court, un art « vert » ?
Lauranne Germont : Il est toujours délicat d’enfermer l’art dans des catégories, d’autant que cet art « vert » recouvre une très grande diversité, une vaste nuée de pratiques verdoyantes ! Le terme d’art « écologique » a l’avantage de recouvrir le champ politique et social, d’en référer à la pensée complexe et systémique de l’écologie plutôt qu’à sa seule dimension environnementale, qui est assez réductrice. On peut aussi contester le recours à la couleur verte, qui tend par exemple à faire oublier le bleu. Celui de l’atmosphère et des océans, qui représentent pourtant 90 % du monde vivant…
Il faut donc gagner en précision. Une définition simple est exclue ?
Je distinguerai pour ma part trois typologies de pratiques à même de définir ce qui constitue aujourd’hui un art dit « écologique », des typologies qui souvent se croisent et se superposent : le témoignage et le partage de connaissance ; l’action politique et symbolique ; les pratiques de résilience.
Pouvez-vous développer ?
Première typologie : celle propre aux artistes qui témoignent, qui donnent un visage à l’anthropocène, qui rendent perceptibles tout à la fois l’ampleur de la crise écologique, les pollutions cachées, les souffrances lointaines, l’appauvrissement de ressources insoupçonnées, la dégradation voire la destruction des écosystèmes et leurs conséquences sur les populations, le vivant et les paysages. Cette approche recouvre une vaste palette de pratiques documentaires mais aussi, plus largement, une grande partie des démarches Art et science actuelles. Chaque manifestation de la crise écologique dévoile un champ de connaissances scientifiques qui suscite la fascination des artistes et bouleverse les imaginaires artistiques. Observations, expériences, travail de terrain…, les artistes s’approprient les outils des sciences pour explorer, pour comprendre et pour partager l’état de l’art en matière d’appréciation scientifique de la crise écologique. En retour, ils chamboulent l’univers de rectitude des laboratoires et leurs ouvrent des perspectives en termes de partage des connaissances et de sensibilisation à l’écologie.
Une création multidirectionnelle. Seconde typologie, disiez-vous, l’action politique et symbolique.
Oui, l’art qui agit sur les systèmes à l’origine de la crise écologique pour les dénoncer, les court-circuiter, les transformer. L’action artistique, dans ce cas, est plus délibérément politique. Ses armes sont la déprogrammation des imaginaires par l’écriture de nouveaux récits, utopiques et dystopiques, mais aussi par la décolonisation des systèmes de représentation jusque dans le champ lexical. Au point d’aller jusqu’à inventer de nouveaux mots pour nous permettre de parler de notre ressenti au contact du changement climatique, comme y invitent les artistes activistes new-yorkaises Heidi Quante et Alicia Escott. Mentionnons ici, encore, la sculpture sociale. Celle-ci réinvestit le champ du collectif pour donner aux citoyens le pouvoir de changer les règles a des échelles microlocale (Thierry Boutonnier). Également, le parasitage des cadre légaux (Amy Balkin, Maria Lucia Cruz Correia), avec pour but de faire reconnaître des droits ou des crimes environnementaux par le biais d’une action symbolique et collective forte. C’est là l’écologie politique en art. Elle se construit sur des liens de communauté, le partage, la convivialité et le symbolique.
Ce qui nous amène à votre troisième typologie, l’activisme direct.
Le troisième champ pratique, concernant la création « verte », entend agir directement au niveau des écosystèmes et de l’empreinte écologique, dans une perspective de résilience : l’art devient indissociable des façons de faire et de produire. Il se base sur des principes opératoires tels que l’économie des moyens, le réemploi, l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental, l’invention de nouveaux matériaux ou encore la restauration de milieux naturels (Anne Fischer). Il peut s’agir de ramener du naturel en ville ou au contraire de réactiver les potentiels d’espaces ruraux délaissés. On relève dans ce domaine une explosion des pratiques. En effet, on ne compte plus les tiers lieux et les projets de territoires ultralocaux portés par des artistes qui veulent réconcilier leurs convictions, leurs modes de vie et leur création. Les artistes deviennent alors diversement fermiers (Olivier Darné), ingénieurs (Jérémy Gobé), herboristes (Suzanne Husky), bergers (Fernando Garcia Dory), et même parfois araignée ou loup (Boris Nordmann).
Cette forme d’art se lie étroitement à la nature, de facto. Jusqu’à renouveler même la définition de l’art…
Oui. Même si ces exemples d’art « naturiste » rappellent justement que ce chemin de reconnexion à la nature, pour notre culture qui en est si éloignée, ne se fait pas si simplement. Aussi l’art écologique donne-til également naissance à toutes sortes de tentatives pour reconstruire un lien intime avec le vivant : dialoguer avec les espèces non humaines (interspecisme), raviver des états de conscience perdus par l’intermédiaire de pratiques spirituelles, rituelles ou chamaniques. Là aussi, c’est tout un champ de l’art contemporain qui s’y attèle.
Exister en dépit d’un système de l’art inadapté
Incontestable mutation des manières de « faire art », donc. Comment expliquer, toutefois, le relatif isolement de ces artistes ?
Cet isolement est en fait tout relatif. Un art isolé dans le monde de l’art peut-être mais pas forcément isolé dans le monde tout court.
Renversons la proposition : ne serait-ce pas plutôt le monde de l’art « traditionnel » qui se retrouve isolé ?
Je pense que le propre de l’art écologique est d’être beaucoup plus connecté au réel et aux autres sphères de la société que ne l’est l’art contemporain conventionnel : inclusif par nature, cet art est en interaction constante avec des scientifiques, des territoires, des habitants, des communautés, des établissements pédagogiques, des services d’urbanisme, des acteurs de conservation de la nature. On y compte aussi un grand nombre de collectifs, d’artistes qui n’hésitent pas à partager leur signature ! C’est justement cette interconnexion et ce sens du partage qui en font la richesse et qui me passionnent au quotidien. Je ne qualifierai donc pas l’artiste écologique d’isolé ! En revanche oui, il peut avoir des difficultés à exister ou à être reconnu dans les cadres institués de l’art contemporain.
Autre aspect problématique : la difficulté de montrer cet art « vert » dans les structures de visibilité hérités de la coutume telle que galeries d’art et musées. Et que dire du marché ?
Vendre des œuvres le plus souvent éphémères ou créées in situ n’est guère aisé. Vous confirmez ?
Les pratiques de l’art écologique, on l’a vu, sont diverses. Comme telles et relativement à ces pratiques, il existe plusieurs scènes de diffusion. Pour ce qui est de montrer cette création dans des lieux traditionnels de l’art, centres d’art et musées, rien de toujours évident en effet. Quand on s’investit tant dans des projets de terrain, qu’on privilégie des processus et des approches collaboratives à la production d’objet, il est parfois difficile de satisfaire à la fois à l’exigence muséale de la forme et à celle de l’éthique et de l’efficience ! Aussi, on constate que les artistes vont plus ou moins privilégier un domaine d’expression et de diffusion, ne pouvant les assumer tous. Pour autant, tous les artistes de l’écologie ont besoin d’une reconnaissance institutionnelle pour continuer à agir en tant qu’artistes et afin d’être reconnus comme tels. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe de plus en plus de nouveaux cadres pour montrer leurs œuvres et de publics demandeurs : des programmes de territoire, des résidences dans des lieux très divers, des projets d’urbanisme transitoire, des artists run spaces…
Quant au marché de l’art, s’il y a problème, il me semble que ce n’est pas du fait de l’incapacité dans laquelle seraient les artistes « verts » de produire des œuvres adaptées aux désirs du marché. Celui-ci, en effet, s’est depuis longtemps montré capable d’intégrer des œuvres immatérielles, très minimalistes ou conceptuelles, et de les monnayer très cher. En fait, la problématique du marché de l’art écologique est pour une large part corrélée à la question éthique et politique. Comment faire cohabiter ses convictions Exister en dépit d’un système de l’art inadapté écologiques avec le monde spéculatif et opaque du marché de l’art ? Comment fermer les yeux sur l’origine des grandes collections, fondations et prix d’art contemporain, bien souvent portés par des constructeurs automobiles, des financiers, des industriels du luxe, ceux-la même qui structurent et entretiennent le système hyperconsumériste et pollueur qui est en cause ? Nombre de courants d’art écologique, les plus militants pour sûr, se sont constitués via la contestation des sponsors ou des mécènes des grands musées (les pétroliers, notamment avec par exemple la coalition Art But Not Oil). La déclaration outrancière du président des Amis du Palais de Tokyo, en octobre dernier, contre Greta Thunberg, demandant qu’on « abatte » celle-ci (une déclaration qui, à juste titre, a préludé à son éviction), est à cet égard symptomatique : la question climatique reste un sujet subversif dans les sphères de pouvoir ! De quoi expliquer pourquoi c’est dans ce champ de l’art écologique qu’il y a le plus de tentatives de développer des nouveaux cadres de diffusion et des modèles économiques alternatifs, souvent basés sur le mutualisme et la gratuité, pour gagner en autonomie vis-à-vis des cadres institués : communautés, fablab, double activité…
Une mobilisation précieuse
Une donnée essentielle, s’agissant de cet art « vert », épris de la célébration ou de la défense de l’environnement : son efficacité… ou non. Ce type de création hâte-t-elle les prises de consciences ou ne vous paraît-elle pas parfois, en toute honnêteté et sans parti-pris, une création de circonstance, dans l’air du temps, de bonne conscience ?
Son efficience est à la fois modérée et toute-puissante. L’art subversif continue d’être, partout dans le monde, régulièrement interdit de représentation et condamné. Au sommet, on ne sous-estime pas le potentiel de déstabilisation de l’art, son pouvoir sur l’imaginaire et la conscience, son effet médiatique ! Sans doute l’efficience de l’art vert est-elle modérée quand l’artiste agit à son échelle, l’échelle humble d’un individu dont les processus jamais ne s’industrialisent. C’est aussi ce qui en fait la simplicité et la force. Comme un modèle où chacun peut puiser son propre pouvoir d’agir. J’aime beaucoup cette phrase que m’a dite une artiste, « j’ai l’impression d’être comme les moines autrefois, en dehors du chaos et de l’efficacité du monde, j’œuvre pour les autres en quelque sorte, je prends la peine de faire et de penser pour ceux qui n’en ont pas le temps ». Il y a dans cet art quelque chose de cet ordre-là, une action collective plus profonde – magique, symbolique, existentielle.
Alors oui, je veux croire que cet art est un repère pour avancer, surtout quand vient la nuit. Et quand il faut défendre plus que jamais ce à quoi nous tenons, la liberté et la beauté du monde tel que nous voulons qu’il continue à exister.
Il y a la mode, la « tendance » cependant…
En effet. Mais l’air du temps, les convenances, la bonne conscience ne m’intéressent pas. Est-ce qu’on les trouve dans cet univers-là ? Parfois oui, certainement, comme partout ailleurs, mais ce n’est pas dans cette direction qu’il faut regarder.
Il y a bien sûr une nouvelle génération de fondations culturelles aux aspirations green dont la réalité des engagements est parfois douteuse. Il y a des opportunismes politiques, des pratiques contradictoires mais peu importe, cela ne doit en aucun cas faire de l’ombre à ce qu’il y a de vrai et d’authentique aujourd’hui, l’explosion dans les arts comme partout ailleurs de cette magnifique volonté collective de réparer et de rééquilibrer ensemble l’ordre des choses. En cela, la mobilisation de plus en plus soutenue des artistes ne peut qu’être précieuse.
Commissaire d’exposition : Paul ARDENNE
Paul Ardenne est universitaire (UFR Arts Amiens), historien de l’art, commissaire d’exposition et écrivain. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage Un Art écologique, Création plasticienne et anthropocène (La Muette, 2018, 2e éd. augmentée 2019). On lui doit plusieurs expositions autour de la question environnementale : Aqua Vitalis – Eau et art contemporain (Caen, 2014), Dendromorphies – Créer avec l’arbre (Paris, 2018), Natura Loci (Gaspésie, Canada, 2018). Il est considéré comme un important historien de l’art, en France mais aussi à l’étranger (activité de conférencier international).
Exposition « Courants verts – Créer pour l’environnement » à la Fondation EDF, 6, rue Récamier – 75007 Paris – Du 18 mars au 10 juillet 2020