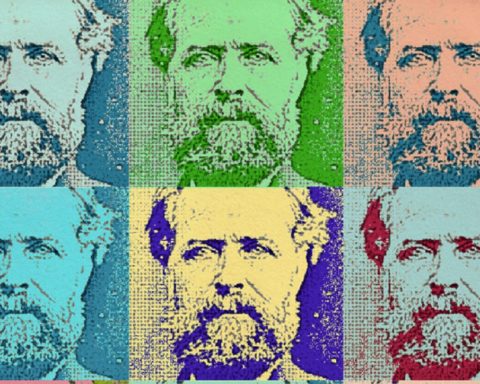Tous les lanceurs d’alerte du monde, les Greta Thunberg, les experts du Giec, les militants verts, jaunes ou bleus, les défenseurs de l’Accord de Paris, les plus écolos des écologistes, tous ne sont que des petits bras. Ils sont battus à plates coutures. Un virus est arrivé à réaliser ce dont ils avaient toujours rêvé : baisser les émissions de CO2 de la planète à un niveau exceptionnel. Il n’est pas question de se réjouir des conséquences humaines de cette crise sanitaire et économique. Le carbone baisse mais le nombre de morts monte en flèche, avec son cortège de privations et de désespoir. Mais les effets de la réduction drastique des voyages et des activités humaines sont patents ; ils seront durables, tout comme les nouveaux réflexes et comportements que nous avons été amenés, contraints et forcés, à adopter. Des changements profonds dont il faudra tirer les leçons.
Les images des satellites parlent d’elles-mêmes : la pollution s’est évaporée partout où les mesures de confinement ont été prises. Les particules fines dégagées par la circulation automobile et les activités industrielles ont disparu, elles ne nous rendent plus malades car l’air que l’on respire, même à travers un masque, est des plus purs. On se doute bien que, dès la levée des mesures de confinement et de restrictions, les taux de pollution remonteront en flèche. Mais ce que l’on a appris, c’est que leur disparition peut s’opérer avec une rapidité inouïe, dès que nos comportements changent.
Pour ce qui est du CO2 rejeté dans l’atmosphère, les effets pourraient être plus durables. En effet, ce que l’on oublie souvent, c’est que brûler du combustible fossile aujourd’hui, compromet la vie des générations dans le futur. Réduire ces émissions aujourd’hui est un bénéfice immédiat qui ira alléger le compte des générations venant après nous.
Les spécialistes nous disent que la contraction actuelle de l’activité se traduira par une baisse de moitié de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. C’est énorme et jamais vu dans l’histoire moderne. Cette réduction ne sera pas annulée quand le virus sera vaincu et que l’activité des hommes repartira de plus belle. C’est un gain, point. Les voyages en avion que nous avons annulés ne seront pas tous rattrapés. Les voyages manqués sont perdus. Même chose pour les déplacements professionnels comme pour les activités de loisirs.
Notre voiture reste au garage et n’émet plus de gaz carbonique. C’est un gain ; car quand l’activité repartira, nous ne nous jetterons pas sur les routes comme des forcenés pour rattraper le temps perdu. L’activité économique dans certaines régions du monde va enregistrer une baisse de 30 à 40 % à cause de la pandémie. Cette baisse d’activité entraîne mécaniquement une baisse des émissions de gaz à effet de serre. C’est un gain car, après le confinement, nous ne ferons pas tourner l’économie beaucoup plus vite et plus fort qu’avant.
Mais ce gain se paye au prix fort. Pour aplatir la courbe des émissions de CO2 combien de pertes humaines et de souffrances le coronavirus nous a-t-il fait payer ? Notre dilemme dans le futur sera de nous demander comment réduire notre impact sur le climat avec le minimum de souffrances et un maximum de justice sociale et économique. Faut-il attendre que la nature nous oblige comme elle le fait dans cette pandémie ? Nous devons espérer mieux.
La pandémie de coronavirus nous a obligés à changer nos modes de vie en quelques jours seulement. C’est le propre d’une catastrophe de ne jamais être envisagée tant qu’elle ne survient pas ; mais quand elle s’installe, bouleversant toutes nos habitudes, elle semble être installée dans notre mobilier quotidien. Sa réalité la rend banale. La crise sanitaire réduit la moitié de la population humaine sur Terre au confinement, et oblige à un arrêt brutal de la plupart des activités économiques. Les conséquences sont innombrables mais celles qui concernent le climat apparaissent en pleine lumière. Nous prenons conscience que ce qui semblait immuable, notre activité, notre business, notre façon de travailler et de vivre en général pouvait être changé. Radicalement. La formule implacable « business as usual » est disloquée. Cette situation étrange, causée par un phénomène naturel — la propagation d’un virus — entraîne de profondes modifications de notre conscience sociale. Il faudra comprendre ce qui a changé en elle, pour en tirer profit et éviter que la crise climatique ne se transforme en suicide collectif.
La science restaurée
Dans le monde entier, les chaînes d’information tournent en boucle sur la seule actualité du moment : la pandémie. A l’écran, se succèdent ce que chaque pays compte de mieux en épidémiologiste, médecin, chercheur, biologiste. Certains sont devenus en quelques jours des vedettes, volant la lumière aux politiques. Leurs paroles sont bues par tout le monde, attendues avec assiduité. On les écoute parce qu’on les croit. Les dirigeants s’en remettent ouvertement à eux dans leurs décisions. Le président de la République, le premier ministre et tous les ministres n’ouvrent la bouche qu’après avoir entendu la parole des scientifiques. Faut-il confiner tout un pays, fermer les écoles pour juguler la propagation du virus ? Ce sont les scientifiques qui le disent ; les politiques le décident. Dont acte.
La situation prend aux États-Unis des tournures qui pourraient être comiques si l’enjeu n’était aussi grave. Le président Trump contredit par un petit bonhomme à ses côtés, Anthony Fauci. Un immense scientifique appelé à la rescousse par la Maison Blanche pour gérer la crise. Il n’hésite pas à couper en public la chique au président tweetomane. Il le contredit, le contrarie, l’agace, ça se voit. Mais il est toujours là et Trump semble se résigner, comme un ado mal léché, à obéir. La parole de Fauci comme celle de tous ses homologues aux États-Unis et ailleurs est respectée. Car ces hommes sont des scientifiques ; ce qu’ils disent semble vrai et leurs injonctions dignes d’écoute.

Derrière ces têtes d’affiche, il y a une armée ; celle des médecins, des soignants, des infirmières, mais aussi celle des statisticiens qui travaillent dans l’ombre, celles des chercheurs dans leurs labos, celle des journalistes scientifiques qui éclairent le public. Une armada scientifique mobilisée pour sauver des vies et restaurer au plus vite l’organisation normale de la société. La crise du coronavirus a révélé leur importance. Leurs avertissements auraient dû être entendus à temps ; ils ne le furent pas et nous en pleurons aujourd’hui. Alors, leur prestige est rehaussé et brille dans les ombres de la tragédie qui se joue.
Des scientifiques, on en connaît dans un autre domaine que celui de la biologie et des épidémies. Ce sont les spécialistes du climat, de la biodiversité, des océans, de la nature. Depuis des décennies ils nous alertent ; ils produisent d’innombrables études, rapports, manifestes qui semblent tomber dans le vide sidéral de l’indifférence. Ils nous annoncent des dangers auxquels nous ne croyons pas. Faudra-t-il attendre que ces dangers nous arrivent en pleine figure, comme un coronavirus, qu’ils tuent en masse et détruisent tout ce qui était construit par l’homme, pour qu’on reconnaisse enfin qu’ils parlaient vrai ?
Il faut parier que la pandémie actuelle, en restaurant le prestige des scientifiques, sera bénéfique pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Nous avons appris en quelques jours à écouter les scientifiques qui savent ce qui nous attend. Il faut continuer à les écouter et mettre en œuvre leurs injonctions. Il n’est pas trop tard pour bien faire.
Il est possible de décider de décider
« L’action politique n’est pas morte. Il est possible de décider de décider » écrit Sylvain Tesson. La pandémie nous apprend que notre vie dépend des décisions prises par nos dirigeants. Ce sont eux qui ferment les écoles, nous confinent, nous mettent au télétravail ou au chômage technique, réquisitionnent des pans entiers de l’activité économique. A force de discours ultralibéral et de relégation des États aux bas-fonds de l’Histoire, à force de mondialisation et de dilution des décisions politiques dans les limbes supra-étatiques, nous avions oublié que le pouvoir politique existait. Quand il est exercé, il est levier d’action sur les choses et les gens.
La crise du coronavirus nous a appris que les décisions des dirigeants d’un État doivent être proactives et prises dans l’intérêt du peuple. Et de lui seul. Quand, « as usual », c’est le business qui est privilégié, c’est toute la société qui courre à sa perte. L’exemple américain est frappant. Trump, au début de la crise du coronavirus a voulu privilégier l’économie, quitte à sacrifier des dizaines de milliers de vies. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est la rapidité avec laquelle s’est installée une situation d’extrême urgence. Les hôpitaux de New York, premier foyer massif de l’épidémie, ont été immédiatement débordés, la Bourse s’est effondrée, les entreprises ont licencié. A l’heure où ces lignes sont écrites, c’est près de dix millions de personnes qui se sont retrouvé sans emploi en quinze jours. Certains sans aucune couverture médicale ou sociale. La crise a révélé les faiblesses d’une organisation politique dont on a longtemps dit qu’elle n’avait pas d’autre alternative.
Les dirigeants sont jugés par leurs peuples et seront jugés par l’Histoire non seulement sur la façon dont ils ont géré la crise, mais aussi sur la façon dont ils l’ont anticipée. Sur ce point, les failles sont immenses, presque partout dans le monde. Les scientifiques en général et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient depuis plusieurs années alerté les dirigeants de la planète sur les risques d’une pandémie prochaine et sur l’impréparation criante du monde. Ils n’ont jamais été écoutés. Cette chanson ressemble étrangement à celle que l’on entend à propos du climat. Les dirigeants ont, sur ce sujet, toutes les cartes en main pour anticiper. Ils ne le font pas par pusillanimité, incrédulité mais surtout parce qu’ils ne résistent pas aux pressions des intérêts contraires. Gageons que, crise du coronavirus passée, ils regarderont les rapports qui les alarment d’un autre œil. Aux citoyens qui les élisent d’être vigilants et prompts à les inciter d’agir dans l’intérêt commun.
La transformation de nos modes de vie
Pendant cette période étrange de confinement, nous avons appris à vivre différemment. Nous ne devons plus sortir, les parents redécouvrent la vie avec leurs enfants, les travailleurs qui le peuvent découvrent que travailler à distance s’apprivoise. Les sorties pour faire du shopping semblent un vieux souvenir, les virées d’un weekend oubliées, nous achetons nos produits au coin de la rue en évitant les grandes surfaces. Nous faisons avec ce que nous avons sous la main : des gâteaux aussi bien que des masques de protection. Système D et frugalité ne sont plus réservées aux quelques bobos amateurs de DIY. Les circuits courts deviennent une nécessité. Certains découvrent que la frugalité n’est pas forcément une privation et que nous pouvons renoncer à nos habitudes de consommation et de loisirs pour un objectif plus noble : arrêter la maladie et la mort de nos semblables.
Les sociologues s’intéresseront avec passion à cette période que nous traversons. Mais elle révèle déjà que nous sommes capables de changer pour des objectifs qui nous dépassent, des objectifs qui mettent en jeu la vie des autres. Serons-nous capables de changer pour le climat ? Nous montrerons-nous suffisamment lucides pour accepter que nos gestes impactent la vie de gens situés à l’autre bout de la planète ? Il le faudra.
 Et on doit faire preuve d’optimisme. Car la crise que nous traversons révèle chaque jour les milliers de gestes pour les autres. On s’aperçoit, dans ces temps de confinement, de l’importance des relations avec l’autre, des solidarités, de l’entraide. On se parle d’un balcon à l’autre, on s’appelle, on s’inquiète, on vit une autre relation avec des inconnus comme avec ceux qui étaient prétendument proches. Ici ce sont des jeunes des banlieues qui apportent des repas aux SDF ou aux familles démunies, tout en respectant les « gestes barrières ». Là, on réinvente les façons de se réunir, de s’aimer ou de jouer. On redécouvre des gens importants que l’on ne voyait jamais : les caissières des magasins, les transporteurs routiers qui nous acheminent la nourriture, les petits paysans qui cultivent pour nous. On s’aperçoit de l’importance de ce qui manque : le courrier des postiers, le travail des éboueurs… Qui, en cette période étrange s’intéresse au trader de la salle de marché faisant tourner les finances du monde, au dirigeant de multinationale gérant ses troupes depuis sa tour d’ivoire, à la star polychromée sur son yacht ? Les hiérarchies se sont inversées et ce sont maintenant les stars du football qui applaudissent les infirmières et les aides-soignants.
Et on doit faire preuve d’optimisme. Car la crise que nous traversons révèle chaque jour les milliers de gestes pour les autres. On s’aperçoit, dans ces temps de confinement, de l’importance des relations avec l’autre, des solidarités, de l’entraide. On se parle d’un balcon à l’autre, on s’appelle, on s’inquiète, on vit une autre relation avec des inconnus comme avec ceux qui étaient prétendument proches. Ici ce sont des jeunes des banlieues qui apportent des repas aux SDF ou aux familles démunies, tout en respectant les « gestes barrières ». Là, on réinvente les façons de se réunir, de s’aimer ou de jouer. On redécouvre des gens importants que l’on ne voyait jamais : les caissières des magasins, les transporteurs routiers qui nous acheminent la nourriture, les petits paysans qui cultivent pour nous. On s’aperçoit de l’importance de ce qui manque : le courrier des postiers, le travail des éboueurs… Qui, en cette période étrange s’intéresse au trader de la salle de marché faisant tourner les finances du monde, au dirigeant de multinationale gérant ses troupes depuis sa tour d’ivoire, à la star polychromée sur son yacht ? Les hiérarchies se sont inversées et ce sont maintenant les stars du football qui applaudissent les infirmières et les aides-soignants.
Le changement dans les appréciations de l’autre se traduit dans des gestes simples ; on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise. Ce faisant, on ne se replie pas, on ne se cache pas derrière son masque ; on se protège en protégeant l’autre. La santé d’autrui m’intéresse au plus haut point et, dès lors, on ne comprend pas que des États aient laissé perdurer des inégalités d’accès aux soins meurtrières. Les Européens en général et les Français en particulier s’aperçoivent, par contraste avec les images venues des États-Unis, que leur système de protection sociale et de santé est un trésor. La santé des précaires et un enjeu pour la santé de tous. Une leçon qui restera. Face aux dérèglements climatiques les inégalités seront appréciées d’une autre façon. On comprendra que laisser des gens seuls face aux catastrophes climatiques aura des répercussions sur chacun de nous. Le mot migrations climatiques prendra sans doute un sens nouveau.
L’argent serait-il une fiction ?
Dans cette période de crise inédite, les gouvernements ont demandé aux banques centrales d’ouvrir le robinet des finances. L’argent coule à flot, par milliers de milliards pour soutenir les entreprises, les ménages, les industries stratégiques, pour trouver des remèdes au Covid-19 et pour soutenir ceux qui ne peuvent plus travailler. Les pays européens ont montré l’exemple, la France notamment, en payant sur les finances publiques chômage partiel et indemnités. L’Amérique de Trump a un temps renâclé avant de décider la libération de 2 500 milliards de dollars pour soutenir l’économie. Le président américain l’a finalement fait pour réduire les conséquences catastrophiques d’une paralysie de l’économie américaine.
Sans intervention des États, dans ces situations de crise intense, les économies peuvent mourir. Abattues par le virus comme le sont les patients en crise respiratoire aigüe, face auxquels les médecins n’ont pas de respirateurs disponibles. Dans cette situation ultime, à cette échelle, l’argent n’est qu’une fiction sociale. C’est un bien public, dont nous devons immédiatement et radicalement étendre et maximiser l’utilisation, afin que des investissements massifs, vitaux et à l’échelle sociale puissent être réalisés, immédiatement.
La crise du coronavirus nous indique que cela est possible. Demain quand tout sera fini et que nous aurons la crise climatique à affronter, que ferons-nous ? Les États jugeront-ils la situation suffisamment urgente pour accorder des revenus à ceux qui seraient impactés par une transition énergétique vitale ? Trouvera-t-il de l’argent pour financer les passoires énergétiques qui laissent partir le CO2 par les fenêtres ? Trouvera-t-il des fonds pour réinventer les littoraux menacés par la montée des eaux, pour transformer nos modèles agricoles en les rendant plus doux avec les hommes comme avec la nature ?

- LIRE AUSSI DANS UP’ : Que ferons-nous de cette épreuve ? de Sylvain Tesson