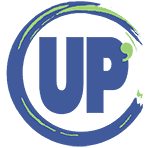Un mois après le Sommet de l’IA, que peut-on réellement en retenir ? Probablement plus que ce que certaines critiques voudraient laisser croire, notamment à travers la couverture médiatique qui lui a été réservée. En France, certains médias détracteurs se sont focalisés sur des incidents mineurs, tandis qu’à l’international, des titres tels que le Wall Street Journal ou le Financial Times ont salué l’événement.
Il n’est pas très difficile d’entretenir la polémique, en soulevant des arguments sur l’aspect anecdotique du Sommet à l’échelle de l’IA, sur la nature des investissements — annoncés par une majorité de datacenters —, sur leur faisabilité réelle, ou encore sur la tribune offerte au vice-président américain.
Il me semble toutefois qu’il est difficile de contester que ce sommet représente une étape significative, à l’image des engagements financiers importants qui s’y sont manifestés. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 50 milliards de dollars ont été promis par les Émirats arabes unis, et la dynamique d’investissement suite au Sommet pourrait largement dépasser les 100 milliards d’euros, bien au-delà des événements traditionnels comme Choose France, qui génèrent entre 10 et 15 milliards d’euros les bonnes années. Et cela sans compter les 50 milliards d’euros annoncés par la présidente de la Commission européenne, dont la France devrait mécaniquement tirer parti.
Mais au-delà de ces chiffres, ce sont les signaux informels qui sont intéressants. Lors d’un des dîners qui ont jalonné ce sommet, l’un de mes voisins israélien a, je trouve, résumé la situation avec philosophie : “On parle d’une révolution technologique majeure. Mais ceux qui la gagnent sont sans doute ceux qui s’y engagent avec continuité. Le véritable classement se dessinera certainement dans vingt ans ; d’ici là, il s’agit d’attirer les meilleurs, et quelques pays, dont la France, s’y attèlent très bien.”
J’ai bien été amusé, le lendemain matin, d’entendre une chercheuse et CEO suédoise annoncer qu’elle envisageait de centraliser l’équipe de sa startup — pour l’instant dispersée aux quatre coins du monde — à Paris.
Au moment même où j’écris ces lignes, une compétition extrêmement darwinienne est en train de se jouer. Dernier exemple en date : l’annonce du nouveau modèle chinois Hunyuan-TurboS, qui bat tout ce qui préexiste en matière de LLM. L’excellence scientifique est indéniablement un atout clé dans cette course, et la France s’y positionne plutôt bien. Mais est-on certain que cela fera la différence sur une perspective de vingt ans ? Après tout, ces modèles ne sont-ils pas appelés à se banaliser à mesure que la compétition s’élargira ?
En réalité, l’idée même de course, et de rattrapage dans le cas de la France, est discutable : Peut-on, et doit-on, construire un moteur de recherche capable de rivaliser un jour avec Google ? Un fabricant d’ordinateur qui ferait la moindre ombre à Apple ? Probablement pas.
En revanche, l’idée de faire émerger un écosystème d’IA qui corresponde à la nature des principes collectifs européens semble intéressante. Ce qui nous distingue des États-Unis, c’est l’attention que l’on accorde à la solidarité, à un système qui soit aussi inclusif que possible, au fait de prêter attention aux enjeux environnementaux. Longtemps, cette attention s’est reflétée dans l’excellence de notre école publique, de notre système de santé. Peut-être est-ce moins vrai aujourd’hui, mais justement, le potentiel technologique nous offre une opportunité de reconstruire cela sur de nouvelles bases. À condition, bien sûr, d’être capable d’affirmer haut et fort nos convictions, nos valeurs, et d’inscrire le développement de l’intelligence artificielle dans ce cadre.
Pour appréhender les enjeux et les opportunités liés au Sommet de l’IA à Paris, accédez à cet article.
Gilles Babinet, Coprésident du Conseil national du numérique depuis 2021 et digital champion de la France auprès de la Commission européenne depuis 2013. Auteur de « Green IA L’intelligence artificielle au service du climat« , 27 mars 2024 (Éditions Odile Jacob)