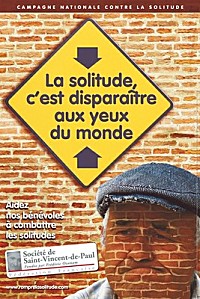Contre l’utilisation abusive du mot crise, l’auteur d’ « un autre monde est possible », ancien reporter de guerre, journaliste, écrivain, milite pour le recours à un « optimisme stratégique ». Voici l’excellent article de Caroline Castets résumant ses positions.
Il ne croit ni en « la crise » – concept qui suppose un retour à la normale et évoque donc un état plus passager que définitif -, ni en la fin annoncée de la démocratie et du vivre-ensemble. Journaliste, écrivain, et auteur d »‘Un autre monde est possible », Jean-Claude Guillebaud croit en une mutation d’une ampleur prodigieuse. Tellement prodigieuse que pour l’heure, nous n’avons ni les mots ni les concepts pour la nommer et la comprendre. Une mutation porteuse de menace mais aussi de formidables promesses qui, pour se réaliser, requièrent autre chose que le pessimisme et la dérision du moment. Autre chose que ce « cynisme tendance » qui, « parce qu’il est à la fois auto-réalisateur et démobilisateur », agit sur nos sociétés comme un poison en alimentant la désaffection pour la chose publique au risque de précipiter les démocraties dans la crise.
Son antidote : une autre grille de lecture face à la réalité actuelle. Empreinte d’un optimisme non pas béat mais lucide et donc, « stratégique ». De cette « énergie d’action » qui, selon lui, « pousse les gens vers les urnes ou la place Tarir » et qu’il appelle l’espérance. Explications.
« Depuis quelques années, on constate une récurrence du mot crise dans le langage public. Que ce soit dans les journaux, à la radio ou à la télévision, il est utilisé plusieurs centaines de fois par jour pour évoquer la réalité actuelle et même s’il est prononcé de bonne foi, j’y vois un terme mensonger ; un terme qui nous induit en erreur parce qu’il évoque un état passager et sous-entend qu’une fois cet épisode passé, on en reviendra plus ou moins à la situation antérieure. En termes économiques, cela équivaut à croire qu’on renouera avec la croissance, avec le chômage à 4 % etc., ce qui est évidemment faux.
Pour la bonne raison que ce n’est pas une crise que nous vivons mais une mutation gigantesque. Et je pense qu’à condition de faire un effort d’analyse, en prendre conscience est plutôt rassurant. Parce que nous vivons en réalité cinq mutations qui s’enchevêtrent, qui interagissent les unes sur les autres jusqu’à, au final, n’en former plus qu’une, prodigieuse. Ce qui est paradoxal c’est que tout le monde a plus ou moins conscience de ces différentes mutations mais que personne ne les met en perspective. D’où la méprise sur la situation actuelle.
Mutation géopolitique
La première mutation évidente que nous vivons est de nature géopolitique et ses conséquences sont majeures puisqu’elle implique que c’en est fini de la centralité du monde occidental ; autrement dit d’une situation d’hégémonie économique, technologique, militaire et même culturelle qui perdurait depuis quatre siècles et qui est aujourd’hui révolue. Ce qui signifie que le monde tel que nous l’avions toujours connu n’existe plus, qu’il est aujourd’hui décentré. Pour autant je ne pense pas qu’il faille y voir le déclin de l’Occident – contrairement à ce qu’affirment certains – car ce monde que nous avons dominé pendant des siècles, nous l’avons profondément remodelé ; au point que même des pays qui nous paraissent extrêmement éloignés de notre culture, comme l’Inde ou la Chine, sont profondément occidentalisés.
Seconde mutation, la mondialisation
De cette première mutation en découle une autre, évidente et tout aussi majeure : la mondialisation, laquelle entraîne une critique d’ordre à la fois économique et idéologique, certains y voyant uniquement une opportunité, d’autres uniquement une catastrophe. Deux perceptions erronées, à mon avis. Pour moi la mondialisation est à la fois une prodigieuse promesse qui a permis à des millions de gens de sortir du sous-développement et une menace pour l’Europe puisqu’elle a notamment eu pour effet d’accélérer sa désindustrialisation. Ce qui est certain c’est que la mondialisation a non seulement un impact sur l’économie mais qu’elle en a aussi un sur la démocratie.
Jusqu’à présent l’économie était comparable à un cheval que nous avions appris à domestiquer en l’enfermant dans un paddock appelé l’Etat-nation et progressivement discipliné à coups de lois sociales et de code du travail ; jusqu’à parvenir à ce modèle européen d’après-guerre qu’on appelle l’économie sociale de marché. Modèle qui n’était viable, encore une fois, qu’à la condition qu’il demeure dans les limites de l’Etat-nation. Or au début des années 80, le cheval a sauté par-dessus la barrière si bien qu’il est désormais libre de toute attache et cavale à travers le monde en créant beaucoup de richesses et en faisant beaucoup de dégâts. En Europe, nos gouvernants – de droite comme de gauche – s’efforcent de retrouver la maîtrise de cette économie en répétant « il faut réguler la mondialisation ».
Ce qui est affligeant c’est que, pour y parvenir, ils multiplient les concessions comme autant de morceaux de sucre qu’ils tendraient au cheval pour le faire revenir : conditions fiscales avantageuses, droit social moins contraignant… Tout est bon pour parvenir à un « détricotage » du code du travail supposé, comme le disent certains, « rendre à nouveau la France compétitive ». Ce qui est fondamental c’est que, ce faisant, la mondialisation nous oblige à refonder notre système actuel pour parvenir à un nouvel équilibre démocratique. A quelque chose de moins pyramidal, de moins autoritaire qui, pour l’heure, reste à inventer. Ce qui explique que cette deuxième mutation constitue un bouleversement majeur pour l’ensemble de nos sociétés modernes.
Le sixième continent
La troisième mutation est celle liée au numérique, que l’on a d’abord pris pour un simple vecteur d’amélioration de notre vie quotidienne et qui, en réalité, est beaucoup plus que cela puisqu’il s’agit de l’informatisation de la société tout entière. Le phénomène a débuté au début des années 80 et je pense qu’on commence seulement aujourd’hui à prendre la mesure de son impact planétaire. C’est simple : il y a 7 milliards d’habitants sur la Terre et 5 milliards de téléphones portables en service. Ce qui signifie que, si l’on exclut les enfants en bas âge, presque tous les habitants de la Terre sont connectés. Non seulement au téléphone mais, avec l’explosion des smartphones, à Internet. L’ampleur du phénomène est telle que tout se passe comme si, avec Internet, un sixième continent était venu s’ajouter aux cinq existants, créant un territoire mal défini ; dépourvu de frontière physique – chaque jour s’ajoutent plusieurs dizaines de milliers de sites sur Internet – et temporelle puisque, sur la Toile, la notion de temps, « d’heure qu’il est », tout comme celle d’espace et de lieu, devient friable, évolutive.
Cette révolution est d’autant plus prodigieuse que, depuis quelques années, toutes les activités humaines quittent la terre ferme pour s’installer sur ce sixième continent : les activités marchandes, les flux financiers, les professions qui, ce faisant, se transforment toutes radicalement. C’est le cas pour l’éducation – tout élève pouvant apprendre plus en dix minutes sur Google qu’en deux heures en salle de cours, ce qui implique de repenser l’acte éducatif – mais aussi pour la médecine – les patients s’autodiagnostiquant de plus en plus sur les forums et sur les sites dédiés à la santé – et pour la quasi-totalité des secteurs d’activités dits classiques. Au point que les fondamentaux de l’économie s’en trouvent bouleversés et, avec eux, la nature même de l’économie.
La révolution biologique
A cela s’ajoute la révolution biologique qui a commencé au milieu des années 50 avec la découverte de l’ADN et qui n’a vraiment débouché sur des applications concrètes qu’à partir des années 80. Là encore le bouleversement qu’entraîne cette révolution est majeur pour nos sociétés modernes puisqu’il impacte jusqu’au concept d’identité individuelle. Pour la première fois depuis l’histoire du monde, nous avons mis la main sur les mécanismes de la vie, ce qui nous permet de fabriquer des espèces nouvelles, d’en transformer d’autres et de modifier jusqu’aux structures de la parenté avec, pour un même enfant, la possibilité d’avoir un père donneur de sperme, une mère donneuse d’ovocites, une mère porteuse et un père adoptif… Si bien qu’à travers la dilution du concept de parenté, c’est celui d’identité même qui, comme les notions de temps et de lieu sur Internet, devient fluctuant. Ce qui crée un bouleversement gigantesque et cette fois encore, porteur à la fois de promesses formidables – notamment en termes d’avancées médicales et de gains en espérance de vie – et de menaces sur les fondements de nos sociétés.
La mutation écologique
Autre bouleversement de taille dans notre façon de penser le monde et l’avenir : la mutation écologique qui, tout à coup, nous donne à voir un monde non pas sans limites comme on l’avait longtemps imaginé mais au contraire fini. Circonscrit par la diminution irréversible de ses propres réserves. Si bien que désormais, nos entreprises humaines, nos projets, butent sur les limites de ce monde, en matières premières, en pétrole… Un célèbre économiste donnait sur le sujet un exemple saisissant en indiquant que si, dans dix ans, les Chinois avaient autant de voitures que les Américains par 100 000 habitants, alors la Chine, à elle seule, consommerait toutes les réserves pétrolières du monde. Cette prévision simple prouve qu’il existe désormais une barrière bien réelle à notre vision de l’avenir et nous oblige à en tenir compte dans notre façon d’appréhender et de bâtir cet avenir.
Un monde impensé
L’accumulation de ces cinq mutations aboutit aujourd’hui non pas à une « crise » mais à un changement radical et surtout définitif qui explique que nous vivions un immense basculement de notre société. Aussi important que la fin de l’Empire romain ou que la Renaissance. Peut-être même davantage puisque, de l’avis de Michel Serres, la révolution sociétale que nous connaissons aujourd’hui serait aussi importante que celle du néolithique. En prendre conscience rend un peu dérisoires les empoignades sur la « crise » et le montant de la dette et, surtout, nous renvoie à notre responsabilité politique et citoyenne puisqu’il nous appartient de faire advenir les promesses et de conjurer les menaces que véhicule cette révolution. Laurent Fabius m’avait dit un jour : « Ces problèmes sont décisifs mais nous n’avons pas encore appris à les rendre lisibles démocratiquement. » Et de fait personne, pas plus les philosophes que les politiques ou les analystes, ne parvient aujourd’hui à formuler cette mutation et à expliciter les enjeux qu’elle comporte ; si bien que nous sommes dans un monde encore impensé. Bâti sur d’anciens schémas. Ce qui nous place dans une situation nouvelle et prodigieusement complexe. Les concepts élémentaires – de temps, de lieu, d’identité… – qui nous ont toujours permis de comprendre le monde sont obsolètes. Il nous faut donc réinventer un mode de désignation du monde. Ce qui explique sans doute que nous assistions à l’heure actuelle à un regain d’intérêt pour la philosophie.
La tentation du cynisme
Face à tout cela, la tentation du cynisme est omniprésente et tragique. Rien n’est pire que cette mode de la dérision permanente qui fait passer ceux qui ne s’y conforment pas au mieux pour des naïfs, au pire pour des imbéciles. Pour moi, elle s’inscrit parfaitement dans ce concept dit de la prophétie autoréalisatrice – The self-fulfilling prophecy – théorisée par le sociologue américain Robert Merton, qui désigne une catastrophe que l’on provoque en l’annonçant. En 2008, lorsque l’annonce de la faillite de Lehman Brothers s’est répandue, on a entendu beaucoup de personnes prédire la faillite des banques. Si l’on avait tous succombé au pessimisme et avions cru à ce risque de faillite, nous nous serions tous précipités dans nos banques pour y retirer nos économies et aurions effectivement provoqué la faillite du système bancaire. C’est dans cette force d’entraînement que réside toute la dangerosité du concept de prophétie autoréalisatrice. De même, je pense que le pessimisme et le cynisme sont autoréalisateurs. Si bien que si l’on persiste à répéter que tout est foutu, qu’il n’y a plus d’avenir et que l’on s’en convainc, alors nous engendrerons ce monde de plus en plus brutal, injuste et dépourvu de sens que nous redoutons. C’est pour cela que je trouve extrêmement dangereux et nuisible de céder à cette tentation collective du cynisme.
Dissidence démocratique
Le pessimisme, parce qu’il est à la fois autoréalisateur et démobilisateur, est une composante de cette mutation que nous sommes en train de vivre. Il fait partie du problème puisque l’enjeu actuel consiste à refonder la démocratie et à réinventer le vivre-ensemble, et que se complaire dans le pessimisme revient à s’interdire toute forme d’action constructive. Pour que la démocratie fonctionne, qu’elle soit vivable, qu’elle ait un sens, il faut que chacun ait le sentiment de participer aux choix collectifs. Si l’on se persuade qu’il n’y a rien à faire, que tout est joué et perdu d’avance, alors on s’exclut du jeu collectif et la démocratie entre en crise. Ce qui est d’ailleurs le cas aujourd’hui puisqu’aux Etats-Unis, le taux d’abstention atteint un niveau historique et que moins de la moitié des citoyens votent.
Il y a donc une réelle désaffection pour la chose publique ; une dissidence démocratique qui peut prendre soit la forme de l’abstention, soit celle du populisme, qu’il soit d’extrême droite ou d’extrême gauche ; ce qui constitue un réel danger pour les sociétés. Voilà pourquoi je maintiens qu’il vaut mieux être idéaliste que cynique et que je préfère m’entendre reprocher un côté Bisounours que venir nourrir le pessimisme ambiant. Goethe lui-même le disait : « Le pessimiste se condamne à être spectateur. » Et donc à laisser la décision aux marchés financiers et au progrès technologique qui avance tout seul. Pour ma part, je suis partisan d’un optimisme stratégique.
L’espérance
Bien évidemment, il n’est pas question de tomber dans la niaiserie. Pour être constructif, l’optimisme doit s’inscrire dans la lucidité. Prétendre qu’il n’existe ni obstacles ni souffrances n’aurait aucun sens. C’est pour cela que je préfère employer le mot espérance. A ce sujet, saint Augustin est l’auteur d’une phrase formidable qui est plus que jamais d’actualité : « L’espérance a fabriqué deux beaux enfants : la colère devant l’injustice du monde et le courage de la changer. » Pour moi l’espérance est à prendre ainsi : comme une énergie d’action, une émulation qui va pousser les gens vers les urnes ou la place Tahrir. Une énergie dont le mouvement des Indignés ou le Printemps arabe sont des manifestations.
Car si nos sociétés paraissent fatiguées et démobilisées, si nos politiques semblent en crise, les sociétés civiles, elles, sont incroyablement dynamiques. Regardez le Vietnam. Officiellement c’est toujours un pays communiste, gouverné par une bande de vieux crabes du Parti ; c’est encore un régime capable d’attenter aux libertés, d’emprisonner les gens, etc. Et pourtant la vitalité de la société civile vietnamienne est incroyable. D’une créativité et d’un dynamisme fabuleux. Partout se vérifie ce divorce entre la politique officielle, les partis, les syndicats, les institutions qui forment la carcasse du Vieux Monde et la société civile qui invente, qui projette, qui fuse… La révolution arabe en est un autre exemple. On s’inquiète aujourd’hui de la voir virer au fondamentalisme religieux mais on oublie qu’en France, notre révolution a débouché sur la Terreur et qu’il lui a fallu un siècle pour accoucher de la démocratie. On voudrait donc que les pays arabes fassent en un an ce qu’il nous a fallu un siècle à accomplir !
Lorsque j’étais grand reporter au Monde, pendant des années j’ai couvert à peu près tous les conflits de la planète. Et lorsque je repense à ces années, ce dont je me souviens le mieux c’est de ces gens qui, dans les pires situations, trouvaient encore l’énergie d’agir. Après cela, rentrer à Paris et sombrer dans le pessimisme tendance était pour moi tout simplement impossible.
Reporters d’Espoir
En Europe le mouvement des Indignés a produit des textes d’une grande intelligence qui réinvente la non-violence avec des références récurrentes à Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi. C’est vrai que tout cela ne se traduit pas encore en programmes politiques, que cela reste pour l’heure un bouillonnement confus. Mais nous sommes dans un monde en devenir. Un monde qui est déjà là en partie et je reproche aux médias d’en rajouter dans la noirceur et le pessimisme au lieu de pointer son émergence. C’est pour cela que je me suis engagé il y a quelques années dans une ONG appelée Reporters d’Espoir. Parce qu’il existe beaucoup de bonnes nouvelles dont on ne parle jamais. On est convaincu – et les éditorialistes nous le rappellent constamment – que le monde est à feu et à sang.
Pourtant, statistiquement, il apparaît que la décennie 2000-2010 est la moins meurtrière depuis un siècle et demi. On sait que nos sociétés européennes sont beaucoup moins violentes qu’autrefois. Que depuis des siècles, la violence n’a cessé de reculer. Mais personne ne nous le dira parce qu’on est convaincu que seul le catastrophisme fait vendre ; ce qui est faux ! Quand je m’occupais de Reporters d’Espoir nous avions réalisé sur ce thème des partenariats avec plusieurs organes de presse, dont Libé, avec qui nous avions sorti il y a quelques années un journal appelé Le Libé des solutions. Il a été la meilleure vente de l’année. Nous avons réitéré l’expérience avec Courrier international et, cette fois encore, le numéro a été leur meilleure vente. Preuve que la course à la noirceur et au cynisme n’est pas ce que les gens attendent. »
A propos de Jean-Claude Guillebaud, homme de conviction
Après des études de droit et de sciences criminelles, Jean-Claude Guillebaud fait son entrée dans le journalisme en 1965. D’abord grand-reporter pour le journal Sud-Ouest, puis reporter de guerre pour le Monde, il obtient le Prix Albert-Londres en 1972 avant de rejoindre le Nouvel Observateur à la fin des années 80. Quelques années plus tôt, en 1985, il a créé avec Robert Ménard et Rony Brauman l’association Reporters sans Frontières pour la liberté de la presse.
Association qu’il présidera pendant des années et d’où il militera activement en faveur d’une démarche autocritique des médias. Membre du comité de parrainage de la coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence ainsi que du conseil de surveillance de Bayard Presse, il est également conférencier et écrivain, auteur prolixe d’une vingtaine d’ouvrages sur les conflits qu’il a couverts mais aussi de nombreux essais parmi lesquels La Force de la conviction, Le Commencement d’un monde et, paru il y a quelques mois chez l’Iconoclaste, Une autre vie est possible dans lequel il fustige la « désespérance » qui pollue nos sociétés modernes.
(Par Caroline Castets / Le nouvel économiste.fr)
{jacomment on}