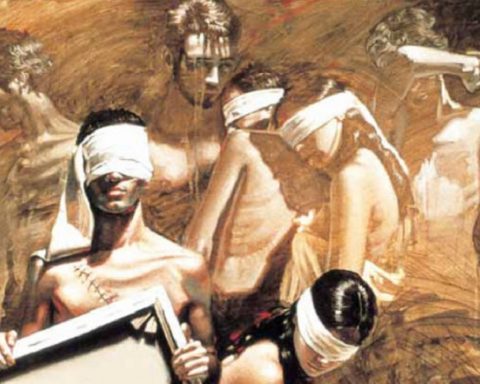Dans la période actuelle de transition, de mutation, voire de basculement, la question des savoirs se pose de façon cruciale. Au cœur des nouvelles représentations que la réalité impose, ils pourront ouvrir des récits et des pratiques d’innovation, d’adaptation, voire de rupture. Pour connaître et comprendre le monde où l’on vit, et y agir, on a majoritairement recours à deux types de savoirs, le savoir académique, le faire-savoir. Mais creuser un puits, fabriquer un panier, cuisiner un plat, tisser une couverture, cultiver des légumes, cueillir et utiliser les plantes médicinales, connaître les secrets de la pêche, construire une pirogue, etc. sont des savoir-faire liés à des savoirs traditionnels qu’on appelle aussi savoirs autochtones. Ils ne s’enseignent pas à l’école, mais aujourd’hui, ces savoirs, on les redécouvre, on s’intéresse à eux. On découvre qu’ils sont porteurs de valeurs et d’une modernité nouvelle, celle qui n’épuise pas la terre, mais la respecte, celle qui replace l’humain au sein du Vivant et de son territoire. Ces savoirs pourraient devenir la clé de notre futur.
Rappel des savoirs
Pour connaître et comprendre le monde où l’on vit, et y agir, on a majoritairement recours à deux types de savoirs, le savoir académique, le faire-savoir.
Le savoir académique est apporté par l‘éducation à l’école sous forme d’apprentissages de base : lire, écrire, compter… des outils qui ouvrent à l’acquisition de connaissances enseignées dans différentes disciplines, géographie, histoire, sciences, mathématiques, arts, etc. et qui seront par la suite développées dans les universités ou les Grandes Ecoles. Par leur classement méthodique, ces connaissances éveillent les facultés mentales et notamment l’intelligence abstraite. Ils la raffinent, la polissent, et préparent à la vie active dans des sociétés organisées sur ces principes méthodiques.
Ce savoir académique reflète la culture occidentale ou occidentalisée : il est essentiellement un savoir rationnel. « C’est un discours de la raison sur le monde » dit Roland Barthes. « Et en ce sens, ajoute-t-il, quelque soient ses conquêtes, ses audaces, ses générosités, il ne peut échapper au rapport d’exclusion… » En effet, il s’inscrit dans le cadre exclusif de la raison. On acquiert des connaissances, on sait les organiser, mais deux choses manquent : la connaissance sensible et la connaissance intuitive. Il manque aussi l’apprentissage de la mise en pratique de ces connaissances : on sait beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on ne sait pas les activer.
Le faire-savoir consiste à transmettre ce que l’on sait, ses idées, ses convictions, son art ; transmission qui se fait généralement à travers la parole ou l’écriture, et au travers de technologies qu’il faut apprendre à maîtriser. Complexes, ces technologies de la communication font souvent perdre de vue le message à transmettre. Souvent submergé par cette complexité technologique, l’humain perd de vue le contenu du message, absorbé par le médium, c’est à dire par l’outil qui transmet : « Le medium devient le message » comme l’avait prédit Mac Luhan. Ainsi confond-t-on la fin et les moyens.
Les savoirs et savoir-faire traditionnels ou savoirs autochtones
Creuser un puits, fabriquer un panier, cuisiner un plat, tisser une couverture, cultiver des légumes, cueillir et utiliser les plantes médicinales, connaître les secrets de la pêche, construire une pirogue, etc. sont des savoir-faire liés à des savoirs traditionnels qu’on appelle aussi savoirs autochtones. Ils ne s’enseignent pas à l’école, mais s’apprennent spontanément par la pratique, au cours de la vie quotidienne, dans la famille ou la communauté.
Ces savoirs minutieux ont été élaborés et transmis en direct de génération en génération pour répondre aux besoins fondamentaux des humains vivant sur un territoire donné.
Ils constituent le mode de vie propre à ce territoire et à ses habitants. Ils sont en lien étroit avec la nature, ses ressources et ses limites qu’ils respectent. Ces savoirs autochtones illustrent le mode de vie, l’organisation sociale, la culture d’une communauté vivant sur un territoire. Leur spécificité est locale, mais par leur lien avec la nature, ces savoirs participent de son universalité exprimée dans la biodiversité.
Ces savoirs et savoir-faire ont été longtemps oubliés et tenus à l’écart, et ce depuis l’avènement de l’ère industrielle associée à la connaissance scientifique considérée comme seul outil de connaissance et d’évolution vers un progrès supposé continu et dispensateur de bienfaits.
Oubliés aussi parce qu’ils appartiennent à des populations en déclin – populations rurales ou à des peuples liés à la nature – qui furent peu à peu, et encore aujourd’hui, déconsidérés par rapport aux populations urbaines en croissance constante, et représentant cette nouvelle culture industrielle forgée dans la vision d’un progrès indéfini.
On a reproché à ces savoirs autochtones d’être figés, de ne pas savoir évoluer, d’être liés à un mode de vie rural, sans rapport avec le mode de vie urbain, mécanisé et technologique qui a envahi le monde. En somme, de ne pas être modernes.
Ainsi en matière de médecine (médecine qui existait bien avant la découverte et le triomphe des médicaments chimiques) : pratiquer des soins manuels, des bains, des fumigations, boire des tisanes, doser des plantes qu’il faut faire chauffer et prendre à intervalles réguliers au lieu de la pilule miraculeuse qu’on va chercher à la pharmacie, n’est guère moderne et ne s’accorde pas une vie désormais axée sur l’immédiateté du remède et sa facilité d’usage.
Certes, creuser un puits à coup de pioche n’a rien de rapide, ni de facile : un forage est bien plus rapide et plus sûr… Mais qu’en est-il des dommages collatéraux souvent négligés ? Certes, utiliser un panier ou une calebasse pour mettre ses légumes ou ranger ses affaires ne semble guère moderne : un sac plastique, c’est si pratique… mais on sait désormais ce qu’il en est de l’usage des sacs plastiques…
Aujourd’hui, ces savoirs, on les redécouvre, on s’intéresse à eux. Ils sont en train de reprendre leur place dans l’ensemble des savoirs. On découvre qu’ils sont porteurs de valeurs et d’une modernité nouvelle, celle qui n’épuise pas la terre, mais la respecte, celle qui replace l’humain au sein du Vivant et de son territoire.
Pourquoi les redécouvrir aujourd’hui ?
Malgré les développements scientifiques, malgré les technologies rutilantes et triomphantes dont les inconvénients sont enfin mis à jour, le monde moderne est en panne. En deux siècles, la civilisation industrielle a gravement endommagé la terre, les eaux, l’air, les ressources naturelles. Sa technologie toute puissante épuise la planète ; et les terriens ne se sont souciés ni de l’origine ni des conséquences de ce déploiement technologique. Ils sont devenus des mens momentanae selon le terme de Leibnitz, des êtres sans mémoire, sans perspective temporelle autre que mécanique.
Aujourd’hui, la planète, et surtout ses habitants, sont en danger : le changement climatique, la montée des mers, la disparition des espèces (que sont devenus les poissons, les tigres, les éléphants, les abeilles ?), l’appauvrissement et l’érosion des sols, la déforestation massive, l’envahissement du plastique, la disparition des coraux, les menaces sur la mangrove, les pollutions, les déchets, les extractions minières : un doute sur le progrès, sur la science elle-même, sur ses applications s’installe : dans sa course éperdue, la techno science a oublié de prendre en compte les conséquences de ses avancées. Elles ont surgi ; elles sont atterrantes !
La situation est minée par une approche économique hégémonique centrée sur la finance, les profits et les transactions à distance et virtuelles qui ignore les données et les besoins du Vivant. Une approche qui ne fait pas qu’épuiser les ressources naturelles, mais qui crée un monde d’injustices enrichissant les déjà riches et appauvrissant les déjà pauvres. Le développement économique actuel est en train de ruiner la planète et la majorité de ses habitants ; et malgré ses proclamations, il n’a pas réduit les inégalités ; au contraire, il les a creusés davantage.
Un autre élément vient aggraver cette situation : la majorité des humains vit dans des villes, entourés d’artefacts. Et vivre coupé de la nature, c’est comme être coupé de sa matrice, de son origine, de sa mère. Il en découle un sentiment de solitude, une perte de sens, un mal-être. La plupart des humains modernes ressent ce déséquilibre, pour preuve le recours croissant aux médicaments, aux thérapeutes et autres médecins de l’âme et du psychisme.
A cela s’ajoute un doute sur le savoir scientifique classique qui montre ses limites. C’est un savoir abstrait : il théorise avant d’agir. Les ingénieurs conçoivent des projets dans leur tête et transcrivent ces plans sur papier. Ensuite il faudra transposer dans la réalité, appliquer. Ce savoir est souvent trop souvent éloigné des réalités du terrain, des gens et de leurs besoins. Il les méconnaisse. Cela crée un gros déséquilibre entre la théorie et la pratique. Une dissociation, une coupure. Une blessure.
D’autres approches de la réalité semblent donc nécessaires ; d’autres façons de fonctionner. On a besoin d’une approche à la fois intellectuelle et sensible. On a besoin de retrouver la nature, symbole de la mère nourricière universelle, référence incontournable de la vie sur la planète Terre.
Les peuples qui vivent près de la nature nous ont prévenus : nous, peuples modernes, dits civilisés, allons dans le mur. Il est temps d’interroger les savoirs des peuples naturels qui ont gardé ce contact ; des savoirs qui ont su la préserver puisqu’ils nous ont légués des eaux, des terres, de l’air en qualité et en quantité, pratiquant avant la lettre, et sans proclamation, un véritable développement durable.
Retrouver le contact avec la nature, cesser les prédations, créer un partenariat avec tout le Vivant : la nature doit redevenir le modèle et la source de toute vie. C’est la Terre-Mère ancestrale, porteuse, respectée, célébrée : Dunamya (en Swahili), Simamay (en Diola), Mother Earth (dans cultures amérindiennes) Patchamama (dans les cultures andines) Gaïa, pour nous les occidentalisés qui commençons peut-être à comprendre…
Origine de ce changement
C’est à Rio en 1992, au premier Sommet Mondial de la Terre que la capacité des peuples autochtones à préserver la biodiversité a été reconnue et que les droits des populations locales et indigènes sur leurs ressources et leurs savoirs ont été affirmés officiellement.
Depuis, la juridiction internationale n’a cessé de pointer le rôle et l’apport des savoirs et savoir-faire autochtones face aux menaces écologiques, notamment leur capacité de faire face aux changements climatiques. Car le mode de vie des peuples autochtones dépend principalement de leur environnement naturel, souvent vulnérable, ce qui les a amenés à développer des pratiques minutieuses pour faire face aux risques.
La Convention sur le Changement Climatique a par la suite sollicité la contribution des peuples autochtones : ils ont survécu sur des terres vulnérables ; ils ont donc accumulé des connaissances précieuses face aux menaces climatiques et telluriques qu’ils sont les premiers à subir directement étant donné leur dépendance à l’environnement et à ses ressources et à leur relation étroite avec celui-ci. Le changement climatique actuel ne fait qu’exacerber les difficultés qu’ils rencontrent déjà, et depuis longtemps.
A titre d’exemple, en 2008, une session spéciale des Nations Unies à New York a été organisée sur le thème : « Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens d’existence : le rôle de gardien des peuples autochtones et les nouveaux défis à relever ». Le problème est que ces réunions internationales sont assorties de déclarations remarquables, pleines de bonnes intentions, mais qui en restent le plus souvent au stade de la proclamation et ne sont pas suivies d’effets concrets. La plupart du temps, elles demeurent lettres mortes !
Pistes pour le futur
Voici deux exemples de ces savoir-faire autochtones ou technologies traditionnelles qui illustrent et un véritable développement durable et cette nouvelle économie nécessaire à la survie d’une humanité menacée : la fabrication d’un panier en pays Dagara, et le creusement d’un puits.
La fabrication d’un panier en pays Dagara (Le mode de fabrication des paniers est quasiment le même dans toutes les sociétés rurales traditionnelles)

Un objet usuel : Le panier est fabriqué à partir de brins de paille de mil séchés qui viennent des champs du village après qu’on a séparé le grain de la paille. Ces brins de paille sont reliés entre eux, cousus par un fil invisible qui les maintient solidement ensemble. Le socle du panier est carré, son ouverture est ronde. Il est toujours décoré.
C’est un objet utile, d’usage courant, qui répond aux besoins de la vie quotidienne. Il est utilisé par les femmes autant pour ranger que pour transporter sur leur tête les choses du quotidien. Il existe dans toutes les tailles, les plus grands étant d’immenses corbeilles où l’on range les récoltes.
La régularité du tissage des brins confère la solidité de l’assemblage, et la décoration plus ou moins importante selon la destination du panier est aussi un moyen de consolider la structure. C’est un objet caractéristique d’un savoir-faire artisanal traditionnel.
Un modèle écologique : Mais ce panier n’est pas qu’un objet utilitaire ou artisanal, il parle aussi d’écologie : fabriqué avec des tiges de mil qui viennent des champs environnants, le panier dagara casse la dépendance économique liée au transport et aux dépenses d’énergie associées. Il réduit donc à zéro les émissions de CO2 liées au transport.
Modèle écologique aussi car il résout la question des déchets qui s’autogèrent. En effet, quand il est hors d’usage, le panier retourne à la terre qu’il nourrit, rentrant ainsi dans le circuit des énergies renouvelables, celles qui n’épuisent pas la planète, celles qui ne s’épuisent pas, mais se renouvellent et sont à la disposition de tous.
Fabriquer ainsi des contenants avec les résidus des contenus (on y garde principalement le mil après la récolte), laisser ces contenants revenir au sol où ils deviennent nutriments biologiques… quand on sait l’urgence des problèmes liés à la gestion des déchets industriels et ménagers dans les sociétés modernes, ce panier donne à réfléchir sur la dimension écologique dont les savoir-faire traditionnels sont porteurs.
Car il ne s’agit pas pour nous, urbains modernes, de reproduire l’objet tel quel, ou de se mettre à fabriquer et à utiliser des paniers, mais de capter dans le processus mis en œuvre, les éléments d’un modèle écologique, le schème transcendant, capable de s’adapter à nos sociétés modernes.
Modèle écologique qui met en œuvre les véritables principes d’un développement durable : recyclage, auto-fertilité des sols, circuits courts… le panier est un exemple de ce qu’on appelle l’Économie circulaire, où « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ; une méthode de production et de consommation qui se ressource d’elle-même et ne produit pas de déchets.
Un outil de créativité et de cognition : Ce panier illustre encore bien d’autres aspects de connaissance. Il est outil de créativité et outil de cohésion sociale. Le fabriquer est un art qui apprend la coordination des yeux et des mains, la concentration, la patience, le respect. En tressant un panier, on tresse des liens avec lui. Les choses que l’on fait soi-même ont de la valeur. En outre, plus on travaille avec ses mains, plus on développe les capacités du cerveau, ce que confirment les théories les plus récentes des sciences cognitives.
Et quand l’enfant s’assoit à côté de sa grand-mère ou de son grand-père, et les regarde tisser les brins de mil, il n’apprend pas seulement à fabriquer un panier, c’est un art de vivre qui lui est transmis en même temps qu’un héritage culturel indestructible, l’art de vivre ensemble.
Un objet vertueux porteur d’une vision éthique : Fabriquer un tel objet, c’est comme construire sa maison avec la terre qu’il y a autour, ou, comme pour la calebasse, utiliser les courges de son jardin pour faire des cuillères ou des instruments de musique.
Ce savoir-faire capable produire des objets usuels rentrant dans un processus créatif de recyclage en accord avec le processus naturel du vivant, signe un mode de relation équitable avec la Terre, avec les cycles de la nature, il signe un mode de relation vertueux avec le monde en décalage, en décoïncidence avec les paramètres en usage dans les sociétés industrielles.
Un objet de nature et un objet de culture : Un tel mode de relation avec le monde indique une culture naturelle. Cette culture est d’une grande et nouvelle modernité qui décolle d’avec la notion convenue de modernité. Objet de nature médiatisé par un savoir-faire vertueux, le panier dagara est porteur d’un statut d’objet culturel participant à une science du concret.
Un modèle de science concrète : Mais ce panier a encore d’’autres secrets à livrer. S’il est porteur d’une vision du monde éthique et équitable qui témoigne d’un mode de vie sobre et vertueux, il participe pleinement de cette science concrète dont a parlé Lévi-Strauss, et qui a réhabilité la pensée sauvage des peuples naturels. En effet, ce panier indique une connaissance intuitive de la dynamique des formes, une connaissance mathématique.
Quelque chose m’avait frappée quand j’avais vu une femme y verser du mil ; plus elle le remplissait, plus il semblait contenir. Comment était-ce possible ? L’agencement des brins, qui partant d’une base carrée s’épanouissent en une ouverture circulaire me fournit la réponse. En effet, depuis ses quatre angles d’appui, le panier se projette en une dynamique de forces qui composent le cercle de l’ouverture. Il se présente alors comme l’application et la mise en œuvre d’un principe mathématique originel et sacré qui se serait transmis et perpétué à travers les gestes des villageois dagara ; un principe de même nature que l’arc en ogive des cathédrales, la structure du mandala ou la construction des pyramides.
Ce secret antique prend place dans l’acte continu de création qui, depuis l’origine des temps, préside à la continuité des formes. C’est comme si à travers ce panier, les Dagara avaient résolu la quadrature du cercle, utilisant une connaissance extraordinaire pour fabriquer des paniers ordinaires nécessaires à la vie de tous les jours.
Un symbole : Ce panier n’est donc pas seulement un objet utile, un objet éthique, une technologie adaptée aux nécessités des travaux et des jours, un modèle scientifique : à la fois un objet usuel et un objet culturel, il est un symbole, et en tant que symbole, il est indicateur de transcendance.
Chaque femme du village qui l’utilise ne porte pas seulement sur la tête un panier, elle porte aussi une représentation symbolique, l’image du monde telle qu’elle s’est transmise à travers le temps chez le peuple dagara grâce à l’art du tressage des tiges de mil.
Le creusement d’un puits
 Dans le savoir académique, quand on évoque l’eau, une formule surgit : H20 ! C’est vite dit. Ce savoir-là ne dit pas grand-chose de l’eau. Il reste abstrait. C’est un savoir hors sol. La ressource est objectivée, moléculisée. Elle sera donc perçue principalement comme objet de consommation. Savoir abstrait et purement utilitaire.
Dans le savoir académique, quand on évoque l’eau, une formule surgit : H20 ! C’est vite dit. Ce savoir-là ne dit pas grand-chose de l’eau. Il reste abstrait. C’est un savoir hors sol. La ressource est objectivée, moléculisée. Elle sera donc perçue principalement comme objet de consommation. Savoir abstrait et purement utilitaire.
Pour la connaître, pour l’apprécier, surtout pour la préserver, peut-être faut-il approcher l’eau autrement… La technique traditionnelle du creusement d’un puits est l’une de ces approches : creuser un puits pour fournir l’eau à quelques habitations éloignées d’un village ou en pleine brousse, est certes une rude et pénible affaire. Un forage est évidemment plus rapide et plus efficace, mais cela coûte cher, donc peu accessible à des villageois. Et même si cela se peut, la méthode n’est pas sans danger, même si elle est rapide. Pas seulement onéreuse, pas seulement violente pour la terre, mais la mécanisation du processus met de la distance entre les utilisateurs et l’eau. La ressource s’en trouve à la fois déconsidérée et banalisée.
Faire creuser un puits par des puisatiers du coin, ou s’y mettre entre voisins, c’est procéder autrement ; de façon traditionnelle, dira-t-on. L’entreprise est pénible, elle prend du temps, mais ces efforts fournis, ce temps à espérer que l’eau surgisse, donne valeur à la ressource. Obtenir ainsi l’eau fait partie d’une vision du monde où l’accès aux ressources naturelles se mérite ; où il est raisonné : il ouvre en effet de multiples embranchements qui donnent un rapport au monde foisonnant où travail, processivité, savoirs et savoir-faire coexistent, incluant aussi une démarche participative.
Car si le puisatier est aux commandes, autour du creusement, les intéressés sont présents, en attente, observant attentivement la progression des travaux, parlant de l’eau, de la terre, des besoins à satisfaire, de la vie que l’on mène…
Quant au travail du puisatier, il manifeste une connaissance concrète et multiple : connaissance de l’eau et de son écosystème, de son cheminement sous la terre, du sous-sol, du terrain, de l’habitat, des usages concernant le foncier, des variations météorologiques. Son laboratoire, c’est l’eau et le chemin souterrain de l’eau. Il fait travailler ses mains, sa tête et sa sensibilité : creuser un puits illustre un savoir complexe et interactif, une technique adaptée, c’est un exemple parmi beaucoup d’autres de cette science concrète qu’a mis en évidence Claude Lévi Strauss.
Le puisatier creuse. 15 mètres, 18, parfois 20, parfois plus… L’eau n’est pas loin Le puisatier la sent. Une humidité monte du sol. L’eau est là toute proche… Attente fébrile de l’assistance là-haut, penchée vers le fond. Soudain, en bas, le puisatier s’arrête de creuser, pose sa pioche ; son aide fait de même. « Mais enfin, pourquoi t’arrêtes-tu ? » « L’eau est là, on la sent, mais impossible de continuer ». « Pourquoi ? » « Les génies de l’eau ont parlé. Ils veulent un sacrifice ». Protestations des villageois réunis en haut du trou profond. Mais protestations molles : ils savent bien qu’il faudra en passer par là. Le rituel du sacrifice, c’est culturel, c’est respecter la loi de l’échange, exprimée en Afrique par ce qu’on appelle si joliment, le rendez-vous du donner et du recevoir.
Commence la négociation : « que veulent les génies ? » « Une vache » Protestations véhémentes. « Impossible, c’est trop cher pour nous ». On propose un poulet. Le puisatier est outré de la proposition : « Les génies refusent. C’est trop petit comme sacrifice ». Concertation en haut du puits. Finalement on se met d’accord pour une chèvre, et c’est un chevreau qui fera l’affaire. Il sera sacrifié sur la margelle, et sa chair partagée entre tous. Les génies seront servis en premier. Après le rituel du sacrifice, l’eau surgira et abreuvera terre et vivants.
A y réfléchir, ce rituel lié aux génies n’est pas qu’une pratique magique issue d’un autre temps. Riche d’une symbolique mêlant nature et culture, il est porteur d’une rationalité éthique, et il est fortement opérationnel. Il rappelle que l’eau est précieuse, qu’elle fait partie d’un processus d’échange, que la nature n’appartient pas aux humains, mais que ce sont les humains qui appartiennent à la nature. Il est bon de se rappeler qu’il n’est pas de symétrie entre la nature et les humains : ce sont les humains qui ont besoin de l’eau, l’eau n’a pas besoin d’eux… Idem pour les arbres, le sol, les nuages, les fleurs, les abeilles… Il faudrait vraiment se rappeler cela et en tirer les conséquences. Les villageois et les anciens peuples le faisaient d’instinct : à travers ses génies ou autres « esprits », la nature appelle au respect, aux égards. En retour, elle assure protection et sauvegarde des ressources (ainsi le génie ancestral des mangroves dans la région de Joal dans le sine saloun au Sénégal interdisait de couper les mangroves. Aujourd’hui, cette croyance disparue, les mangroves, ces écosystèmes précieux à plus d’un titre, sont gravement menacées).
Retour au puits : bien sûr, chez les Modernes, vont surgir les jugements : la croyance dans les génies des eaux ou dans les génies des mangroves, ou dans le pouvoir des plantes guérisseuses, c’est vraiment dépassé, irrationnel… D’autres diront, c’est culturel ; d’autres encore que c’est mystique…
Mais au-delà de ces déterminations aliénantes, ce qui se révèle à travers ce rituel mettant en scène les génies de l’eau et des habitants en demande d’eau, ce sont des zones de la réalité totalement niées par la science. Des zones du Vivant qui aujourd’hui se révèlent et revendiquent : Gaïa, notre Terre, à sa façon, réclame l’attention des humains. Ces zones de la réalité, le puisatier les connaît d’instinct. Les villageois aussi les perçoivent et les respectent. Ils ont cette connaissance sensible des anciens peuples : le puisatier sent l’eau même s’il ne la voit pas. Il sait qu’il y a un seuil à franchir pour obtenir l’eau et qu’il passe par un octroi. L’eau est octroyée aux humains, mais elle a un prix, non pas financier, mais un prix culturel symbolique, qui fait lien dans la communauté entre la Terre et ses habitants. Accéder ainsi à l’eau, c’est concrétiser ce qu’on appelle une culture, ce fonds d’entente qui unit les personnes à leur territoire et donne spécificité à un mode de vie. C’est construire du commun.
Cette connaissance instinctive qu’on pourra qualifier (ou disqualifier) de magique ou de croyance relève non seulement du sensible, mais de l’extra sensible. Ces aspects du réel échappent à la science classique analytique comme à la techno science, mais ces aspects ont été repérés et légitimés par cette nouvelle science, la quantique, qui y voit à l’œuvre une synchronicité énergétique. (C’est ce qui rendrait opératoire et justifierait les incantations qui accompagnent certains protocoles thérapeutiques, les rituels ou préparatifs de chasse, ou de pêche, ou tout simplement les incantations associées aux cueillettes des plantes médicinales).
Dans la vision quantique, les notions de matière et d’esprit interfèrent dans une dynamique énergétique qui a stupéfait les grands savants découvreurs de cette réalité. Carl Boehm, un des grands physiciens du siècle dernier disait : « Les électrons observent et réagissent instantanément à toutes les modifications de leur milieu, et celui-ci s’étend à l’univers entier ». Einstein constatait : « L’univers est une grande conscience ».
La conscience n’est donc pas l’apanage des humains : il y a une conscience végétale, une conscience minérale, animale, sans doute aussi une conscience virale, et les porteurs des savoirs autochtones le savaient et le ressentaient ; mais nous, les humains modernes, nous nous croyons toujours d’une essence supérieure à ce qui nous a précédés. Et croire cela, empêche d’explorer et de connaître ce qui arrive et ne cesse d’arriver, et que nous pensons toujours devoir ou savoir expliquer.
Cette dimension intuitive, supra sensible, magique des choses et du savoir sur les choses qui nous entourent, qui caractérise le savoir autochtone et les savoir-faire traditionnels, les modernes civilisés l’ont perdue. Elle est essentielle car elle ouvre un monde où la réalité dépasse les apparences ; un monde où le rapport aux choses n’a pas qu’une fonction utilitaire, où il a une valeur affective et spirituelle, et de ce fait, est porteur de réconfort.
Ces savoirs traditionnels autochtones – et ils sont nombreux et partagés par de nombreuses populations sur la planète – sont donc de précieux enseignements à intégrer, à transmettre et à adapter à un monde civilisé en plein désarroi. C’est un cadeau de nature et de culture proposé aux Terrestres Modernes qui cherchent désespérément une solution pour survivre.
Nous, Modernes urbanisés, occidentaux ou occidentalisés, nous croyons que le bonheur est dans la jouissance des choses, mais nous avons oublié qu’il est aussi dans la perception de leur reflet dans l’invisible. C’est pourquoi, pour les humains d’aujourd’hui et pour ceux de demain, ce panier, ou ce mode d’accès à l’eau par creusement d’un puits, peut être un enseignement d’une grande richesse pour le nouveau savoir vivre qui cherche ses marques. Là aussi est leur modernité. Car chez les peuples naturels, avait dit, lors de sa venue à Genève, le grand chef indien Ho DE NO SE, « la culture n’est pas une marchandise, c’est un mode de vie ».
Marie Joséphine Grojean, Journaliste Nature et Écologie – Ecrivaine – Membre de l’Académie de l’Eau
Source : Encyclopédie du Développement Durable
Bibliographie
BATESON Gregory : La Nature et la pensée. Esprit et nature, une unité nécessaire. Le Seuil, 1979, 1990.
BROWAEYS Louise et PAZZIS Henri de : La Part de la Terre. L’agriculture comme art. Delachaux et Niestlé, 2014.
CASALIS Eugène : Les Bassoutos. Société des Missions Évangéliques, 1860.
COLLECTIF : Les Savoirs naturalistes populaires. Actes du séminaire de Sommières (1983). Maison des Sciences de l’Homme, 1985.
COLLECTIF : Plantes, sociétés, savoirs, symboles. Actes du séminaire de Salagon. Les Alpes de Lumière, 2003.
DESCOLA Philippe : Par-delà nature et culture. Gallimard, 2005, 2015.
DEWEY John : Expérience et nature. 1925. Gallimard, 2012.
EMOTO Masaru : Les Messages cachés de l’eau. Éditions Trédaniel, 2001.
GASCAR Pierre : Le Présage. Gallimard, L’Imaginaire, 1972.
GRIAULE Marcel : Dieu d’eau : Entretiens avec Ogotommêli. Fayard, 1948, 1991.
HONORÉ Carl : Éloge de la lenteur. Marabout, 2005, 2021.
ILLICH Ivan : La Convivialité. Seuil. Essais. 2014.
JAVARY Cyrille J.-D. : Le Discours de la tortue. Découvrir la pensée chinoise au fil du YI Jing. Albin Michel, 2003.
JULLIEN François : Altérités. Essai. Gallimard, Folio, 2021.
KOTHARI Ashish et SALLEH Ariel : Plurivers. Un dictionnaire du post-développement. Éditions Wildproject, 2022.
LATOUR Bruno : Face à Gaïa. La Découverte, 2015.
LEROI-GOURHAN André : L’Homme et la matière. Albin Michel, 1943, 1971.
LEROI-GOURHAN André : Milieu et techniques. Albin Michel, 1945, 1973.
LOVELOCK James : La terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa. Flammarion 1999.
MACY Joanna et YOUNG BROWN Molly : Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre. Revenir à la vie. Le Souffle d’Or, 2018, 2021.
MENON Pierre-Louis et LECOTTÉ Roger : Au village de France. Les traditions, les travaux, les fêtes. Bartillat, 1993.
MÜLLER Klaus E. : Afrique – la magie dans l’âme. Rites, charmes et sorcellerie. Könemann, 2000.
PARÈS Yvette : La Médecine africaine, une efficacité étonnante. Yves Michel, 2004.
POSTEL Sandra : La Dernière oasis, l’eau en danger. The Worldwatch Institute, 1992.
PRIGOGINE Ilya et STENGERS Isabelle : La Nouvelle alliance. Métamorphose de la science. Gallimard, Folio essais, 1979, 1986.
ROMILLY Jacqueline de : Le Trésor des savoirs oubliés. Éditions de Fallois, 1998.
SAFRANSKI Rüdiger : Quelle dose de mondialisation l’Homme peut-il supporter ? Actes Sud, 2005.
SANSOT Pierre : Du bon usage de la lenteur. Payot et Rivages, 2000.
SEARLES Harold : L’Environnement non humain. Gallimard, Tel, 1960.
STENGERS Isabelle : Réactiver le sens commun. Lecture de Whitehead en temps de débâcle. La Découverte, 2020.
STENGERS Isabelle : Résister au désastre. Dialogue avec Marin Schaffner. Wildproject, 2019.
VARAGNAC André : Civilisation traditionnelle et genres de vie. Albin Michel, 1948.
VARELA Francisco J. : Quel savoir pour l’éthique ? La Découverte, 1996.
VELTER André et LAMOTHE Marie-José : Le Livre de l’outil. Denoël-Gonthier, 1970. Messidor, 1983. Phébus, 2003.
VINCENOT Henri : Les Étoiles de Compostelle. Gallimard, Folio, 1987.
VINOKUR Annie : Transformations économiques et accès aux savoirs en Afrique subsaharienne. Acteurs éducatifs africains, reproduction sociale et relations internationales. UNESCO, Dakar, 1993.
VIVEROS DE CASTRO Edouardo : Le Regard du jaguar. Introduction au perspectivisme amérindien. Traduit par Pierre Delgado. Éditions la Tempête, 2021.
Image d’en-tête : La vannerie, savoir-faire ancestral par excellence – Photo ©Festival de la vannerie et du patrimoine à la Chapelle-des-marais (44)
Première publication dans UP’ Magazine : 18/10/22