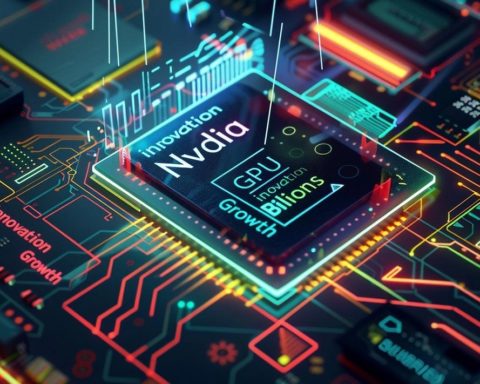Comme chaque printemps, avec la publication des documents de référence des entreprises cotées, la rémunération des grands patrons suscite des réactions indignées. Cette année, c’est la rétribution des dirigeants de l’industrie automobile qui monopolise l’attention. Alors que Carlos Ghosn, en tant que PDG de Renault, a reçu 7,25 millions d’euros en 2015 (dont 4,18 millions en stock options), Carlos Tavares, président du directoire de PSA Peugeot Citroën, a totalisé un gain de 5,24 millions d’euros (dont 2 millions en « actions de performance »).
La CGT a dénoncé des rémunérations « complètement indécentes », la CFDT a estimé que la rémunération de Carlos Tavares n’était « pas légitime », alors que Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, a déclaré qu’elle était « dommageable ». Les deux représentants de l’État au conseil de surveillance de PSA ont d’ailleurs voté contre ce montant. De son côté, Pierre Gattaz, président du Medef, a souligné : « Quand il y a de la réussite, ça ne me choque pas qu’on récompense la réussite ».
L’inflation des rémunérations : du bon management ?
La question de savoir s’il faut récompenser financièrement la réussite, même si elle est largement débattue en psychologie depuis les travaux fondateurs d’Edward Deci, n’est pas ce qui est en jeu ici. Ce qui choque, c’est le niveau de cette récompense. Comment peut-on l’expliquer ? Est-ce une pratique pertinente en termes de management ?
Il faut tout d’abord souligner que la rémunération de Carlos Tavares est significativement inférieure à celle de ses alter egos. Comme on l’a vu, le PDG de Renault gagne 38 % de plus que lui (sans compter ce qu’il gagne comme patron de Nissan). De même, les dirigeants des autres constructeurs automobiles occidentaux ont tous des rémunérations supérieures à celles de Carlos Tavares : 6,2 millions d’euros pour le patron de BMW, 6,5 millions d’euros pour celui d’Audi, 8,4 millions d’euros pour celui de Mercedes, 10,9 millions de dollars pour celui de Fiat Chrysler, 16 millions de dollars pour celle de GM et 18,5 millions de dollars pour celui de Ford. Au total, c’est donc la rémunération des grands patrons en général, et non celle de Carlos Tavares en particulier, qui pose question.
En moyenne, selon le syndicat AFL-CIO, le dirigeant d’une des 500 plus grosses entreprises américaines a gagné en 2015 373 fois le salaire de ses salariés les moins qualifiés. Cela veut dire qu’il gagne plus en un seul jour que ses salariés en toute une année. En France, l’écart est moins élevé, mais il est tout de même de 1 à 100 entre le montant du Smic et la rémunération moyenne des PDG du CAC 40. Or, si le niveau absolu de cet écart peut légitimement choquer, c’est bien son évolution au cours des dernières décennies qui constitue le phénomène le plus surprenant.
En effet, cet écart n’était que de 1 à 20 aux États-Unis en 1965. C’était d’ailleurs l’écart maximal de rémunération que recommandait au début du XXe siècle le célèbre banquier J.P. Morgan, peu réputé pour son militantisme égalitaire. L’écart est ensuite monté à 1 à 30 en 1978, à 1 à 60 en 1990, à 1 à 300 en 2000 et donc à 1 à 373 en 2015. L’écart entre la rémunération des patrons et celle des salariés les moins qualifiés a ainsi été multiplié par environ 20 en 50 ans. Qu’est-ce qui peut expliquer une telle inflation ? Ce n’est certainement pas un accroissement proportionnel du talent et des responsabilités des grands patrons : quel que soit l’indicateur choisi, rien n’indique que la performance des dirigeants (et des entreprises qu’ils dirigent) a été multipliée par 20 depuis les années 1960.
Consanguinité des conseils d’administration
En fait, l’explosion de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées s’explique par la conjonction de deux effets pervers. Le premier de ces effets est la consanguinité des conseils d’administration et des conseils de surveillance, connue en France sous le doux nom de « barbichette », en référence à la comptine « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », qui devient : « tu es membre de mon conseil, tu votes ma rémunération, je suis membre de ton conseil, je vote ta rémunération ».
Pour légitimer la rémunération des dirigeants, certains affirment qu’il existerait un « marché » des talents, et que les rémunérations, quelque exubérantes qu’elles soient, correspondraient au « prix de marché » des compétences. Or, si un tel marché existe pour les dirigeants des grands groupes, ce n’est certainement pas un marché libre et le prix n’y est certainement pas une mesure objective de la valeur. En effet, les conseils d’administration des groupes cotés sont souvent composés d’individus qui sont eux-mêmes dirigeants, et qui siègent souvent dans plusieurs autres conseils.
Il existe donc une forme de connivence plus ou moins affichée entre les dirigeants et ceux qui évaluent leur action et décident de leur rémunération. Cette situation n’est d’ailleurs pas spécifique au capitalisme français (même si les collusions entre anciens des mêmes grandes écoles et des mêmes grands corps ont tendance à la renforcer), puisqu’on la retrouve par exemple aux États-Unis. À cet égard, le site theyrule.net, même s’il mérite une actualisation, est particulièrement instructif.
On peut ainsi expliquer le niveau de rémunération des grands patrons par le fait qu’ils se l’attribuent eux-mêmes, au travers de leurs administrateurs, avec lesquels ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes réseaux. Cependant, si ce phénomène peut permettre de comprendre le montant des rémunérations, il n’explique pas leur multiplication par 20 en 50 ans. En effet, l’endogamie des instances de pouvoir est vieille comme le monde, et rien n’indique qu’elle soit pire aujourd’hui qu’elle ne l’était hier.
L’effet pervers de la publication des rémunérations
Pour expliquer l’explosion de la rémunération des dirigeants, il faut donc invoquer un deuxième effet pervers, bien plus redoutable car largement contre-intuitif. C’est à partir des années 1990 que la réglementation a peu à peu imposé une révélation des niveaux de rémunération des dirigeants des entreprises cotées. Aux États-Unis, cela a pris la forme d’une nouvelle règle édictée par la Securities and Exchange Commission (SEC) en 1992. En France, c’est la loi NRE du 15 mai 2001, revue par la loi de Sécurité financière du 1er août 2003 qui a fixé ce cadre. Dans les deux cas, l’objectif était le même : mieux informer les actionnaires sur les rémunérations des dirigeants, avec l’hypothèse sous-jacente que si ces rémunérations devenaient publiques, elles resteraient contenues. Or, paradoxalement, c’est exactement l’inverse qui s’est produit : c’est la publication des rémunérations qui a provoqué leur inflation.
En effet, dès lors que la rémunération est publique, elle devient une mesure de la valeur des dirigeants et donc un enjeu. Tant qu’elle était secrète, elle ne permettait pas de comparer les individus et restait donc une question purement privée. Devenue publique, elle s’impose comme l’étalon de leur talent. Lorsqu’une société cotée nomme un nouveau dirigeant et qu’elle décide de le payer moins que son prédécesseur, tout le monde le sait, et on va en déduire qu’il n’est pas aussi capable que celui qu’il remplace. De même, si le dirigeant d’une entreprise est moins payé que la moyenne de son industrie, tout le monde le sait, et on va en déduire qu’il n’est pas parmi les plus talentueux.
Pour reprendre l’exemple de l’industrie automobile, le fait que Carlos Ghosn gagne 38 % de plus que Carlos Tavares peut être interprété comme une hiérarchie de leur valeur. Ce souci de comparaison est d’ailleurs d’autant plus vif entre des individus qui ont été sélectionnés sur leur capacité à réussir des concours extrêmement élitistes. Entre le polytechnicien Carlos Ghosn et le centralien Carlos Tavares, l’esprit de compétition reste aigu : le premier de la classe n’est plus celui qui décroche les meilleures notes ou qui réussit le meilleur concours, mais celui qui touche le plus gros salaire.
C’est parce que les rémunérations sont publiques que tous les dirigeants cherchent à gagner plus que la moyenne et que tous les conseils d’administration ne cessent de mieux les payer. En effet, un administrateur qui douterait publiquement de la compétence du dirigeant provoquerait un effondrement du prix de l’action. Réciproquement, pour influencer positivement la valeur actionnariale, un conseil d’administration a intérêt à donner tous les signes les plus patents, les plus mesurables et les plus visibles de l’extrême confiance qu’il a dans le talent exceptionnel du dirigeant : c’est ce qu’il fait en décidant de l’augmenter. Par conséquent, une fois publique, la rémunération des dirigeants est instrumentalisée. Elle devient à la fois un outil de mesure et un mécanisme d’influence.
Le phénomène d’instrumentalisation de la moyenne est connu aux États-Unis sous le nom de « Lake Wobegon effect », du nom de la ville fictive de Lake Wobegon, où comme le veut la légende « toutes les femmes sont fortes, tous les hommes sont beaux et tous les enfants sont au-dessus de la moyenne ». S’il est impossible que tout le monde soit meilleur que la moyenne, le fait que chacun cherche à l’être provoque son inflation.
On peut d’ailleurs remarquer que cet effet n’est pas spécifique aux dirigeants des grandes entreprises. Il permet d’expliquer tout aussi bien l’augmentation des rémunérations des stars de cinéma ou celle des grands sportifs : lorsque Leonardo DiCaprio apprend que Johnny Depp gagne plus que lui, il est tenté de réclamer de plus gros cachets. De même, si Fernando Alonso constate qu’il gagne moins que Lewis Hamilton, il est probable qu’il renégocie son contrat.
Une solution simple pour une anomalie récente
Que retenir de tout cela ? Au regard de l’histoire, l’explosion des rémunérations des patrons des grandes entreprises est une anomalie, et c’est une anomalie récente (Thomas Piketty condamne à ce propos un « extrémisme méritocratique »). D’un point de vue managérial, les niveaux actuels de rémunération ne se justifient pas, car pendant longtemps les entreprises ont été très bien dirigées sans que leurs patrons ne soient aussi grassement payés. De plus, de tels écarts de rémunération provoquent un profond sentiment d’iniquité, au risque d’une démotivation générale, bien plus préjudiciable à la performance des entreprises qu’une très hypothétique érosion du talent des dirigeants. Comme le dit avec malice Warren Buffet :
Quand un dirigeant avec une réputation d’excellence rencontre une industrie avec une réputation de difficulté, c’est généralement l’industrie qui conserve sa réputation.
Par conséquent, si nous voulons mettre fin à cette anomalie historique qu’est l’explosion des rémunérations des grands patrons (ou celle des stars de cinéma et des champions sportifs), la conclusion qui s’impose est limpide : il faut rendre ces rémunérations secrètes. Dès lors qu’elles seront secrètes, les rémunérations cesseront d’être une mesure de la valeur des individus, et donc d’être un enjeu. Bien entendu, rien ne dit qu’en devenant confidentielles, les rémunérations redescendront à des niveaux plus raisonnables (pour cela, il faudrait que la loi l’impose ou que les actionnaires l’exigent), mais a minima elles auront moins de raisons d’augmenter.
Reste un obstacle de taille : on voit mal comment l’opinion, scandalisée par les niveaux actuels de ces rémunérations, pourrait accepter qu’on décide de les cacher. J’invite nos lecteurs les plus pédagogues à résoudre cet épineux problème.
Frédéric Fréry, Professeur de stratégie, ESCP Europe
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.