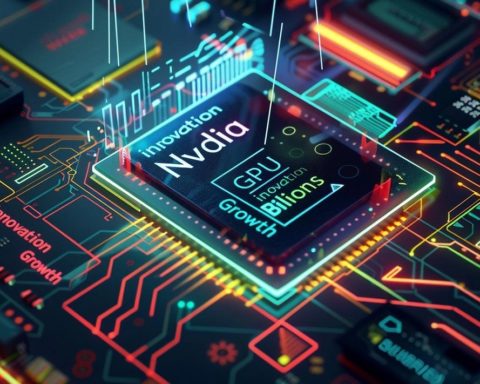« Le tissu économique français souffre, encore et toujours, de la préférence pour les grandes entreprises, dont le modèle organisationnel est pourtant clairement un échec ». C’est l’analyse du prospectiviste André-Yves Portnoff, qui propose dans cet article cinq idées urgentes de réforme.
Illustration : Peinture « Aveuglement volontaire » de Antony Squizzato – Toile huile 2014
Gagner la bataille de l’emploi est humainement, politiquement vital. Mais aucun candidat à la présidence n’assume encore trois faits majeurs.
Première évidence, la désindustrialisation de la France, destructrice de millions d’emplois et présentée comme une fatalité, résulte en réalité du choix d’élites qui croient l’industrie ringarde à l’ère des services.
Deuxième évidence, cessons d’entraver ceux qui créent l’emploi et de soutenir ceux qui le sapent. La croissance des PME génère l’emploi, les grands groupes le détruisent. L’Europe ne crée quasiment plus de leaders mondiaux, les PME innovantes ne réussissant pas, sauf en Allemagne, à dépasser les 500 salariés sans se faire absorber ou « tuer ».
Après les Mozart, ce sont les Zuckerberg français qu’on assassine. Jamais autant de nos PME n’ont été rachetées par des concurrents américains ou asiatiques. Autant de cadeaux financés par nos impôts. Malgré ces faits (mé)connus, nos gouvernements successifs offrent près de 75 % des aides publiques en recherche et développement (R&D) et innovation à « un petit nombre de grands groupes non représentatifs du potentiel français », lit-on déjà dans un rapport ministériel de juillet…1987.
Troisième évidence, pour une économie compétitive, il faut assainir nos grandes organisations publiques et privées. Leur structure en silos cache aux directions la réalité complexe des problèmes, bloque les coopérations, dégrade l’intelligence collective. Un management taylorien stresse les acteurs opérationnels, dissuade les talents, gâche l’expérience de terrain. En pressurant les sous-traitants, on réduit résilience et créativité.
Tout cela empêche de bien exploiter le numérique. On réclame des aides pour que notre industrie comble son déficit en robots, comme il y a trente ans on excusait notre défaut de productivité en affirmant que Toyota utilisait beaucoup plus de robots que ses concurrents. L’expert en management Hervé Sérieyx révéla au contraire que non seulement Toyota avait moins de robots, mais ne transformait pas ses salariés en robots. Toyota s’est hissé au premier rang mondial en inventant le toyotisme, qui valorise le talent de chacun.
Par appât du gain immédiat, on a préféré en Occident la « taylorique », c’est-à-dire le taylorisme plus la productique. Pourtant, pléthore d’études prouvent que c’est la financiarisation et la formation des élites qui, en induisant un management par la méfiance et le mépris, dégradent la compétitivité en Occident. Nos politiques ne peuvent plus rester aveugles.
Voici donc cinq propositions de mesures pour un programme présidentiel qui tiendrait compte de ces évidences.
La première mesure ne coûterait rien au contribuable et aurait un effet rapide sur la croissance : sur le modèle du « Small Business Act » (SBA) américain de 1953, Etat et régions réserveraient un cinquième des marchés publics aux PME et ETI indépendantes. L’idée a été proposée par François Bayrou en 2007, reprise par le candidat Nicolas Sarkozy, mais vite abandonnée, car bloquée à Bruxelles par les bureaucrates, les néolibéraux et les lobbies. Un SBA reste possible et nécessaire en France. Le corollaire serait que l’Etat devienne exemplaire comme donneur d’ordre en simplifiant drastiquement les procédures d’accès aux marchés publics.
La deuxième mesure réorienterait vers les PME et les ETI les aides à la recherche et l’innovation, particulièrement le crédit impôt recherche (CIR) qui, au départ, encourageait l’accroissement des efforts des PME. Sa modification en 2008 par le gouvernement de François Fillon a offert 1,4 milliard d’euros supplémentaires aux grosses entreprises. François Hollande, candidat, a qualifié cela d’effet d’aubaine et a promis d’y remédier. Devenu président, il y a renoncé. En résistant aux chantages et en recentrant le CIR sur son objectif initial, l’Etat récupérerait des recettes pour aider les PME.
Un troisième ensemble de mesures soutiendrait le développement des entreprises visant le long terme, notamment familiales, coopératives ou à racines fortes dans le territoire, et privilégiant la coopération loyale et durable avec leurs parties prenantes – salariés, sous-traitants, territoires, concurrents. Elles sont plus résilientes et créent plus de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Le corollaire serait d’exclure de toute aide les grandes entreprises qui abusent de leur position pour agir de façon contre-productive envers leurs fournisseurs et leurs salariés.
La quatrième mesure concernerait le secteur public. La compétitivité dépendant, on l’a dit, de la qualité des relations internes et externes avec les parties prenantes, que l’Etat, premier employeur du pays, donne l’exemple ! Un management par le sens redynamiserait les personnels.
Le problème n’est pas de réduire le nombre de fonctionnaires, mais de leur permettre de produire ensemble plus de valeur pour le bien commun. Le corollaire serait que l’Etat place à la tête des établissements publics des personnalités choisies pour leurs aptitudes à écouter et mobiliser, au lieu de caser les anciens membres des cabinets ministériels.
La cinquième mesure concerne la méthode de la réforme. Les organisations, pas plus que la société, ne se réforment par décret. Agissons au niveau des pratiques quotidiennes. Généralisons une méthode de créativité éprouvée, l’analyse de la valeur. Elle contraint à la transparence des objectifs qui doivent être spécifiés, elle soumet les solutions pour les atteindre à une libre critique des fonctions concernées, en amont et en aval.
D’où moins de buts inavoués, plus de créativité, de spectaculaires économies, une qualité de services améliorée. Cette généralisation permettrait une vraie simplification administrative. Un manifeste de 800 experts et entrepreneurs l’avait en vain réclamé en 2014. L’année précédente, le président Obama l’avait imposée à son administration. Mais là-bas, le président lui-même savait ce qu’était le « value management ». Ce n’est pas encore le cas en France !
André-Yves Portnoff, Conseiller scientifique de Futuribles international et professeur à la Haute école de gestion de Fribourg (HEG), Suisse
Avec l’aimable autorisation de l’auteur
Article initialement publié dans le Monde du 8 avril 2017
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents
Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments