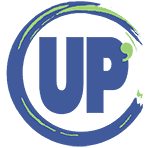Le 8 avril 2025, les députés ont entamé l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, un texte déjà adopté par le Sénat et présenté comme un moyen de « faciliter la vie des entreprises ». Mais derrière cet objectif affiché, se cache une série de mesures aux conséquences potentiellement graves pour l’environnement, la démocratie participative et la lutte contre le changement climatique.
Ce projet de loi s’inscrit dans une volonté gouvernementale de réduire les contraintes administratives pesant sur les acteurs économiques, en particulier industriels. Il entend notamment raccourcir les délais d’instruction des projets, simplifier les démarches d’autorisation, et alléger certaines obligations réglementaires. Or plusieurs de ses articles touchent directement aux dispositifs de protection de la nature, à la participation citoyenne et à l’évaluation des impacts environnementaux.
Derrière la « simplification », un recul assumé des exigences écologiques
Le texte prévoit notamment :
- Une présomption automatique de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) pour un grand nombre de projets industriels. Cette disposition permettrait de justifier plus facilement des dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, sans réelle exigence de démonstration, affaiblissant ainsi une barrière juridique essentielle à la protection de la biodiversité.
- L’affaiblissement du principe de « zéro perte nette de biodiversité », inscrit dans la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016. L’article 18 du projet reporte les mesures de compensation écologique, remettant en cause le principe fondamental de « séquence ERC » (éviter, réduire, compenser), qui visait à encadrer strictement l’impact des projets sur les milieux naturels.
- La suppression de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, qui visait à diviser par deux l’artificialisation nette des terres d’ici à 2031, conformément à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Le texte envisage d’exempter certaines infrastructures industrielles de cet objectif, alors même que l’artificialisation constitue l’une des principales causes de perte de biodiversité et d’aggravation du dérèglement climatique.
- La disparition des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), qui jouent pourtant un rôle clé dans l’analyse indépendante et la formulation d’avis sur les projets de développement régionaux, en intégrant les enjeux économiques, sociaux et écologiques.
- Une révision des modalités de consultation publique, réduisant le champ et les conditions de la participation citoyenne autour des projets industriels. Cette mesure contrevient à l’esprit de la Convention d’Aarhus, signée par la France, qui garantit l’accès à l’information environnementale et le droit de participation du public aux décisions ayant un impact écologique.
Un choix politique à contre-courant des urgences climatiques et écologiques
À un moment où les rapports scientifiques sur l’état de la biodiversité et le changement climatique se multiplient et alertent sur l’urgence d’agir, ce projet de loi acte un net recul de l’ambition écologique de la France. Plutôt que de renforcer les garde-fous environnementaux, il en affaiblit les piliers au nom d’une logique de compétitivité économique à court terme.
Comme le souligne Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) : « La France continue d’enchaîner les régressions environnementales et d’affaiblir ses outils de protection de la nature à un moment où ces derniers devraient, au contraire, être urgemment renforcés. Face à l’effondrement de la biodiversité et au réchauffement climatique, sacrifier les écosystèmes au nom d’une prétendue efficacité administrative est irresponsable. Simplifier ne signifie pas saccager. »
La Nature ne fonctionne pas selon les logiques de productivité, de rendement ou d’optimisation économique et ne peut être soumise aux mêmes règles et logiques économiques que celles gouvernant le secteur industriel. Elle n’est pas une entreprise dont la performance se mesurerait uniquement à des critères financiers ou à une rentabilité immédiate. Elle obéit à des équilibres fragiles, interconnectés, qui ne peuvent être ajustés par décret ni redressés par un plan d’investissement. En prétendant alléger les contraintes environnementales pour « fluidifier » les projets économiques, ce texte oublie que la nature ne négocie pas : elle réagit. Et ses réactions — dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité, crises sanitaires ou agricoles — auront des conséquences bien plus coûteuses que toutes les lenteurs administratives qu’on prétend aujourd’hui abattre.
Le projet de loi de simplification de la vie économique, en assouplissant ces dispositifs de protection, risque de sacrifier l’équilibre fragile de nos écosystèmes sur l’autel d’une compétitivité économique souvent short-sighted. Reconsidérer nos priorités, c’est reconnaître que la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique ne sont pas des charges pour l’économie, mais les bases mêmes de sa pérennité.
La Fondation pour la Nature et l’Homme, la LPO, ainsi que d’autres ONG environnementales, appellent le gouvernement et les parlementaires à réviser ces dispositions qui menacent la biodiversité. Ils plaident pour une intégration plus rigoureuse des considérations environnementales dans tous les aspects de la législation économique et pour le renforcement des mécanismes de surveillance et de mise en œuvre des mesures de compensation écologique.
Photo d’en-tête : © WWF Suisse